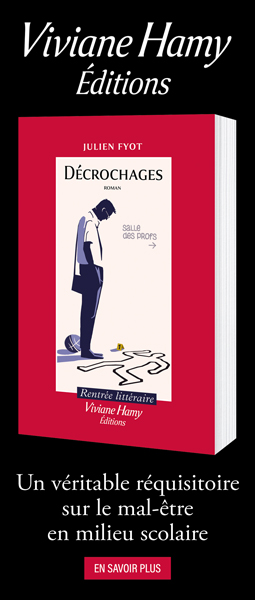Chère Catherine, à te lire maintenant depuis quelques années, l’enfant triste est un enfant qui m’est devenu familier, tant cette figure de l’enfance, de l’infantile plutôt, se dessine régulièrement en creux des élaborations que tu proposes. S’il m’est dans le fond aisé d’être ton discutant, c’est qu’en matière de psychanalyse nous partageons les mêmes fondamentaux, qu’il s’agisse de théorie ou de pratique. Et plus encore de l’articulation entre les deux : pour toi comme pour moi, la clinique psychanalytique constitue le sol, l’expérience à partir de quoi nous tentons quelques hypothèses. Ce préambule pourrait faire craindre le pire : l’accord facile, voire complaisant. À l’inverse, il m’apparaît que le partage des mêmes réquisits de l’analyse est à la fois ce qui autorise un véritable débat et permet d’éviter les discours parallèles qui jamais ne se rencontrent. Mes écarts avec tes propositions ne sont pas des contradictions, plutôt des décalages, ceux qui naissent d’une variation du point de vue. Dans le peu de temps dont je dispose, j’essaierai de faire vite, d’être aussi direct que possible. Je retiens deux questions : le thème de la perte et celui de la sexualité, de l’infantile sexualité, inséparable dans ton approche de la figure du père.
La dépression est-elle un effet de la perte ? Cette idée, tu la formules en ouverture de ton propos, elle est largement partagée, et il m’arrive certainement aussi de la reprendre à mon compte. Ton deuxième mouvement est cependant de te démarquer immédiatement d’une restriction psychopathologique aujourd’hui très commune, qui prend sa source chez Winnicott, restriction qui enclôt entre un enfant et une mère elle-même dépressive, donc désinvestissante, la psychogenèse de la dépression future. Cette construction oublie le père. Elle oublie également, et surtout, que la perte ne concerne pas que le premier objet, qu’elle est constitutive de l’appareil psychique dans son ensemble : de la naissance de la représentation qui suppose la perte de la chose jusqu’à la perte d’amour des objets oedipiens, condition d’une relative liberté libidinale ultérieure quand il s’agira d’aimer ou de travailler. La question suit d’elle-même : si la perte est une dimension générique, constructive, différenciante, en quoi spécifie-t-elle la dépression ?
Les réponses possibles tirent dans plusieurs directions : d’abord l’affirmation d’une dépressivité au cœur du psychisme humain, ce que Mélanie Klein et sa position dépressive ont inscrit dans le marbre. Mais Lacan et son désêtre ne sont pas loin non plus. Une autre façon de suivre cette piste est de souligner, au-delà de la pathologie, qu’il y a une “valeur de la dépression”, que celle-ci peut être féconde, transformatrice, et pas seulement dangereuse, au point de pouvoir être souhaitée, attendue, chez les adolescentes anorexiques par exemple. Tout cela peut se soutenir ; pour notre débat, je vais cependant privilégier la piste contraire, celle qui ne se satisfait pas de l’équation entre dépression et effet de la perte. N’est-ce pas combattre l’évidence tant il est parfois simplement observable que la perte d’un être aimé, mort ou rupture sentimentale, est presque immédiatement suivie de l’affaissement dépressif ? “Perte” est un mot qui rime avec d’autres : mort, absence, abandon, séparation… autant de mots chargés de mélancolie qui finissent par parler tout seul, à notre place. Nous les reprenons, mais ils existent sans nous, avant nous, chargés d’histoire. L’exigence d’en repenser le sens, d’en repréciser la signification me paraît d’autant plus nécessaire qu’ils sont le lieu d’un consensus. Il est rare qu’un consensus ne soit pas aussi une perte, celle de la part la plus originale d’une notion. Un exemple, le plus évident : “travail de deuil”. Que reste-t-il dans l’usage généralisé et mou de cette expression du caractère scandaleux de la découverte de Freud ? Le travail de deuil ne consiste pas à pleurer ses morts le temps qu’il faut mais à s’en détacher, à délier les attaches une à une, jusqu’à s’en débarrasser, voire à tuer le mort une seconde fois, comme on a pu le remarquer. Ce qui explique que ce travail est souvent mal fait, quand il n’est pas carrément bâclé : le mort, l’aimé n’était pas seulement un autre mais, par incorporation, introjection, identification, il est aussi une part constituante de nous-mêmes. Et de cela, on se débarrasse difficilement. L’objet est substituable, pas le moi.
Là où le travail de deuil s’opère de façon satisfaisante, la dépression n’a aucune raison de s’installer. Le scandale du travail du deuil, c’est qu’il n’est de perte que temporaire. Je me souviens de cette jeune femme, effrayée d’avoir passé une excellente journée trois semaines seulement après la mort de sa mère. On devine peut-être mon hypothèse : la dépression n’est pas un effet de la perte, mais de son impossibilité. Ce qui peut aussi se dire de la séparation : dans l’angoisse de séparation, ce n’est pas, malgré les apparences, la séparation qui est angoissante mais son impossibilité. Le dépressif n’a rien perdu, il garde tout, son passé est son présent.
Perte, séparation, ces mots pourraient donner à penser que le sujet concerné se contenterait de passivement les subir quand les processus auxquels ils se réfèrent ont aussi leur genèse. À quelles conditions la perte est-elle psychiquement possible, métabolisable, et donc la dépression évitable ? Question difficile et sans doute imprudente. Mon raisonnement a contrario me conduit à prendre un exemple, non pas de dépression, mais de non-dépression. Il y a, dans la littérature psychanalytique, une figure célèbre d’enfant non-dépressif, l’enfant à la bobine. Fort-da, loin-là, parti-reviendra, perduretrouvé, le tout sur le mode de la jubilation ; l’enfant joue à la perte, à l’absence. Il se joue de l’une et de l’autre. Cela ne le prive sans doute pas d’une capacité de se déprimer, mais lui évite le risque d’être emporté avec elle, d’y disparaître. Comment quelque chose comme cela, une érotique de la perte, une bobine de perdue dix de retrouvées, estil possible ? La “réponse” de Freud est décalée, il la formule quelques années plus tard dans Inhibition, sympôtme, angoisse. Elle passe par la prise en compte, qui n’est pas si fréquente chez lui, du point de vue interpsychique, inter-subjectif. Perte, séparation, l’élaboration réussie ou non de ces expériences concerne les hommes comme les femmes. La dépression n’est pas une maladie sexuée, à la différence de l’anorexie. L’idée de Freud est cependant que cette égalité n’est que relative, que les femmes -mais peut-être faudrait-il dire ici “le féminin”- ont avec l’angoisse de perte d’amour une intimité privilégiée. Et c’est une femme, la mère, que Freud associe au jeu de l’enfant, un jeu de la bobine avant l’heure. Elle recouvre son visage d’un foulard, à moins qu’elle ne le masque simplement de ses deux mains. Les enfants à la bobine parmi nous se souviennent de la suite : “Coucou… me voilà ! Fort-da”. Véritable scène de séduction, source d’excitation : encore, encore… Sans doute ne peut-on se jouer de la séparation que si l’objet, le premier d’entre eux, tolère sa propre perte. En ce point, Freud n’est pas si éloigné de Winnicott, même si c’est en négatif.
Si tu t’inquiètes, chère Catherine, de la disparition du père dans la clinique analytique contemporaine, ce n’est évidemment pas simplement pour rappeler son existence. Que la mère soit perdue ne signifie effectivement pas qu’elle soit perdue pour tout le monde ! Cette disparition, tu l’associes à une certaine désexualisation, dont l’effacement de la référence à la différence des sexes, à leur affrontement sur la scène primitive, est un indice parmi d’autres. Triomphe du même, oubli de l’autre, la puissance d’immobilisation du narcissisme gagne la pratique elle-même. Le père c’est aussi le premier autre, le premier étranger. “Épreuve de l’étranger” s’il en est, comment la psychanalyse pourrait-elle se passer de ce qu’il représente ? Ce que vise ta critique est une sorte de dévoiement, de détournement de la pratique, celle de la cure analytique ou des formes psychothérapiques qui en sont dérivées. L’image est celle d’un psychologue, d’un analyste qui devient sourd à ce que transfert veut dire. C’est Ferenczi qui a commencé : “La méthode que j’emploie avec mes analysants, écrit-il, consiste à les “gâter”… Je procède un peu à la manière d’une mère tendre, qui n’ira pas se coucher le soir avant d’avoir discuté à fond, avec son enfant, et réglé, dans un sens d’apaisement, tous les soucis grands et petits, peurs, intentions hostiles et problèmes de conscience restés en suspens.” Si l’analyste est la mère, voire si “le divan est la mère” (Winnicott), faut-il pour autant qu’il réponde de la place que le transfert lui assigne… Parce que la réalité que le transfert répète est toujours, sans exception, la réalité psychique, le transfert est répétition paradoxale de ce qui n’a jamais eu lieu.
La dérive “maternelle” analytique va toujours de pair avec une adhésion à la réalité matérielle et l’oubli que l’inscription psychique de celle-ci consiste en une transformation, au moins minimale. Ce retour à une conception pré-analytique du trauma néglige la découverte freudienne essentielle du phénomène d’après-coup, lequel divise le trauma en deux temps. Nous sommes redevables à Ferenczi de ses erreurs, disait Granoff. Rappelons que la première critique fut une auto-critique : alors qu’il comptait sur sa méthode active pour raccourcir la durée des traitements, Ferenczi s’aperçoit que c’est l’inverse qui a lieu, “l’appétit vient en mangeant”, plus l’analyste-mère donne de sa personne et moins cela suffit. La perte se creuse au lieu de s’effacer.
Mon accord, Catherine, jusque-là est parfait, le décalage que je voudrais évoquer suppose maintenant un pas de côté. De quelle nature sont les traumas précoces qui permettront ultérieurement à la dépression de creuser son trou ? La référence aux dépressions maternelle ou paternelle ne fait que repousser la question d’une génération. Que les libidos objectale et narcissique soient concernées, ce n’est pas douteux. Faut-il s’en tenir au sexuel ? Rien n’est moins sûr, la dépression déborde des deux côtés, vers le vital et la destructivité. Margaret Little, grande dépressive devant la psychanalyse, commente ainsi sa cure avec Winnicott : la sexualité infantile, dit-elle, n’est pas de mise quand on ne sait pas ce qu’est “être soi-même”, quand on n’est pas assuré de son identité et de sa survie. Mais en même temps qu’elle dit cela, elle montre aussi le contraire : quel plus beau témoignage de l’amour de transfert (non liquidé) et de ses sources infantiles que son texte, véritable hommage posthume à celui qui semble bien avoir été l’homme de sa vie. La mise en relation de sa vie analysante et de sa vie sexuelle et amoureuse est de ce point de vue tout à fait saisissante. Mon idée n’est pas du tout de mettre Margaret Little en contradiction avec elle-même et de soutenir contre vents et marées : le sexuel encore et toujours, rien que le sexuel ! Le psychanalyste n’est pas toujours à l’abri d’une position surmoïque paradoxale qui lui fait prétendre trouver partout ce qui fonde la légitimité de sa parole. Un tel psychanalyste finit par ressembler à l’homme qui cherche ses clés à la lueur du réverbère, non parce qu’il est sûr de les avoir perdues à cet endroit mais parce que là, au moins il fait clair.
Prenons l’exemple winnicottien prototypique, celui qu’il reconstruit à partir des patients borderline : un enfant au sein qui, dans le miroir des yeux de sa mère, ne se voit pas, ne voit pas le plaisir qu’il prend et qu’il donne, et qui, de ce fait, perd le plaisir en question, en même temps qu’il se perd lui-même. Il ne voit rien. Si cette mère ne le voit pas, ce n’est pas qu’elle en regarde un autre, cela c’est encore relativement négociable. Elle ne le voit pas, même quand elle le regarde. Sa psyché est ailleurs, au pays des morts, y compris des morts inconnus qui errent de génération en génération. À quel registre rapporter le trauma : au déséquilibre narcissisme/objectalité, au vital, à la destructivité, à tout cela intriqué ? Il n’y a aucune raison pour que l’expérience de répétition en quoi consiste une psychanalyse n’ait pas à connaître des morceaux de vie que le mot “sexuel” échoue à définir.
C’est ici qu’une distinction me paraît essentielle : le trauma, celui auquel l’expérience psychanalytique est confrontée, n’est pas toujours sexuel, ou pas seulement. Mais son traitement, lui, est sexuel, toujours ; que le sexuel (l’infantile), sa polymorphie, sa plasticité libidinale échoue à s’immiscer, à imposer son exigence de transformation et c’est le traitement psychique lui-même qui est compromis. La sexualité infantile n’est pas simplement l’objet privilégié de la psychanalyse, elle est aussi le vecteur, le porteur de sa pratique : il y a une sexualité infantile de la psychanalyse. Margaret Little vient en cure avec une question vitale, existentielle, mais c’est l’amour de transfert qui fait le travail de résolution. Être, en psychanalyse, est une abréviation de être-aimé. Reconnaissons que la “petite Margaret” est parfois d’une naïveté touchante, par exemple quand elle assimile à un signe de maternage les petits gâteaux que lui offre Winnicott en fin de séance. Comme si nos petites madeleines et leurs petits cakes visaient à nourrir. Si la sexualité infantile ne se mêle pas des affaires de cuisine, il n’y aura jamais de gâteaux, de cadeaux. Il n’y a pas un gâteau qui soit innocent ! La psychanalyse est une scène de séduction, avec ou sans gâteau. Il suffit d’inviter quelqu’un à dire tout ce qui passe par la tête. Le raisonnement que je tiens emprunte sa forme, sinon son détail à Freud. Tant que celui-ci a cru que le rêve était toujours accomplissement de désir, le sexuel infantile en a constitué le seul véritable contenu. Jusqu’au jour, celui de la deuxième topique, où Freud s’est aperçu que dans certaines conditions traumatiques le sexuel passait de l’autre côté : non plus contenu, mais opérateur, transformateur. Transformer en sexuel, en accomplissement de désir ce qui relève d’un autre ordre, vital ou destructif. Travail de deuil, travail du rêve, travail de transfert, pour chacune de ces opérations-transformations l’infantile sexualité est un premier moteur. La psychanalyse, la psychothérapie peut-elle transformer “l’impossible perte” de la dépression en une érotique de l’absence ? Le défi n’est pas mince. Il n’est pas déraisonnable d’espérer qu’à l’heure des dépressions de l’enfance et de l’adolescence, quand la plasticité psychique, pulsionnelle, est encore au meilleur d’elle-même, l’entreprise ne soit pas perdue d’avance.