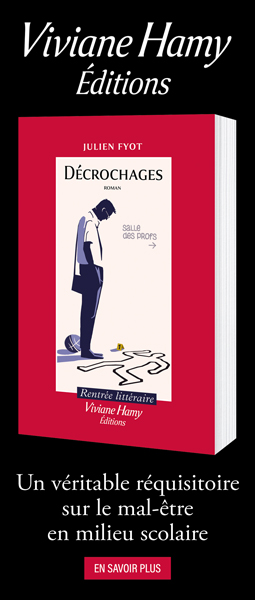On sait que la psychanalyse fait de moins en moins partie du corpus de connaissances et d’expériences jugées nécessaires à la formation des futurs psychiatres. Toutefois, lorsque l’on essaie de comprendre cette attitude relativement récente en France – mais en fait, déjà en place depuis plusieurs années dans la psychiatrie de langue anglaise – son origine semble complexe. D’une part, elle est en rapport avec certaines évolutions de la pensée scientifique et médicale occidentale de ces dernières décennies : une certaine version de l’objectivité, une modélisation de l’humain en “machine” (le recul d’une conception “vitaliste” spontanée), une instrumentalisation des propriétés du psychisme, une certaine idée du rapport entre l’efficacité et le temps… D’autre part, cette perte d’influence n’est pas étrangère à une certaine utilisation de la psychanalyse par la psychiatrie d’il y a vingt ou trente ans, utilisation qui a entraîné son lot de déceptions et de désillusions, dont l’impact est sans doute aussi important que l’évolution de la pensée scientifique ou des valeurs de société.
En effet, pendant une trentaine d’années, entre la période après la guerre et jusqu’aux années 1970, on a connu – notamment d’ailleurs aux États-Unis – une sorte d’impérialisme psychanalytique. La psychanalyse, portée par ailleurs par un effet de découverte, voire de mode, ne pénétrait pas dans l’espace psychiatrique seulement comme modalité de pensée, mais aussi et surtout comme instrument thérapeutique universel. La compréhension et l’utilisation des institutions psychiatriques, le travail avec les pathologies les plus diverses (états de crise existentielle, pathologies psychotiques chroniques, tentatives de suicide, et même déficience mentale), dans les contextes les plus différents (urgences, consultations de liaison à l’hôpital général, structures intermédiaires…) maniaient sans hésitation les notions de cadre, de transfert et d’interprétation pour mener à bien leurs actions thérapeutiques.
Si on peut se réjouir du net recul de ces errements dans la pratique psychiatrique d’aujourd’hui, il serait tout aussi erroné de considérer que la psychanalyse doit trouver une place plus modeste de thérapeutique spécifique, à côté et au même titre que d’autres approches thérapeutiques (comme la chimiothérapie ou les thérapies cognitivo-comportementales), ayant certaines indications et contre-indications relativement bien définies. Accorder une telle place à la psychanalyse dans la psychiatrie perpétuerait, en quelque sorte, l’erreur précédente : la réduire à une thérapeutique, cette thérapeutique étant elle-même réduite aux concepts opérationnels dans le cadre de la cure-type.
Or l’intérêt de la psychanalyse – du moins : l’intérêt de la psychanalyse pour les psychiatres, et notamment pour les jeunes psychiatres, qui ne baignent pas dans la culture psychanalytique de la génération précédente – n’est pas celui de l’acquisition d’une technique thérapeutique de plus, ou d’une information plus ou moins académique sur cette thérapeutique. Cet intérêt réside avant tout dans la façon dont la psychanalyse peut nous permettre de penser le psychisme humain, et plus particulièrement le malade mental, à partir de l’expérience du psychiatre et à travers les pratiques de psychiatre.
Le présent texte tentera de montrer l’intérêt de la pensée psychanalytique aussi bien dans la pratique thérapeutique de la psychiatrie, que dans sa recherche clinique et dans sa réflexion théorique, voire biologique. Et cette utilité sera d’autant plus appropriée que les psychiatres sauront utiliser la pensée psychanalytique en respectant l’originalité de leurs propres position et expérience de la souffrance mentale : c’est-à-dire qu’ils sauront utiliser la psychanalyse, non pas dans le sens de la fabrication d’une “psychiatrie psychanalytique”, mais dans le sens d’un enrichissement de la pensée psychiatrique, ce qui ne peut s’obtenir que par un approfondissement de l’autonomie de la psychiatrie, aussi bien au plan pratique que théorique. Examinons donc l’apport de la psychanalyse à la psychiatrie du triple point de vue thérapeutique, clinique et théorique de la psychiatrie contemporaine.
Le point de vue thérapeutique
Il est courant, lorsqu’on parle de l’apport de la psychanalyse à la psychiatrie, d’utiliser les névroses pour illustrer l’apport thérapeutique et, les psychoses pour illustrer l’apport clinique et théorique. Il serait donc tentant d’adopter une position inverse, et de quêter l’intérêt thérapeutique de la psychanalyse auprès des psychoses, et notamment de la schizophrénie. Comme on sait, il existe, entre les psychiatries française et anglo-saxonne, une divergence importante en matière de clinique de la schizophrénie : il s’agit du concept de dissociation, central dans notre façon de comprendre cette maladie, plus périphérique dans l’approche de la psychiatrie de langue anglaise et allemande, ce qui explique d’ailleurs l’importance, ou pas, de la place que l’on accorde aux pathologies délirantes non schizophréniques. Tout a été dit, ou presque, sur cette question : le fait que la psychiatrie française, sous la double influence de Henri Ey et de la psychanalyse, est restée fidèle à une conception que Bleuler a forgée sous l’influence de la psychanalyse en 1911, conception que lui-même avait déjà en grande partie abandonnée quinze ans plus tard, comme en témoigne son rapport au Congrès des Aliénistes et Neurologistes de Langue Française de 1926. Ou encore le fait que, sous le poids de notre tradition clinique (le délire d’interprétation de Sérieux et Capgras, la psychose hallucinatoire chronique de G. Ballet…) et, encore une fois, sous l’influence de la psychanalyse (la thèse de Lacan est quasi contemporaine du revirement de Bleuler), nous tenons beaucoup à la conservation d’un groupe autonome de pathologies, qui entrent dans le cadre général des paranoïas et s’opposent, de ce fait, aux schizophrénies.
Sur cette question, il existe un élément qui représente une constante de la pensée psychiatrique anglo-saxonne, et ce depuis bien plus longtemps que la propagation relativement récente des DSM : le souci d’objectivité. En matière de psychiatrie, discipline qui ne dispose pas d’examens paracliniques indépendants aussi bien du patient que de l’examinateur, l’objectivité est synonyme de concordance : un symptôme existe du moment qu’il est attesté par plus d’un psychiatre chez le même patient (c’est cette idée qui, dans un langage plus récent, est traduite par la notion de fidélité inter-juges). Si Bleuler a abandonné la spaltung comme concept central de son groupe de schizophrénies, c’est avant tout pour lui substituer un faisceau de symptômes (les fameux “quatre a” : ambivalence, autisme, associations perturbées, affect inapproprié) plus universellement repérables par les cliniciens ; ces symptômes préfiguraient les travaux de K. Schneider, eux-mêmes introduisant la psychiatrie critérologique qui domine actuellement dans la recherche et dans la pensée des cliniciens. Or, de ce point de vue, la dissociation était un bien mauvais critère, et ce pour une raison très simple, dont chacun a pu faire l’expérience dans sa pratique. Il s’agit d’un symptôme instable : deux psychiatres, examinant le même schizophrène, ne vont pas forcément conclure au même degré de dissociation. Pis encore : le même psychiatre, s’il parvient à prolonger suffisamment l’entretien avec un schizophrène très dissocié, constatera assez régulièrement une diminution de la dissociation. La dissociation est donc un mauvais symptôme pour la critérologie, car elle a tendance à fluctuer au gré des interlocuteurs. Mais ce qui est mauvais pour l’objectivation, est sans doute crucial en thérapeutique. En effet, comment ne pas saisir tout l’intérêt d’un symptôme psychotique qui a cette double et rare particularité d’être à la fois extrêmement grave, et de se modifier par le simple effet de la rencontre avec un psychiatre ? Comment ne pas percevoir qu’un tel symptôme nous est bien plus précieux, au plan thérapeutique, qu’une conviction délirante, par ex. hypocondriaque ou de préjudice, fixée telle quelle depuis un certain nombre d’années, et répétée à l’identique à qui veut bien l’entendre ?
C’est à ce niveau qu’intervient l’intérêt thérapeutique pour les jeunes médecins de la pensée psychanalytique : elle nous donne les outils conceptuels pour nous permettre de pénétrer ce simple phénomène, plusieurs fois rencontré dans la clinique, qui est le symptôme instable ; elle nous permet de penser ce fait remarquable que la symptomatologie psychiatrique a la spécificité de connaître des variations importantes de stabilité. Certains symptômes apparaissent comme figés, comme des sédiments d’une déjà longue pratique ; le patient les répète tels quels, il vous les adresse comme il l’aurait fait face à n’importe qui. Ce sont, en quelque sorte, les branches les plus desséchées de cette arborescence communicationnelle qu’il développe sans cesse, depuis sa naissance, à l’adresse d’autrui. Et il y a d’autres symptômes qui restent encore “verts”, c’est-à-dire qu’ils vivent encore au travers de la rencontre avec autrui. Cette rencontre peut les modifier, pour le meilleur comme pour le pire, elle peut les changer, par le fait même que ces symptômes s’adressent vraiment à la personne que le patient a en face de lui, et fluctuent au gré de l’évolution de cette rencontre.
A l’évidence, ces symptômes, si peu intéressants en termes de recherche, sont précisément ceux qui intéressent le plus au plan thérapeutique. D’abord, parce qu’ils constituent une expérience de changement ; aussi bien pour le patient, trop souvent convaincu de l’immuabilité désespérante de sa symptomatologie, que pour son médecin, trop souvent découragé par la résistance de la symptomatologie. Or, une expérience partagée de changement, est assurément la base de toute thérapeutique psychiatrique. Mais aussi parce que ces branches encore vivantes peuvent probablement nous permettre de mieux connaître la substance qui nourrit l’arborescence qui nous préoccupe, et donc nous laisser percer un jour le mystère des branches les plus fossilisées – leur redonner vie, par exemple, pour qu’elles soient prises elles aussi, à leur tour, dans la dynamique de l’échange.
On reconnaît, bien entendu, derrière ces réflexions, la notion de transfert. On a pourtant choisi l’exemple d’un transfert réputé impossible, celui de la schizophrénie. Pour dire ceci : à partir du moment où la dissociation du schizophrène avec qui nous dialoguons diminue au fur et à mesure que notre conversation avec lui avance, nous sommes déjà en train d’expérimenter les prémisses des effets de ce que la psychanalyse a placé au cœur de son action thérapeutique, à savoir le transfert. Trop inspirés par le modèle de la névrose classique, nous avons trop souvent dit à nos jeunes collaborateurs que le transfert est un effet de répétition. Certes oui – mais pour ceux qui ont quelque chose à répéter, et ce jusqu’à ce qu’il soit entendu. Mais qu’en est-il de ceux, comme les schizophrènes, qui semblent comme condamnés à recommencer sans cesse leur tentative pour dire quelque chose ? Le schizophrène dont la dissociation diminue au fur et à mesure de l’entretien, est un sujet qui tente avec nous cette expérience universelle – et depuis longtemps oubliée, heureusement, chez la plupart des autres humains – qui consiste à rechercher quelqu’un qui transforme en pensées le chaos de nos premiers enchaînements associatifs, qui nous prête sa pensée pour que nos représentations se détachent de l’étreinte étouffante de la sensation et deviennent des idées. On voit ici que le transfert — et ceci vaut, jusqu’à une certaine mesure, pour les névroses, même les plus classiques — est autant répétition que création, et que cette création est fondamentalement, et par essence, une création à deux.
L’intérêt thérapeutique que présente la psychanalyse pour la psychiatrie, par delà la liste des indications et des contre-indications, est donc avant tout de souligner cette propriété fondamentale de l’esprit humain, qui est que ses manifestations, ses mouvements, ses grandeurs et ses déchéances, ne constituent pas des phénomènes auto-générés, mais des créations à deux, c’est-à-dire des créations qui s’adressent à – et qui, par conséquent, peuvent se modifier dans la mesure où cette adresse trouve un destinataire. Être thérapeutique en psychiatrie, c’est accepter de devenir le partenaire d’un travail psychique – c’est cela le sens le plus général, et le plus pertinent en psychiatrie, du transfert. C’est aussi en cela qu’il est thérapeutique : il peut devenir l’instrument d’un processus de changement. On pourrait dire que, tout le reste, est affaire de “technique”. Il n’est pas besoin que tous les jeunes psychiatres deviennent des psychanalystes – c’est-à-dire des praticiens qui vont utiliser cet instrument dans le sens relativement précis et codifié d’une technique thérapeutique qui, elle, connaît effectivement des “indications” et des “contre-indications”. Ce que la psychanalyse a à apporter aux jeunes psychiatres en matière thérapeutique est certainement autre chose qu’une technique de plus, voire, au plan professionnel, un invitation à changer de métier. Elle leur apporte, au contraire, la seule façon de concevoir pleinement leur rôle thérapeutique en psychiatrie : la mise à la disposition d’un travail psychique enlisé, celui du malade, de notre propre appareil à penser et à sentir.
Le point de vue clinique
Puisque, pour parler de transfert, nous avons choisi les schizophrénies, il serait juste que, pour parler de clinique, nous choisissions les névroses. La clinique des névroses intéresse, en effet, à nouveau la recherche de la psychiatrie actuelle. Nous avons tous constaté comme une sorte de curiosité outre-Atlantique la disparition de l’hystérie des systèmes classificatoires internationaux, il y a une vingtaine d’années. Ce que nous avons sans doute moins remarqué, c’est que ce changement de nom s’accompagne d’un démembrement, qui trouve dans les tendances de la recherche clinique actuelle son vrai sens : celui de la formalisation de la clinique dans une perspective dimensionnelle. Ce qui constituait autrefois des ensembles plus ou moins stables de tableaux cliniques, maintenus dans leur relative cohérence par une communauté de problématiques, se retrouve désormais fractionné, en termes de recherche, en un certain nombre de dimensions cliniques : l’inhibition, l’anxiété, l’impulsivité, la ralentissement, les troubles des conduites alimentaires, les troubles sexuels… Avec cette idée sous-jacente que, ainsi reformulés, ces troubles seront plus facilement ramenés à une pathogénie neurophysiologique ou neurochimique.
Dans la première partie de cet texte, nous avons vu que la psychanalyse vient interroger, dans la démarche thérapeutique de la psychiatrie actuelle, l’omission d’une donnée fondamentale de la constitution du psychisme humain, sa création avec et à partir d’autrui. Dans cette deuxième partie, qui concerne la recherche actuelle en psychiatrie clinique, on peut se demander s’il faut convoquer la psychanalyse ou la quasi totalité des sciences contemporaines de la nature. Car, à l’époque de la physique quantique, des théories des probabilités et du chaos, de la science de la complexité, il n’y a sans doute que la recherche psychiatrique à prétendre, selon le mot de R. Angelergues, qu’une bonne connaissance de l’hydrogène, additionnée à une bonne connaissance de l’oxygène, nous apprendra quelque chose sur les propriétés de l’eau…
De ce point de vue, l’apport de la psychanalyse à la formation des jeunes psychiatres introduit en matière clinique une réflexion épistémologique à partir des autres sciences physiques qui peut se résumer en une phrase : apprendre à penser la complexité. Car la complexité n’est pas l’addition d’un certain nombre d’éléments simples, mais un ensemble nouveau, aux propriétés irréductibles à celles de ses composantes, et dont l’étude nécessite des instruments à la hauteur de sa complication.
Propos trop théoriques, pourrait-on dire. Jugeons-en : voici une jeune femme de dix-sept ans, bonne élève, évoluant dans une famille sans problèmes apparents, qui, suite à une dispute avec son petit ami, camarade de lycée, se désintéresse à ses cours et reste plutôt amorphe et indifférente aux sollicitations de ses parents. Comme elle semble triste, on lui donne un antidépresseur, et comme elle est plutôt inhibée, on choisit un IRS. Et voilà que, sous IRS, elle se met à s’agiter : elle se taillade les veines à plusieurs reprises, elle fait mine de se jeter sous une voiture. On ajoute alors à l’IRS un tranquillisant, puis quelques gouttes d’un neuroleptique réputé anti-impulsif ; et comme, quelques jours plus tard, elle semble être en permanence sur le point de s’évanouir, on arrête le tout et on la met sous une antidépresseur tricyclique. Alors l’anxiété se calme, l’impulsivité aussi, l’humeur s’améliore de façon spectaculaire, mais elle se met à faire des crises de boulimie, ou réputées telles. Ainsi, elle est dirigée vers une consultation spécialisée en TCA (troubles des comportements alimentaires) ; on n’a pas encore essayé le lithium. Ajoutons que, pour faire bonne mesure, on l’a adressée dès le début de son traitement à un psychanalyste qui, au bout de cinq séances, lui a expliqué qu’elle s’est disputée avec son amie comme sa mère se dispute souvent avec son père (c’est là qu’elle avait cessé de se couper les veines et qu’elle avait essayée de passer sous la voiture).
Que peut-on dire de cette courte vignette clinique ? D’abord, que le traitement des différentes “dimensions” du mal de cette jeune patiente a été loin d’être inefficace : son inhibition et son ralentissement ont bien été traités par l’IRS : elle s’est agitée. Son agitation a bien été traité par le neuroleptique : elle est devenue amorphe. Et son humeur a bien été améliorée par le tricyclique : dommage que le regain d’appétit ait pris la forme navrante d’une boulimie.
L’ennui est que, s’il est toujours possible de faire disparaître une inhibition, il n’est pas possible, en revanche, de ne pas se demander ce que le sujet craint ou désire de faire si, précisément, il n’était pas inhibé. Et si on peut contenir une impulsivité, il n’est malheureusement pas possible de faire taire les fantasmes qu’elle met en scène et qui parviendront à s’exprimer même dans les conditions d’une humeur inversée. Quant à l’humeur, elle est la pire de toutes, en matière clinique : tristesse et joie se tiennent à quelques milligrammes d’antidépresseur près, aussi près que les termes d’un couple d’opposés, comme pour nous rappeler obstinément leur fond pulsionnel commun et leur possibilité de s’exprimer l’un envers l’autre. La psychopathologie nous donne sans cesse le spectacle de ses propres transformations : tel jeune homme timide et réservé qui développe une schizoïdie après plusieurs années d’une pratique plutôt équilibré, voir phobique, de ses rapports avec autrui ; tel schizophrène qui, vers la quarantaine, se débarrasse totalement de sa dissociation et de sa paranoïdie au profit d’une relation tyrannique généralisée avec son entourage, voire au profit d’une réorganisation autour d’un symptôme unique hypocondriaque, aussi circonscrit qu’irréductible ; tel paranoïaque qui, traité et confronté aux dures réalités des lois et des HO, s’organise en parfait phobique des situations sociales ; telle hystérique qui, après plusieurs années d’une dysthymie défiant les études dûment contrôlées aussi bien des antidépresseurs que des thymorégulateurs, se stabilise complètement et définitivement à la faveur d’un symptôme discret et déficitaire, par exemple une amputation à peine avouée, mais très localisée, d’un secteur de ses capacités intellectuelles.
C’est en effet que tout est là en clinique : dans cet équilibre des contraires, dans cet assemblage d’investissements et de contre-investissements, d’affirmations et de négations, de transformations en quête de nouveaux équilibres. Ce que la psychanalyse a à apporter au jeune psychiatre d’aujourd’hui, est cette leçon de complexité que nous appelons l’économie psychique. Il n’est pas suffisant de pouvoir décrypter le montage des différents mécanismes et symptômes, montage qui tient à leur historicité et à leur sens. Après tout, aussi bien au niveau de l’historicité que du sens, il n’est pas interdit d’envisager la psychopathologie en dimensions relativement indépendantes. Dans L’homme aux loups, par exemple, Freud montre comment la psychanalyse peut remonter à l’origine de courants relativement indépendants les uns des autres (la scène primitive, le couple activité – passivité, l’érotisme anal), créant leurs propres chaînes associatives, dont l’entrecroisement produira les différents symptômes. Mais, pour rendre compte de ce travail particulier de la vie psychique d’un sujet qui, momentanément ou durablement, prendra la forme d’une pathologie mentale, il faut aussi concevoir que les équilibres que ces courants vont composer sont des équilibres mouvants, variant selon le moment, selon le travail sans cesse renouvelé avec les différents objets, selon les hasards de la vie et des rencontres avec l’autre.
Ainsi, l’apport clinique de la psychanalyse en psychiatrie débouche aussi, directement ou indirectement, sur un très grand nombre de questions, qui sont centrales en matière de psychopathologie : comment comprendre le déclenchement de la psychose (ou plus généralement, de toute pathologie mentale) ? Par quels chemins certaines pathologies connaissent des évolutions favorables, alors que d’autres, cliniquement semblables aux précédentes, s’engagent dans ce que l’on appelle aujourd’hui une “résistance” ? Qu’est-ce qui détermine les transformations des pathologies, le glissement entre différents symptômes ou états ? Et enfin – mais la liste est sans doute loin d’être exhaustive – quel est le rapport entre les effets thérapeutiques de nos traitements (médicamenteux compris) et leurs effets secondaires (surtout psychiques, mais jusqu’à un certain degré aussi somatiques) ?
Le point de vue théorique
La psychiatrie contemporaine comporte-t-elle une dimension théorique ? Les jeunes psychiatres risquent d’en douter, à force de s’entendre dire qu’il est possible de concevoir leur discipline de façon “athéorique”. Qu’ils se rassurent : il n’existe pas d’activité scientifique qui ne soit basée sur une théorie implicite ou explicite, et quand bien même cette activité s’efforcera ou feindra de s’en passer, ce n’est pas à une théorie qu’elle aura élaborée qu’elle va se référer mais, pire, à une idéologie. A ce titre, la psychiatrie a connu, et connaît toujours actuellement, un grand nombre de théories, plus ou moins mêlées à des idéologies, c’est-à-dire à quelque chose qui est extérieur au champ de la psychiatrie, et même de la médecine, et qui est déterminé par l’évolution de nos sociétés et l’histoire des idées qui l’accompagnent.
Les activités psychiatriques possèdent donc par définition, parfois de plein gré, parfois sans le savoir, un soubassement théorique. Si ces soubassements théoriques sont fort divergents, peuvent-ils se ramener à un nombre limité d’objets ? Autrement dit : est-ce que les théories qui traversent la psychiatrie, aussi différentes soient-elles, porteraient, en dernière analyse, sur une même et seule question, sur un même et seul objet ? Avançons une affirmation qui, faute de pouvoir l’argumenter de façon détaillée, ne peut prendre ici que la forme d’un axiome : toutes les théories psychiatriques, sans exception, traitent, directement ou indirectement, d’un même objet : celui du rapport entre le corps et l’âme. Et de ce point de vue, elles se rangent toujours, comme depuis deux siècles, et malgré les apparences, selon la même dichotomie fondamentale entre “psychogenèse” et “organogenèse”.
Où passe la ligne de démarcation entre ces deux hypothèses théoriques de la psychiatrie ? Examinons de près les hypothèses les plus récentes. Si un modèle aussi élaboré et élégant que le cognitivisme, par exemple, se classe en définitive du côté d’une certaine “psychogenèse ”, c’est parce que, bien qu’il se réclame d’une conviction de substratum biologique, les concepts qu’il construit et utilise pour faire fonctionner ses modèles ne nécessitent pas d’appui biologique : aucun de ses concepts ne vient rendre compte du biologique dans le psychique. Telle est, sans doute, la limitation sous-jacente de toute conception “anatomo-clinique” : elle obéit à un modèle de “correspondance” (tel mécanisme psycho-cognitif doit correspondre à tel mécanisme cérébral), et non pas d’ “intégration” (tel concept psycho-cognitif doit rendre compte de la biologie, et opérer en tant que représentant de celle-ci dans les modèles du fonctionnement psychique). Il en est de même pour les théories de système, par exemple, ou encore pour toute inspiration sociologique ou phénoménologique en psychiatrie : ce qui importe, ce n’est pas la conviction affichée des chercheurs (ce qui relève de l’idéologie), mais le fait qu’ils traduisent, ou pas, cette conviction en concepts opérationnels intégrés et dans leur théorie, et dans leurs hypothèses de travail. On pourrait même ajouter que, d’une certaine façon, la psychanalyse ne fait pas autre chose que de rester sur un terrain de psychogenèse – pour autant qu’elle oublie l’hypothèse pulsionnelle et économique, ou qu’elle tend à remplacer l’intrapsychique par l’interpsychique.
Or, il existe actuellement, et depuis un demi siècle, une extraordinaire occasion pour expérimenter véritablement certaines hypothèses concernant la nature biologique de la vie psychique ; cette occasion est représentée par les médicaments psychotropes. On en a fait un socle d’ “organogénèse”, comme si on venait de découvrir ce que les êtres humains savent depuis la nuit des temps, à savoir que les psychotropes (par exemple, le vin) modifient leurs humeurs et leurs pensées. Et, ce faisant, on risque de rater une nouvelle occasion pour construire des concepts de fonctionnement psychique capables de rendre compte de sa biologie. Or, de ce point de vue – point de vue donc essentiellement théorique, car touchant à la pierre angulaire de toute théorie psychiatrique – la psychanalyse a quelque chose à apporter aux jeunes psychiatres : ces concepts (excitation, pulsion, investissement, identification, affect, liaison – déliaison…) fabriqués par Freud spécialement parce qu’il se situait, pour ce qui le concernait, du côté de la conviction de la nature biologique du psychique humain, et pensait que le développement d’une théorie du psychique humain nécessitait leur invention et utilisation.
Un seul exemple. Le concept d’inconscient n’est probablement pas le plus propice pour approfondir la nature biologique du psychisme humain. Mais il y a quelque chose, dans la conception freudienne de l’inconscient et de son opposition à la conscience, qui pourrait être d’un grand intérêt pour la pensée biologique : l’idée que, alors qu’affects et représentations apparaissent en couple au niveau de la conscience, le refoulement les sépare. Les représentations sont refoulées, et s’intègrent donc dans l’inconscient. Les affects, eux, doivent suivre un chemin différent. Freud, en bon neurophysiologiste qu’il fut, n’imaginait pas qu’on puisse parler, en toute rigueur, d’ “affect inconscient” ; le propre des affects, sentiments, émotions etc., pensait-il, est d’être conscients : il sont, pour lui, ce qui, de la vie psychique, a lieu au niveau du corps, et en ce sens ils entrent par définition dans le champ de l’éprouvé.
Donc, les affects vont rester au niveau de la conscience et vont rechercher d’autres représentations à qui se lier, en subissant éventuellement certaines modifications : Freud parle d’abord de transformation en angoisse (c’est le modèle de la première théorie de l’angoisse), puis ajoute comme destin possible la répression des affects, après le refoulement des représentations qui en étaient les porteurs, et enfin il va s’intéresser au renversement de l’affect en son contraire : à l’apparition des affects sous forme de couple d’opposés, dont le prototype est représenté par l’opposition plaisir -déplaisir. Et là, il va ajouter la réflexion suivante, au passage de son argumentation, dans La Métapsychologie : “La vie affective de l’homme est faite en général de telles paires contrastées. Bien plus, s’il en était autrement, il n’y aurait peut-être pas de refoulement et pas de névrose”.
Voilà pour ce qui est de la théorie psychanalytique. Mais que signifie-t-elle cette théorisation pour une pensée biologique des états pathologiques ? Elle peut se comprendre dans un sens très simple : la qualification des affects (agréable, désagréable, douleur, joie, peine, plaisir…) n’est ni concomitante, ni dépendante de leur apparition. Quelque chose se passe au niveau du corps, et ce quelque chose connaîtra des destinées diverses, sera qualifié de telle ou telle façon (agréable, désagréable, etc.), les qualifications elles-mêmes pouvant être contradictoires entre elles dans la succession temporelle. Ces qualifications comportent, en elles-mêmes, tout le potentiel de la richesse et de la finesse du psychisme humain, et aussi de sa pathologie (Freud dit bien que, sans “paires contrastées”, il n’y aurait ni refoulement, ni névrose). Mais pour ce qui concerne la composante biologique de l’activité psychique, les “paires contrastées” intéressent peu : ce qui importe, ce sont ces événements corporels qui leur sont associés.
Or, nous disposons précisément de produits chimiques qui interfèrent avec de tels événements corporels : ce sont les médicaments psychotropes. Et le modèle anatomo-clinique montre, là aussi, ses effets pernicieux sur notre pensée théorique : dans une logique typiquement tautologique, on appelle “antidépresseurs” les médicaments qui agissent sur les dépressions, “antipsychotiques” ceux qui agissent sur les psychoses et “anxiolytiques” ceux qui diminuent l’anxiété. En revanche, si l’on veut bien prêter attention à ce que la métapsychologie freudienne nous a appris en matière de psychisme humain, on pourrait s’apercevoir qu’en termes de recherche fondamentale, un état dépressif, par exemple, n’est que le produit plus ou moins conjoncturel d’un certain nombre d’événements corporels, assorti d’un certain nombre de représentations (un certain contenu idéïque, etc.). Mais que, biologiquement parlant, ces mêmes événements corporels pourraient exister indépendamment des représentations qui les accompagnent, auquel cas on n’aurait pas d’ “état dépressif”. Or, c’est probablement ce que font les antidépresseurs : détacher certains événements corporels de leurs représentations, et leur permettre de se lier à d’autres.
Comment théoriser ce changement de perspective, cette modification de l’angle de vue ? À défaut de pouvoir répondre de façon satisfaisante à cette question, on peut du moins entrevoir l’énorme potentiel d’hypothèses théoriques, de modèles expérimentaux et de recherches que l’on pourrait tirer de l’utilisation des médicaments psychotropes, pour peu que l’on parvienne à les penser dans une relative indépendance par rapport aux pathologies auxquelles on les attache, c’est-à-dire à les penser en termes authentiquement biologiques. La psychanalyse, c’est sans doute cela aussi : une façon de penser le biologique, autrement dit, une façon de dégager des concepts, à partir desquels penser le biologique devient possible.
Conclusion
Lorsqu’il s’agit d’argumenter l’apport de la psychanalyse à la formation des jeunes psychiatres, il convient d’éviter deux écueils. Le premier est celui de la psychanalyse en tant qu’instrument thérapeutique universel ; le second est celui d’une psychanalyse rangée, à côté des autres traitements psychiatriques, dans ce que l’on appelle l’arsenal thérapeutique. Les éviter, revient à considérer que ce que la psychanalyse apporte au jeune psychiatre, c’est une façon de penser le psychisme humain. Non pas la façon de penser le psychisme malade : il y en a d’autres. Non plus la façon de penser l’humain en général : là aussi, il y en a d’autres. Mais une façon très particulière de penser le psychisme humain, ayant la particularité d’entretenir un va-et-vient permanent entre le biologique et le mental, le normal et le pathologique, l’infantile et l’actuel. Et c’est en cela, sans doute, que la psychanalyse est indispensable non pas à la société humaine en général, ou à la philosophie, ou aux sciences humaines, mais précisément à ce corps particulier de professionnels qui, en tant que médecins, ont à affronter le psychisme humain et ses pathologies.