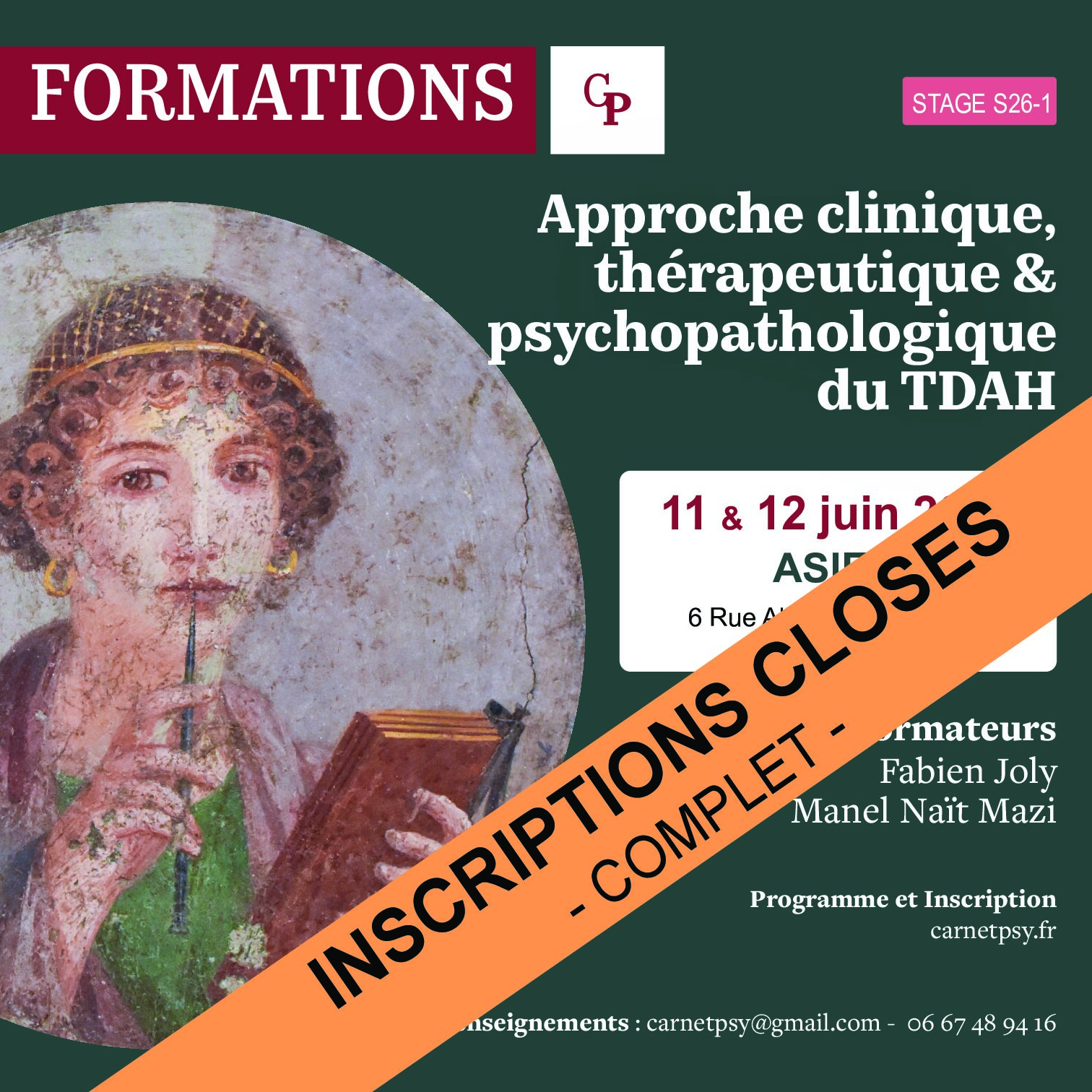Tayeb Nazim Djedaa - Étudiant en Master professionnel de psychologie clinique et pathologique à l’Université d’Angers
“Cher M. Golse,
Alors que la tendance actuelle en psychopathologie est à une naturalisation des troubles psychiques, notamment par le recours à des étiologies neurologiques et biologiques qui semble figer les possibilités d’évolution et de transformation du sujet dans la clinique, peut-on penser à partir de la notion de dysharmonie évolutive non pas seulement le caractère dysharmonique de l’évolution mais l’évolution de la dysharmonie et considérer ainsi une vision processuelle du développement qui puisse introduire du jeu entre le sujet et son symptôme ? ”
Réponse de Bernard Golse
Bernard Golse - Pédopsychiatre-psychanalyste membre de l’Association psychanalytique de France, professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Paris Cité, fondateur de l’Institut contemporain de l’enfance.
Cher M. Djedaa,
Je suis tout à fait d’accord avec cette double proposition. Si le concept de dysharmonie psychotique a été conservé dans la Classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent (CFTMEA), le concept de dysharmonie évolutive a en revanche disparu des grandes classifications internationales (DSM-5 et CIM-11) ce qui est en fait très dommage.
Il s’agit en effet d’un diagnostic structural et pas seulement descriptif qui renvoie à l’idée d’une hétérogénéité dans la maturation des différents secteurs de développement de l’enfant – cognitif, affectif, langagier, social et psychomoteur. Il me semble que le concept de dysharmonie évolutive est un très bon exemple de la nécessité de prendre en compte la temporalité du développement dans la description…
Déjà abonné ?
Les abonnements Carnet Psy