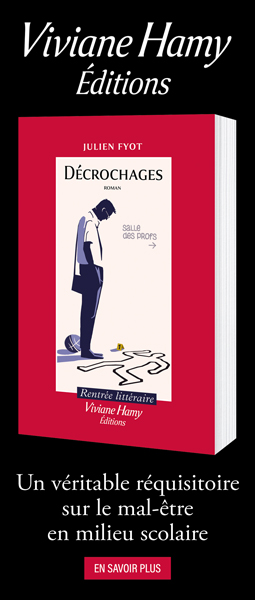« Nous sommes tous obligés, pour rendre la réalité supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies. »
Quand l’affect douloureux d’exister (… pour qui, pour quoi ? !), la douleur de ne pouvoir être que soi (la connexion avec son moi est peu stricte au point de ne pouvoir être soi-même, et ça se heurte constamment au rugueux réel) et de ne pas trouver de lieu (d’autre objet) où se poser ; quand ce même affect en quête d’une représentation qui le reconnaisse et le comble ne se satisfait plus de sa dissolution sous forme de passage à l’acte ou de douleur physique ; quand il ne se paie pas d’une plus-value narcissique dans la gloriolisation du sacrifice de soi : quand bien d’autres choses encore… alors il faut bien se résoudre à faire ce que toute psychanalyse recommande, c’est-à-dire à « bêtement1 » sublimer. Au risque de « subliminer », comme disait Blaise Cendrars c’est-à-dire d’éliminer ce qui nous meut et nous désorganise (comme trop de résilience résilie).
Ah ! sublimer-résilier ! Cette drôle d’ancienne-nouvelle forme de conversion-confession de vieilles haines cuites et recuites, et d’éternelles envies jamais rassasiées, dans le fameux moi-chaudron fêlé de Gustave Flaubert : « La parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser des ours quand on voudrait atteindre les étoiles ». L’animal en nous voudra donc toujours monter au ciel et que le profane y devienne sacré. Mais la conversion est toujours et, encore forcément, narcissique alors qu’elle devrait miraculeusement être, non seulement cathartique, mais aussi source de maturation vers une « belle vérité » truffée de compromis consentis, plutôt que de rester névrotiquement sans cesse méditée jusqu’à être insidieusement refoulée.
Sur la trop fameuse question de la sublimation, aujourd’hui détrônée par sa petite sœur, la résilience, et donc sur le seul processus thérapeutique un peu formalisé qu’a réussi à constituer l’analyse, quelques réflexions.
Si tant est que la transsubstantiation de la chair au verbe et des solides en gaz ne soit pas une illusion religieuse, il reste à découvrir la voie alchimique (moins magique et autrement délicate) qui permettrait une possible transmutation de la personnalité elle-même, telle que le sujet (sans prendre trop de risques) parviendrait à se débarrasser de ses déterminants et se verrait parer quasi miraculeusement de nouveaux systèmes de défense prêts à l’emploi.
Pour certains analystes lacaniens qui veulent toujours croire aux évangiles :« Au début serait le verbe et la chair pourrait se transformer en verbe ». À l’instar d’Antonio Tabucchi qui était convaincu que le verbe ne peut devenir chair sans une certaine dose de vulgarité… je suis convaincu que l’inverse est aussi vrai… le risque étant ici la vulgarité de la réduction. N’est-ce pas un rêve, une illusion, une folie ou une foi déraisonnable dans une matérialité du langage, qui contiendrait seule la force érotique du désir ? Sous prétexte que l’enfant naît dans un bain de parole où le symbolique gouvernerait le réel.
Même (et surtout) au XVIIIe siècle on ne croyait pas à ça de Rousseau à Casanova ; alors qu’en penser aujourd’hui… que le symbolisme se dissout dans la réalité ? Wolfson, dans Le Schizo et les langues, voulait lui aussi y croire mais c’était délirant et il n’avait pas beaucoup d’autres choix. Si il y a bien une chose qui n’est pas traduisible dans le verbe c’est bien l’émotion générée par « la prime langue maternelle » (et non le langage), soit cette générosité de cœur qui se transmue en générosité de chair…et qui n’a pas besoin d’en rajouter, … de commenter.
Attention : une sublimation trop réussie, et c’est la mort du sujet et de l’objet, de la lumière de leur rencontre et du lien qui se noue entre eux, comme de celle de la friction de leur conflit, tant il est vrai que le mot tue la chose et que le verbe tue l’émotion. Avec ce type-là de sublimation, le sujet risque de mourir avec une situation et une mine superbe, (comme le malade de ses symptômes sauvages en analyse). Juste « guéri » au moment où l’analyste avait le sentiment de commencer. Le sujet fuit dans la guérison et il y perd dans l’affaire tant en représentation (ça n’est pas ça, ça n’est qu’un millième de ce que qu’il voulait représenter, l’image aussi tue l’émotion) qu’en jouissance (la beauté de sa création psychique ne compensant pas la perte en satisfaction de l’éprouvé antérieur qui tirait son secret du désir ou du chagrin qui le précédait et que le sujet cultivait en huis-clos, sans vouloir le sentir, le savoir, le partager). Bref… on vit mieux (éprouve, ressent, endure) ce qu’on ne comprend pas. Et si le surcroît de jouissance dans le savoir existe… il est notablement insuffisant.
Deux façons de fuir dans l’excès de sublimation : le faux-self plus ou moins intégral pour atteindre une existence sans conflit, sans agressivité, sans risque …, pas sûr que ce soit une vie ; l’aliénation consentie puis assentie (masochisme érogène jusqu’à moral) au malheur et à la fatalité. A l’inverse, maintenir sa névrose avec quelques petits « aménagements pervers » (surtout qu’ils sont aujourd’hui dans une société de performance (et donc de corruption) de plus en plus socialement acceptés, au prix d’une demande consentie de pardon après-coup) pourrait permettre au sujet de continuer sa vie minuscule à fantasmer en huis clos et à jouir plus ou moins frauduleusement !
En contrebande… petitement mais sûrement, le filtrage-tamissage de la pulsionnalité brute restant de mise pour éviter l’aveuglement… le sujet alors guidé par la pulsion plus que l’orientant, tourne à vide dans sa peur et parfois derrière le désir réapparaît l’angoisse.
Attention encore : une sublimation trop réussie, sans aménagements « pervers », et c’est la vérification de la critique (Deleuze, Foucault…) maintes fois faite aux psychanalystes d’être des prêtres masqués ou des agents de la régulation sociale promoteurs d’une morale au service d’une justice puritaine qui bannirait « l’usage des plaisirs ». De même une sublimation qui consisterait à « réparer ses objets internes » et/ou à s’adapter à la réalité externe, plutôt que d’accéder à un nouvel équilibre nourri de plaisir et de sens, témoigne d’un fantasme de retour à un paradis perdu, à une innocence et une insouciance d’avant… le petit néant ou enfer personnel.
Attention et surtout avec Italo Calvino, de ne pas oublier que dans l’opération analytique, comme pour toute intervention sur l’humain, « chacun est fait de ce qu’il a vécu et personne ne peut lui enlever cela. Qui a vécu en souffrant reste fait de sa souffrance. Si on prétend lui enlever, ce n’est plus lui2 ». C’est le modèle de l’infiltrant dans le trauma surtout quand il est précoce, répété, et incestueux, ou celui du cancer qui à un certain stade révèle l’importance de l’indifférenciation rapide des zones saines et malades et la difficulté pour le chirurgien et l’analyste de percevoir, parer, cercler les frontières entre zone fonctionnelle et zone contaminée.
Alors quoi ? Pourquoi les patients viennent-ils donc à confesse se faire sublimer ? Pour la consolation avec Saint Augustin ? Sûrement pas ! Elle n’aurait pas plu à Freud, jamais de religion – pas même celle du désespoir ! et toute la « caritas » du monde n’y suffirait pas, Haro donc sur toute résurgence d’une mystique comme d’une métaphysique.
Alors quoi ? Puisque ça ne sera jamais plus tout à fait ça, qu’il n’y a rien de possiblement totalement pensable face à l’impensable, même si l’impensé est source vive de création mais d’une création qui ne peut que témoigner de son échec, comme l’analyse de ses limites. Et parce que si la libido contiendrait, dans son essence même, cette dimension d’insatisfaction générant le manque qui pousse à recommencer à désirer et aimer.
Alors quoi ? Puisqu’avec l’âge, les yeux de plus en plus hagards et de moins en moins ébahis, constatent que si évolution il y a, elle se fait assez régulièrement du plus au moins, et qu’au fond du trou qui ne cesse de s’agrandir par perte de substance ils contemplent surtout le rien ou (levant précipitamment la tête) des étoiles… certes mais déjà mortes depuis longtemps.
Alors quoi ? La psychanalyse… une école du salutaire renoncement, un kit d’aide à refouler, un auxilliaire psychique assurant la cohésion du moi en cas de début de dissociation ?
Freud est un pessimiste comique, il a pris le parti d’en rire. Pourquoi avec lui ne pas opposer à la peur (y compris du désir bien sûr) face, à cet impensable, la plus subtile et extrême des sublimations, la raillerie auto-ironique d’un sourire grimaçant ou celle d’une grimace souriante pour éviter de dérailler. Le risque nihiliste avec sa carapace cynique guetterait bien sûr… et Freud le récusait tout autant. Le père de la psychanalyse était athée et pessimiste, c’est-à-dire lucide et averti, et dès lors d’autant plus engagé à chercher la vérité… avec peut-être une morale mais non religieuse… c’est-à-dire une éthique.
Le pari avec l’analyse est de goûter l’arbre de connaissance pour mieux accepter de devoir quitter le paradis perdu du ça (penser c’est se séparer), puis investir le processus de pensée et le chagrin qui va avec, qu’un retour à l’état primitif est inenvisageable, et que même et surtout de toutes façons nous ne pourrons plus penser les choses comme on les pensait, enfant, quand les mots étaient « des sortilèges, des actes magiques ». Nous avons même perdu définitivement le souvenir de l’état d’esprit, la tournure d’esprit, la théorie de l’esprit que nous avions en ce temps-là… c’est pourquoi donc nous ne cessons de mourir à nous-mêmes. Le passé que le sujet réinvente en analyse, à partir duquel à la faveur de la régression, il envisage un futur meilleur que son présent n’est qu’une reconstruction. Bref l’analyse oblige à « penser » et à « panser avec une étoffe de pensée » la perte. La pensée, cette « métaphore dépressive du vide » selon Georges Didi Huberman qui le tenait de Pierre Fedida.
Avec cette pensée consciente de la vanité et de l’inanité des choses, alors il sera possible au sujet d’oser dans la vie d’autres choses qu’ils n’auraient même pas espéré pouvoir penser. D’oser… puis d’ajuster… rien de plus raisonnable que l’analyse. Le moteur de notre créativité sera le chagrin, les affres de nos tourments existentiels et à partir d’eux… l’audace du désordre, de l’étranger, du nouveau, de l’impur… de la surprise (se faire surprendre au risque du « choc » psychologique par son inconscient), plutôt que s’en tenir à une existence qui n’est pas une vie, c’est-à-dire non mouvante et fluente, car irréelle et froide, tant elle obéit à une Éducation… à mort.
De mettre un peu d’imaginaire dans notre vie pourra alors faire que la vie puisse imiter l’imaginaire. Comme à l’échelon du Collectif, c’est la Nature qui finit par imiter la Culture.
Notes
- C’est-à-dire très… très intelligemment.
- Italo Calvino, Palomar, Le Seuil, 1992.