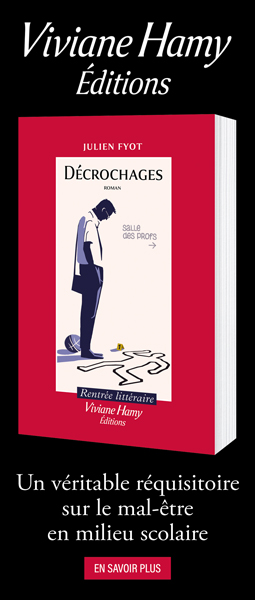« Ne les laissez pas penser que vous allez les guérir »1.
« Il y a beaucoup à gagner si l’on parvient à transformer votre misère hystérique en malheur banal »2.
Tel patient me rappelle une fois de plus qu’il va mal mais éprouve le besoin aujourd’hui de rajouter qu’il ne faut pas que je m’inquiète : « ça va tout de même bien comme ça ». Il poursuit très vite prévenant mes velléités d’interventions réparatrices qui trahiraient mon inquiétude et m’empêcheraient de totalement l’écouter, qu’ « il ne veut peut-être pas guérir ou du moins qu’il en a très peur » et qu’il trouve que « ça n’est pas très gentil pour moi qui le soigne » et même pour tout dire, puisqu’il faut tout dire, que « ça l’attriste ». Italo Svevo nous avait bel et bien averti : « J’étais sain ou du moins j’aimais tellement ma maladie (si maladie il y a) que j’employais tout mon esprit d’autodéfense à la préserver »3.
Telle patiente tombe malade (une maladie somatique) et me fait part mi étonnée mi agacée de la levée magique de sa dépression qui l’invalidait depuis de nombreuses années et sur laquelle nous « travaillions ». Pierre Marty4 nous avait bel et bien enseigné que « la maladie peut devenir un “objet” mental pour le malade et contribuer à sa réorganisation, remplaçant plus ou moins, en quelque sorte, l’objet perdu qui était la source de la désorganisation première ».
Tel enfant dont l’énurésie a cédé mécaniquement sous un traitement médicamenteux, sombre (ou se retrouve) dans une dépression profonde. Winnicott nous avait bien enseigné que la sédation d’un symptôme défensif sans travail en profondeur sur son origine pouvait révéler d’autres symptômes plus graves sous-tendus par un équilibre précaire de la personnalité en risque d’effondrement.
Quotidiennement le médecin est confronté à des malades plus ou moins récalcitrants à guérir non de leur maladie mais de la « chienne de vie »5 qui leur a été donnée de vivre dans certaines circonstances historiques, sociales, familiales et qui s’est un matin grevée d’une « maladie » supplémentaire. Paradoxe apparent qu’il importe d’intégrer (de tolérer, de pour ne pas le réduire, voire l’annuler) dans le processus de la cure.
Dans les cas les plus simples, le sujet est doublement ambivalent, prisonnier d’une moitié de lui-même qui aspire au changement mais craint les fausses joies et les déceptions, et d’une autre moitié qui sent la menace d’être pris au dépourvu face à tout ce qu’il (ses propres hautes exigences) devra assumer immédiatement au lendemain de sa guérison.
Dans les cas les plus sévères… gare à la guérison qui entraverait le cours naturel des choses où « la maladie est une tentative de la nature pour guérir le sujet ». La valeur de l’épreuve de la maladie est toujours à considérer, ne serait-ce que pour acquérir une santé pérenne : « la deuxième santé qui suit la maladie est mille fois plus vivante que le bien-être grossier de ceux qui se portent toujours bien »6. Italo Svevo posait « qu’à la différence des autres maladies, la vie est toujours mortelle et ne supporte aucun traitement… Aussi soigner la vie serait vouloir boucher les orifices de notre organisme, en les considérant comme des blessures… avec pour résultat qu’à peine guéris, nous serions étouffés »7. Voilà qui rejoint la pensée de Winnicott selon laquelle « il est parfois beaucoup plus difficile de s’arranger avec la santé qu’avec la maladie ».
Pour Freud, c’est la vérité qui guérit. Pour quelques continuateurs (Rozen, Federn, Ferenczi…) c’est la bonté et donc la réparation. Pour bon nombre de cliniciens, la guérison n’arrive qu’à l’insu du patient et du thérapeute. Elle est un « gain marginal » (Freud), ne vient que « de surcroît » (Lacan). On a beaucoup critiqué cette phrase apparemment désinvolte quant à la souffrance endurée par le patient et les thérapies réadaptatrices ont beau jeu d’affirmer de façon péremptoire qu’elles soulagent la souffrance à défaut de guérir. C’est oublier que simplement apaiser ne suffit pas et que la dynamique et l’économie psychique étant ce qu’elles sont, qui font migrer et muer les angoisses en fonction de secrets systèmes de roulis, la maladie, elle aussi, lorsque certains déséquilibres surviennent sur des équilibres trop précaires, apparaît… par surcroît. Une angoisse, un désir se muent en une autre angoisse, un autre désir… un clou chasse l’autre… pour le meilleur comme pour le pire. Il suffit que l’inconscient le fasse sur-croire.
L’analyse, dans les premiers temps, loin d’apaiser les symptômes, les exacerbe, quand allant trop vite, soulevant leur poids mort, fait craindre à la psyché, la chute dans l’étrangeté de certains trous, la perte de la maîtrise dans des débordements affectifs. L’analyste est un chirurgien empathique qui s’attaque à ré-ouvrir certaines plaies suppurantes et aux berges inflammées sans chercher à tranquilliser ou consoler. Il ne tente pas d’harmoniser ou de reconstruire des mouvements contradictoires dans une logique confortable aseptisée. Il perçoit que le patient a sa propre vision de la maladie liée à ses fantasmes (roman infantile) et à son imaginaire (autofiction), dont il peut dès lors se dire la victime, mais aussi l’acteur ou l’agent, quand ça n’est pas l’auteur.
Il accepte et accueille l’exacerbation des éléments paradoxaux que son intervention a révélée, sachant que c’est de celle-ci que peut naître une re-création de soi. L’analyste met du baume sur les blessures du passé… permettant aux patients de se réconcilier avec lui, et en cessant de les enflammer, d’éviter qu’il ne contamine leur présent. C’est la seule action indirecte qu’il a sur l’actualité de notre vie, qu’en aucun cas il ne veut diriger, se contentant simplement de la libérer. On n’est jamais assez guéri… de soi.
L’analyse est à la fois cathartique et contenante ; moins explicative qu’offrant d’un outil de liberté pour changer. Elle répond moins à des pourquoi qu’à une série de comment. Comment renoncer à la vérité matérielle pour une vérité narrative ? Comment augmenter son degré de liberté sans briser la structure-figure-mosaïque psychique que l’on s’est si laborieusement construit, tandis que le changement s’opère ? Comment donc renoncer aux jouissances substitutives infantiles que procure la névrose… ? quel est le prix à payer en ce renoncement ? Qui peut m’assurer que dans la liberté qu’on se donne avec la guérison, il n’y a pas plus de pensée et donc de souffrance ?
Comment admettre que l’on soit en perpétuel devenir et donc que plus ça change, moins ça change, et que plus ça change et plus on vit… au-delà de ses craintes ou fantasmes ? Plus… il y a une vie, que l’on peut accepter ou refuser : je sais bien mais je préfère ne pas, je renonce à changer malgré mes aspirations car il y a quelque chose d’avant que je ne peux laisser bouger… car au-delà de cette limite, je crois que mon ticket n’est plus valable, ou que j’implose dans une santé frauduleuse,… je vais donc continuer de subir et de me plaindre. Mais les réussites de la folie sont rares « gagnées seulement à force de catastrophes frôlées » avertissait Didier Anzieu, et « toute solution économique c’est-à-dire toute solution maladive, est assurée de naufrage, et une véritable wasting machine, une formidable dépense à perte, une production répétitive d’espaces bouclés, fermés, faussement protecteurs, réellement mutilants »8.
Comment accepter de lâcher un symptôme certes douloureux mais qui donnait tant de satisfactions (bénéfices secondaires et surtout primaires) ? Comment tolérer de ne plus se montrer sous son jour le plus déplaisant ?
Comment renoncer à certains plaisirs de se livrer pieds et poings liés, mais sans frein, à son vice… au-delà du principe du plaisir… du bien et du mal ? Avec l’âge, ce symptôme, cette posture, ce vice s’étaient auto-renforcés et avaient engendré quelques pseudopodes malins, jusqu’à finir par donner au sujet une identité d’emprunt ou de substitution.
Est-ce que le thérapeute, qui devra prendre le temps d’écouter toute la patiente genèse de cette maladie, aura mieux à m’offrir ?
Charles Bovary sous l’insistance d’Emma (à qui cette histoire rappelait quelque chose) avait fini par opérer le malheureux boiteux sans rien présager des funestes conséquences sur sa vie, de la soustraction d’une part native de son identité. Son infimité réparée, il ne pouvait plus gagner sa vie en mendiant. Ainsi faut-il prêter une grande attention, comme le recommandait Freud, au coût économique de la pathologie comme de son traitement, lorsqu’il évoquait la tristesse dépressive qui accompagnait l’éprouvé de la « banalité de la vie »… de la « misère quotidienne » du fait d’une « guérison » qui imposait au sujet de renoncer au narcissisme, idéalisant sa pathologie « à tout égard unique et extraordinaire ».
Au total, l’analyse délie… elle redistribue l’économie psychique, libère l’imaginaire, favorise l’arrêt de la répétition… et autorise in fine la re-création de soi. Elle travaille sur le désenchantement et/ou les désillusions du sujet par rapport au monde, aux autres, à l’autre, à soi, à l’autre en soi, à soi en l’autre. Vont en analyse non ceux qui veulent guérir ou arrêter de souffrir (ce serait négliger le risque de sombrer dans la nostalgie de leur si savoureuse « tristesse » voire de leur si beau « malheur »), mais ceux qui veulent comprendre ce qui la meut et ce qui gâte leur accès au plaisir et perturbe leur jouissance, et ceux qui veulent gagner leur propre liberté dans l’appropriation du monde. Ceux encore pour qui ça ne va plus de soi, c’est-à-dire ceux, désenchantés, dont la perte de la connaissance intuitive du monde héritée de l’enfance, et de l’immensité de la possibilité d’imaginer ce qui allait avec… et aussi de croire… laissent désabusés. La réalité n’existe pas, seule la croyance est substantielle… Il n’y a qu’à voir la déception des enfants à qui on promet quelque chose qu’on ne tient pas. La psychanalyse promet sans le dire au patient la perte de ses dernières illusions sur son passé… et l’avenir qu’ouvre une jeunesse dépassée. Elle peut se tromper mais son éthique responsable (l’idée que l’on se fait de l’autre en tant qu’être humain) l’oblige à ne pas mentir pour faire contrepoids à la force du transfert que génère le désarroi.
On ne guérit pas, on se rassemble jusqu’à finir par se ressembler. On ne retrouve pas sa personnalité, on la trouve. On s’apaise avec l’aide de quelqu’un qui trouve notre assentiment en nous donnant le sien. On renonce au trop de tranquillité.
Mais n’est-ce pas là une idéalisation aux conséquences parfois redoutables ? Dire que dans tous les cas que ce qui serait visé est la désaliénation pour l’ouverture d’un passage vers la vérité sur soi, celle-là même à laquelle s’oppose le pouvoir des symptômes, et que la guérison ne viendrait que « de surcroît », c’est supposer que le sujet a les moyens et/ou la liberté de se désenfermer et de réactiver ses ressources internes. De résilier comme on dit maintenant… Assignation à résilience quelque peu culpabilisante qui se discute constamment pour chaque sujet tant le risque de fuite et de refuge dans la guérison est grand. Si tel n’est pas le cas, si ces ressources internes s’avèrent insuffisantes… restent d’autres thérapies dont Bion disait qu’au fond, elles peuvent avoir du succès parce que les gens lui sont reconnaissants de leur éviter de penser. Et puis certains symptômes tel que le délire peuvent constituer des processus paradoxaux de guérison… et les annihiler sans précaution peut aboutir à des guérisons qui s’avèrent très vite être des désastres. On le voit aussi en médecine somatique… quand la chimiothérapie tue le cancer d’un sujet qui meurt guéri, ne réchappant pas aux effets secondaires du traitement. Le symptôme est un tiers-parlant (à défaut de pouvoir sublimer) avec qui il va falloir négocier. Dire d’un autre patient qu’il ne pouvait pas faire autre chose que de se suicider, quand l’annonce de son passage à l’acte survient, est surtout le témoignage que la théorie aide aussi à ne pas penser. Humilité donc… celle de Freud se rêvant chirurgien… de ne pas conforter les illusions en levant les résistances comme un chirurgien lève une adhérence permettant à l’organe comprimé de décompresser. « L’illusion de guérir s’amenuise au profit de l’illusion de soigner » écrivait Jean Guyotat… « c’est parce que je ne suis pas guéri … que je suis guéri… je travaille » surenchérit un patient.
Le droit à la guérison, idéal de la médecine scientifique fait parfois courir le risque au médecin qui fait trop vite violence au patient en se précipitant trop vite vers la santé, de rater l’événement qu’est la maladie.
L’hypersanté est une maladie ratée dans une société d’autoconsommation de performance et de sur-adaptation, et il est dangereux parfois de trop vite guérir et donc de fuir dans la guérison sans vouloir savoir de quoi on veut guérir. Comme de vomir ou de saigner sans non seulement savoir pourquoi, d’où, comment, mais aussi qu’est ce qui saigne et ainsi s’écoule dans une hémorragie narcissique d’hémophile ? Qu’est ce qui remonte et est ainsi rendu ? Gare aux effets collatéraux de l’hypersanté… on meurt parfois plus vite de se guérir de tout… de trop vite se purger après avoir refoulé sans savoir (de) quoi ! Tous les réanimateurs savent ça. Qui oserait parler de guérison en santé mentale, méconnaîtrait le besoin pour certains patients de garder la main sur certains symptômes et certaines perversités bien fétichisées, pour tenir dans le nouvel équilibre que l’on a construit avec eux ?
Notes
1- Freud à Jung.
2- Sigmund Freud, Etude sur l’hystérie,1895.
3- Italo Svevo, Le bon vieux et la belle enfant, Points-Seuil, 1994.
4- Pierre Marty, “Psychosomatique et psychanalyse”, Revue française de psychanalyse, mars 1990.
5- Arthur Schopenhauer.
6- Stefan Zweig, Nietzsche, Essai Stock, 1930.
7- Italo Svevo, La Conscience de Zeno, Folio Gallimard, 1964, p. 535.
8- Nathalie Zaltman, De la guérison psychanalytique, coll. Epitres, PUF, 2001.