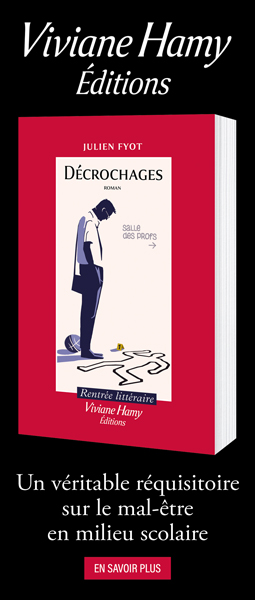En accolant dépression du bébé et dépression de l’adolescent, on présuppose que les deux tableaux peuvent être sinon identiques du moins homologues. Se pose donc la question de la continuité-discontinuité. La plupart des études longitudinales démontrent une continuité de la dépression entre la période juvénile et la période adulte. Mais il s’agit d’études (surtout celle de Maudsley1 par l’équipe de Rutter) qui commencent en période de latence ou à l’adolescence. Peut-on parler de dépression du bébé comme on parle de dépression de l’enfant ? Il me semble que non, pour les raisons suivantes :
1. Les tableaux dépressifs du bébé sont presque tous liés à une crise situationnelle, une forme de trauma : chez Spitz, c’est l’absence soudaine de la mère ; chez Kernen et Tyano2, c’est soit une maladie somatique concomitante, soit des parents très pathologiques ; chez Knauer, ce sont des séparations. Ces tableaux sont liés à des événements du registre de la perte ou du trauma. Cela ressemble à des pathologies réactionnelles. Face à la perte, le bébé semble organiser une réaction d’alarme où prédominent le retrait (comme le démontre Guedeney) et l’atonie d’investissements. C’est une forme d’autoconservation.
Évidemment, on n’en connaît pas les représentations intrapsychiques correspondantes : pas question de mise en évidence de l’identification à l’objet perdu, d’agression tournée contre le self, de baisse de l’estime de soi. La symptomatologie est souvent somatisée. Ces pathologies dépressives du bébé ont les caractéristiques suivantes : réactionnelles à un événement réel de l’ordre de la perte ; somatisation facile ; réversibilité lorsque l’objet est remis à disposition de l’enfant.
2. Ces caractéristiques indiquent certaines différences avec les tableaux plus tardifs. Par ailleurs, elles soulèvent la question : dépression-état ou dépression-structure ?
Il est plus prudent de considérer la majorité des dépressions du bébé dans le registre état, vu le lien à des circonstances externes et la réversibilité.
Il est possible que ces états évoluent vers des structures si la situation pathogène persiste. Mais il est utile de préserver une notion d’hétérogénéité entre les dépressions du bébé et celles de l’enfant plus âgé. Cependant, si la situation pathogène persiste, comme c’est le cas lorsqu’il y a une pathologie parentale concomitante, on passe de la dépression-état à une situation plus structurée, avec continuité des effets pathogènes et des réactions de défenses de l’enfant. Je montrerai plus loin une situation clinique dans laquelle la réaction d’autoconservation du bébé se transforme en structure de protection contre l’absence psychique continue de la mère.
3. Un autre facteur rend le diagnostic difficile chez le bébé : c’est la tendance particulièrement marquée à la construction de comorbidités qui sont de mise chez le jeune enfant. Le tableau de dépression est ainsi mitigé parce que des défenses secondaires s’installent pour protéger contre les représentations de perte. La comorbidité est ubiquitaire chez le jeune enfant, rendant le diagnostic plus difficile.
Voyons maintenant une situation clinique de grand risque pour le développement d’une dépression qui réunit toutes les difficultés citées ci-dessus : c’est la réaction d’un bébé à une dépression grave de la mère, productive de symptômes de dépression, tels l’atonie et le ralentissement, mais également de comorbidité, puisque la réaction dépressive ne suffit pas à neutraliser les effets de l’absence psychique maternelle.
Nous allons constater la réaction dépressive de l’enfant, puis sa construction d’autres défenses, plus mutilantes, comme si la réaction d’atonie et de retrait ne suffisait pas.
Voici une jeune femme qui fait une dépression du post-partum grave, à tonalité mélancolique. Elle me consulte pour son fils de 6 ans qui est hyperactif. Elle amène à la consultation sa fille de 6 mois, Sara, et je suis d’emblée frappé par la carence interactive qui marque cette relation. C’est dans une optique de prévention que je vais suivre ce couple mère-fille. La mère est comme absente ; elle répète à l’envi : « Il me manque quelque chose », n’arrive pas à interagir avec Sara, et lui reproche simultanément de ne pas lui donner assez de signes d’affection et de se séparer d’elle.
Extrait 1 (description d’une séance vidéo)
Sur la vidéo de cette première séance, Sara a 7 mois. Elle est assise par terre et joue avec un hochet. Sa mère, assise par terre à 1,50 m de sa fille, pleure doucement et ne parle qu’en répondant à mes questions : elle a de la peine à s’occuper de Sara et fait machinalement ce qui est nécessaire, lui donner le bain, la nourrir, etc., tout en disant qu’aucune de ces activités ne l’intéresse. Elle n’a aucune joie avec Sara.
Ce qui est le plus frappant, est la nature des interactions : Sara joue seule, à côté d’une mère engouffrée dans sa préoccupation mélancolique. À quatre reprises, en cinq minutes, Sara va longuement scruter le visage de la mère pleureuse. Elle s’agite progressivement – alors que la mère ne lui renvoie aucun signe – jusqu’au point de tomber à la renverse, emportée par l’élan de son agitation croissante. C’est seulement à ce moment que sa mère s’approche d’elle pour la remettre en position assise et reprendre sa mélopée plaintive. On est frappé par l’absence d’échange, par l’avidité visuelle de l’enfant et par l’incapacité de la mère de prévoir la chute de l’enfant. Présente physiquement à quelques centimètres de Sara, la mère est totalement absente psychiquement, à des distances interstellaires de sa fille.
Dans une interaction suivante, la mère demande à l’enfant de l’imiter en claquant des mains. Sara ne s’exécute pas, la mère l’appelle alors « malina », ce qui signifie mauvaise. Ce que la mère reproche à sa fille en l’appelant ainsi, c’est qu’elle ne lui donne pas ce qu’elle attend. Elle considère cela comme un rejet et une séparation pénible. On peut imaginer l’expérience d’impuissance que ces reproches confèrent à Sara.
Quelle fut l’évolution de Sara ?
1. Elle restait remarquablement hypo-active, sans initiative, dans une forme d’atonie qui n’est pas sans ressembler à un ralentissement moteur. Ces symptômes sont de la série dépressive. En plus, on constatait une grande pauvreté affective.
2. Mais au cours du temps, elle ajouta d’autres symptômes à ceux de l’économie et de l’atonie : elle développa des pseudo-identifications, notamment en créant une attitude de fausse gaieté destinée à ranimer sa mère : un sourire forcé, accompagné d’une écholalie illustrant un faux-self. Elle vivait par réaction, sans élan authentique.
3. Au cours du développement, on assista à une évolution déficitaire (à 17 mois, qi de 70).
On peut parler de comorbidité : la dépression est signée par les symptômes d’économie, par défaut d’investissement et de tonus affectif. Mais il semble que le retrait n’a pas suffi et que d’autres défenses ont dû être mises en place : le faux-self qui protège contre l’expression de désespoir et qui sert de pseudo-interaction avec la mère, et pire encore, l’abrasion de la pensée avec évolution déficitaire. Le défaut d’authenticité pulsionnelle sert les intérêts de la mère qui va garder Sara comme un petit toutou à ses côtés jusqu’à l’adolescence.
À 13 ans, au début de l’adolescence, Sara est dans une école spécialisée. Elle est extrêmement amorphe, offrant peu de productions spontanées. Elle est sans relief, dans une sorte de retrait passif, et toujours aussi atone. Son qi s’est amélioré à 90, grâce aux nombreux soutiens thérapeutiques qu’elle a reçus. La mère m’annonce que le système scolaire suisse interdisant à Sara de remplir tout son potentiel, qu’elle imagine considérable, elle a décidé de l’emmener dans son Portugal natal.
Extrait 2 (description d’une séquence vidéo)
Quand je demande à Sara si ça lui fait quelque chose de quitter son père, ses frères, sa maison, elle hésite et dira : « Un peu. » On sent que les attachements ont peu de relief et que les changements ne semblent pas beaucoup la toucher.
On retrouve l’atonie psychique. Pour essayer de lui extraire un peu plus de substance, je décide de la voir seule et demande à la mère de sortir. Et là, j’ai une petite surprise : Sara regarde la couverture d’un livre avec la photo d’un chien : « J’aime bien les chiens, dit-elle, parce qu’ils sont doux. » Quand je lui demande quelle race de chien elle préférerait, sa réponse fuse : « Un pit-bull. » Je suis bien étonné et elle renchérit : « Ils sont méchants, ils peuvent faire du sang, ma mère ne voudrait surtout pas ça ! » Espérant avoir saisi un brin de pulsion, je lui demande si ça lui arrive de se mettre en colère, mais c’est trop lui demander ; elle évite de répondre et se met en retrait. Le pit-bull est anesthésié.
J’avais été agréablement surpris par la persistance, en profondeur, d’un petit ruisseau pulsionnel qu’elle avait pu cacher à sa mère. Mais il était évident que ce filet d’expression était sévèrement emmuré et qu’on pouvait s’inquiéter du devenir de ce refoulement massif au cours de l’adolescence. Qu’adviendrait-il de la pulsionnalité écrasée lors des remaniements de l’adolescence : éruption psychotique ou effondrement dépressif ?
Du bébé à l’adolescence
Cette enfant a été exposée au cours de toute son évolution à une série d’influences pathogènes liées au fonctionnement de sa mère : celle-ci était non seulement sévèrement déprimée à plusieurs moments de son enfance, mais elle a aussi eu un investissement négatif de Sara : elle ne voulait pas qu’elle se différencie, et elle ne l’investissait pas comme un sujet. Sara développa des symptômes de la lignée dépressive : retrait, atonie affective et pulsionnelle, mais cela ne suffisait pas et des défenses plus mutilantes ont dû être improvisées : le faux-self, qui interdisait toute affectivité authentique, et l’abrasion intellectuelle qui représentait une comorbidité plus grave que la dépressivité. Et d’ailleurs, existe-t-il des évolutions dépressives pures, sans comorbidité.
On voit bien, comme l’avait souligné Bernard Golse3 dans son article sur les dépressions du bébé, qu’on ne peut pas penser en termes linéaires : dépression de la mère-dépression du bébé. Le bébé apporte sa propre créativité symptomatique face à la sévérité des influences pathogènes.
En ce qui concerne l’axe continuité-discontinuité, on peut dire que la sévérité du tableau pathologique est corrélée à une grande continuité : Sara est aussi atone et en retrait à 13 ans qu’elle l’était à 9 mois. On a bien l’impression d’avoir affaire à une entité structurelle (et non pas à un état réactionnel).
Quand la dépression ne suffit pas
Comment qualifier la pathologie de Sara en référence aux auteurs qui m’ont précédé ?
Francisco Palacio Espasa parle de trois niveaux de dépression, dont le plus profond correspondrait à ce qu’il appelle la « mort catastrophique de l’objet », à quoi fait suite une attaque des représentations pour sauver l’objet : dépression de mort. Certes, cela correspond bien à la clinique de Sara, mais mort de quoi ? De la représentation de soi et des fonctions cognitives, comme l’indique le tableau clinique.
Didier Houzel suggère que, dans des dépressions très précoces, avant la différenciation de l’objet, il peut y avoir une dépression primaire, une non-rencontre entre une préoccupation et l’objet qui lui correspond.
Cette non-rencontre est aussi évoquée par François Ansermet qui parle de traumatisme par défaut de rencontre, ce qui inclut un défaut de trace. Là aussi, c’est le défaut représentationnel qui crée la vulnérabilité.
Alain Braconnier différencie la dépression ana-clitique de la dépression introjective : cette dernière est celle où s’opère l’identification à l’objet perdu ; or, précisément, nous n’avons aucune certitude que Sara ait réussi une identification ; au mieux il s’agit d’une imitation. Quelle forme de structure du moi interdit l’identification à l’objet perdu ?
Bernard Golse suggère l’existence de dépressions sans objet, où ce qui est perdu est la capacité d’investir l’investissement : la désobjectalisation qui en résulte correspond bien à la clinique de Sara. On voit que le débat théorique dans ce genre de pathologie s’articule autour de la dialectique suivante : détresse/carence ou dépression ? Dépression primaire ou essentielle, ou dépression secondaire à une perte ? Dans cette dialectique fondamentale, c’est le statut de l’investissement de l’objet qui est crucial. Dans la classification de Green, on parlerait d’une dépression du troisième niveau, correspondant au syndrome de la mère morte : l’enfant, sidéré, ne comprend pas l’état affectif de sa mère. Mais Green tient à rétrécir le champ de la dépression à ce qui ne touche pas le moi.
Or, le problème du cas de Sara est que la dépression ne suffit pas. On sait que la dépressivité est une capacité fondamentalement humaine, nécessaire pour élaborer tout changement. Que se passe-t-il quand le plancher de la dépression s’effondre et que la malignité de la perte d’objet attaque non seulement l’identification à l’objet perdu, mais carrément les fonctions qui sous-tendent la représentation du self et de l’objet ? C’est ce qui s’est passé chez Sara. Elle a créé un faux-self par imitation, n’a pas réussi une identification à l’objet perdu et a attaqué ses propres fonctions cognitives. Comorbidité il y a, mais la dépression n’est plus représentée que par le défaut d’investir l’investissement, par l’atonie et le ralentissement. La pathologie a débordé sur les fonctions du moi. On est au-delà de la classification proposée par Green.
Que deviendra cette jeune fille ? On craint bien qu’elle ne devienne une personnalité très pâle et qui risque une attaque de pit-bull, lorsque l’étayage par la mère ne sera plus suffisant. Voici un tableau d’une grande vulnérabilité pour une effraction psychique, précisément parce que la dépression n’a pas suffit.
En me référant à mon expérience du suivi longitudinal des bébés4, je soulignerai les données suivantes.
– En ce qui concerne la dépression, il est difficile de considérer que le bébé de moins de 1 an puisse construire un tableau dépressif complet. Nous reconnaissons des signes dépressifs mais il nous manque l’accès à la subjectivité du bébé pour affirmer qu’on est face à une dépression dans le sens structurel du terme. C’est pourquoi, dans la majorité des cas, il est utile de distinguer état et structure dépressive.
– De surcroît, même s’il y a de plus en plus d’évidence pour une contribution génétique dans beaucoup de dépressions, il faut toujours considérer la nature des interactions parents-enfant comme facteur contributeur. 10 % de mères font une dépression du postpartum, et si cette dépression tend à durer, des répercussions seront visibles chez le bébé. Des thérapies mère-bébé sont particulièrement efficaces dans ces cas, où – bien souvent – la mère évite le bébé par peur de ressentir sa haine déclenchée par les exigences du bébé comme empiètement sur son équilibre narcissique.
– Finalement, il faut souligner tout l’intérêt du diagnostic précoce. L’étude longitudinale de Knauer et Palacio Espasa5, qui suit une cohorte de très jeunes enfants pathologiques jusqu’à la période adulte, démontre que les pires pronostics peuvent être déjoués si des mesures thérapeutiques, du genre hôpital de jour, avec des thérapies des parents et de l’enfant sont instaurées. Dans leur cohorte, il y a disparition du diagnostic dans une proportion importante des cas, ce qui nous incite à une grande vigilance diagnostique chez les bébés et nous encourage à pratiquer une prévention précoce.
Notes
- E. Fombonne, G. Wostear, V. Cooper, R. Harrington, M. Rutter, « The Maudsley long-term follow-up of child and adolescent depression. Psychiatrie outcome in adulthood », Br. J. Psychiatry, 179, 2001, p. 210-217.
- M. Kernen, S. Tyano, Depression in Infancy. Child Adolesc. Psychiatrie Clin. of Am., 15, 88397, 2006.
- B. Golse, « Les dépressions chez le bébé : affect, état, structure ? », Revue française de psychosomatique, 20, 2001-2002, p. 29-45.
- B. Cramer, C. Robert-Tissot, S. Ruseoni Serpa, Du bébé au préadolescent, une étude longitudinale, Paris, Odile Jacob, 2002. B. Cramer, Que deviendront les bébés ? Paris, Odile Jacob, 1999.
- D. Knauer, F. Palacio Espasa, De la parentalité à la personnalité des enfants, Paris, Odile Jacob, à paraître.