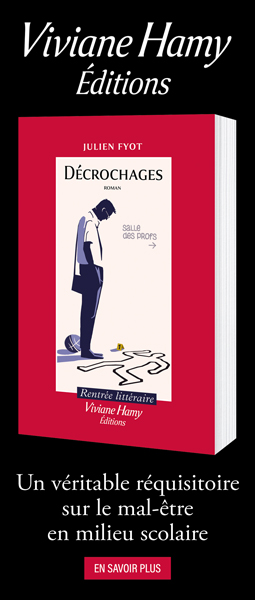I – Introduction
La pédopsychiatrie est aujourd’hui traversée par de vifs débats : on sait en effet que l’orientation psychodynamique qui donne une place prioritaire à l’analyse psychopathologique est battue en brèche par le retour de modèles médicaux traditionnels, habillés de technicité « post-moderne ». Ces modèles sont basés sur les travaux, certes passionnants, de la psychologie cognitive et de la neuropsychologie et sur une sémiologie descriptive valorisant le comportement et le symptôme devenu « trouble » à réduire ou déficit à combler au détriment de l’analyse du fonctionnement mental et du contexte relationnel, familial et social qui leur donne sens et permet d’en saisir les enjeux intrapsychiques et interpersonnels. Un exemple caricatural de ce que nous ne pouvons que baptiser de régression dans la pratique quotidienne tant les conceptions théoriques et surtout les propositions thérapeutiques en sont pauvres (abord médicamenteux et/ou rééducatif exclusif) vient de nous en être fourni par le rapport si décrié de l’INSERM sur le trouble des conduites et son utilisation démagogique à des fins électoralistes et le plus récent rapport sur les troubles des apprentissages. Ce modèle est maintenant devenu dominant au sein de l’Éducation Nationale par le biais de la circulaire du 4/05/2001, reprise dans le Bulletin Officiel (n?6 du 7/02/2002) qui déclare que « les troubles spécifiques du langage oral et écrit (dysphasies, dyslexies) sont à situer dans l’ensemble plus vaste des troubles spécifiques des apprentissages qui comportent aussi les dyscalculies, les dyspraxies et les troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité (…). Ces troubles sont considérés comme primaires, c’est-à-dire que leur origine est supposée développementale, indépendante de l’environnement socioculturel d’une part, et d’une déficience avérée ou d’un trouble psychique d’autre part ». Le risque est donc grand de voir aujourd’hui les troubles des apprentissages et les troubles instrumentaux qui les sous-tendent dépossédés de leur complexité au profit d’un « tout instrumental » à étiologie organique exclusive, devenu un « tout cérébral » isolé de la dimension psychique et contextuelle, visant l’éradication du sujet et de l’intersubjectivité. Je ne nie pas le fait que d’éventuelles difficultés maturatives neurologiques puissent intervenir dans un certain nombre de cas, mais il est non conforme à la clinique et donc peu scientifique de soutenir l’indépendance de ces troubles de la relation avec l’environnement (familial, pédagogique) et du reste de la vie mentale, en particulier comme je le montrerai plus avant du traitement des excitations pulsionnelles par le biais de la symbolisation. Cette conception est certes en vogue auprès des parents et de certains enseignants, mais un minimum d’analyse nous montre qu’elle participe d’une intolérance grandissante du socius vis à vis de sa propre conflictualité psychique. Le public est en effet davantage attiré aujourd’hui par l’espoir de solutions idéalisées, magiques et toutes puissantes « au bénéfice d’intérêts financiers et politiques effectivement puissants » (G. Lucas, 2002, p. 96) que par l’élaboration mentale plus incertaine, angoissante et moins immédiate.
Une telle orientation à propos des conceptions explicatives des troubles des apprentissages a toutefois pu être favorisée par l’apparent dédain des cliniciens et psychopathologues pour les fonctions du « Moi », les troubles des dites fonctions dont les troubles instrumentaux (troubles cognitifs, dyspraxies, dyslexies-dysorthographies, etc.) qui sous-tendent les difficultés d’apprentissage, troubles souvent délaissés du fait de leur apparente liaison à des facteurs organiques et en raison de leur aspect mécaniciste. Leur prise en charge était alors délaissée par les cliniciens au profit des rééducateurs dont le travail pouvait être dédaigné, l’absence de reconnaissance de ceux-ci les amenant à renoncer à leur identité et à ambitionner des fonctions thérapeutiques vécues comme plus nobles. Ou alors les troubles instrumentaux étaient l’objet d’interprétations psychanalytiques plaquées sur le modèle de la névrose et du conflit intrapsychique ou encore l’objet de conceptions étiologiques psychogénétiques linéaires basées sur un supposé « désir négatif de la mère » ce qui ne leur faisait pas justice. Heureusement de nouveaux travaux, basés sur une conception unitaire de la personne et ancrés sur les recherches contemporaines concernant la pathologie du narcissisme et du lien à autrui, voient aujourd’hui le jour et renouvellent les modèles psychopathologiques aptes à permettre de comprendre et mieux soigner ces troubles car ils décloisonnent les théories et les modes de prise en charge (Gibello, 1995 ; Boimare, 1999 ; Flagey, 2002 ; Jumel, 2005 ; Berger, 2006). Nous savions pourtant de longue date que « dans une perspective dynamique du développement psychique de l’enfant, le domaine des fonctions instrumentales, c’est-à-dire des modes de maîtrise du milieu, des moyens utilisés par un sujet pour se connaître, connaître le monde extérieur, agir sur lui, ne peut être dissocié de la vie affective » (Mazet et Houzel, 1979, p. 147). L’intrication est en effet serrée entre l’évolution intellectuelle, le développement de la motricité, les acquisitions du langage, voire leurs dysfonctionnements dans lesquels d’indéniables facteurs organiques peuvent intervenir, et l’ensemble de la vie psychique. Toute fonction qu’elle soit corporelle, motrice, intellectuelle ou langagière est inévitablement objet d’investissements narcissiques et objectaux par l’enfant et ses parents dans un jeu relationnel et identificatoire où le plaisir de la dite fonction occupe une place centrale. Ainsi, pris entre le corps et le langage, la nature et la culture, le psychisme trouve-t-il des voies originales orientées dans le sens de la liberté et de la créativité ou au contraire dans le sens de la répétition et de l’aliénation. L’aspect apparemment déficitaire de ces troubles instrumentaux ne doit pas nous faire oublier qu’ils n’en constituent pas moins des solutions défensives singulières face à des angoisses souvent archaïques liées à des perturbations dans la constitution des repères identitaires, des assises narcissiques, des prémices de la symbolisation et entrent ainsi dans des systèmes d’équilibre difficilement mobilisables ou le refus de l’apport de l’autre prend une place conséquente.
Dans une enquête de 1998 réalisée à l’aide de la CFTMEA citée par R. Misès (2004), il est constaté que « la grande majorité des troubles des fonctions instrumentales sont pris dans des perturbations évolutives complexes, principalement dans des pathologies limites de l’enfance » (p. 354). Selon Misès « dans ces organisations limites, les retards et les dysharmonies des grandes fonctions cognitives et instrumentales s’inscrivent dans un processus marqué par les défaillances du narcissisme et de l’auto-érotisme, par les défauts d’élaboration des angoisses dépressive et de séparation, par la précarité du fonctionnement du préconscient » (Misès, 2004, p. 354). L’enfant est touché dans ses capacités de symbolisation et de représentation, il échoue à penser l’objet absent et dans le processus d’intégration psyché-soma. Pourtant des capacités adaptatives peuvent se développer en secteur à travers un fonctionnement en faux self, ce qui amène l’enfant à consulter tardivement pour des troubles instrumentaux et des troubles des conduites ayant pesé sur les processus d’apprentissage alors que la souffrance du sujet et la complexité du problème a longtemps été minimisée ou déniée par l’entourage. Aussi le temps de l’analyse psychopathologique reste essentiel pour éviter la collusion contemporaine entre un abord explicatif réducteur et le déni du monde interne.
II – Le cas « Mélodie » (cf protocoles p.29-31)
Que nous apporte l’analyse du cas de Mélodie à cet égard ? Je me centrerai ici sur l’étude de l’entretien, des projectifs et du dessin en essayant de dégager les caractéristiques essentielles du fonctionnement psychique de Mélodie, à bien des égards non seulement complexe mais énigmatique, pour tenter de relier ces caractéristiques à certains aspects relatifs à la dyspraxie dégagés par Catherine Weismann-Arcache, spécialement les dimensions de l’investissement du corps, de l’espace et de la pensée. Ce faisant je serai amené à poser un certain nombre de questions qui pourront être éclairées par l’exposé de Fabien Joly (cf p.39-48) et reprises dans la discussion.
Un mot d’abord sur la clinique de l’entretien. Mélodie est donc la jeune fille unique de 14 ans d’un couple très soudé mais dont la place de la mère, telle qu’elle est rapportée ici, doit susciter, j’imagine, un certain nombre d’émois contre-transférentiels négatifs tant pour le personnel qui s’occupe de Mélodie que pour l’examinatrice. L’omniprésence, l’hyperprotection anxieuse, le barrage à l’égard des tiers, du père en particulier, alimenté par des fantasmes mortifères et probablement incestueux (« Si je te la laisse au bout d’une semaine elle est morte »), la présentation du monde (de l’espace) extérieur vécu comme massivement dangereux, pourraient faire se poser immédiatement des questions concernant la pathogénie maternelle : l’empiètement (donc le défaut de contenance et de pare-excitation) voire l’identification projective intrusive dont elle semble faire preuve à l’égard de sa fille ne seraient-elles pas responsables des difficultés de Mélodie ? Une séparation n’aurait-elle pas été nécessaire pour dégager Mélodie de son emprise ? Je me demande pour ma part si la mère a toujours fonctionné de cette manière ou si son anxiété n’a pas été induite ou renforcée par la dyspraxie et la dysharmonie de sa fille auquel cas elle l’aurait certes maladroitement, mais largement aidée à se sortir d’un malaise initial probablement massif en particulier en soutenant ses investissements intellectuels, même si elle n’apparaît guère en mesure de modifier ses positions maternelles en ce début d’adolescence. Il me semble en effet que les projectifs et l’ensemble du bilan témoignent, même si nous n’avons pas de comparaison longitudinale possible avec un premier temps, d’une évolution considérable probablement actualisée par le mouvement pubertaire qui jouerait ici un rôle favorable sur des problématiques archaïques, j’y reviendrai.
Quand je vois ou j’entends une telle mère, il me revient en tête l’adage de Rosine Debray « plus la mère fait mal, plus il faut être de son côté », entendre la soutenir narcissique-ment, condition d’une modification d’inter-investissements parents-enfants. Je pense également à l’avertissement de René Diatkine qui faisait remarquer qu’une consultation – fut-elle de bilan psychologique à l’issue d’une longue prise en charge – prend toujours une valeur traumatique et mobilise donc de ce fait les défenses de caractère, ce qui fait que les parents se présentent toujours sous leur plus mauvais jour, position a priori non définitive. S’est-on intéressé à l’histoire de cette mère (étrangère honteuse nous dit-on) dont certains aspects pourraient, bien que je ne sois nullement un spécialiste des cryptes et autres fantômes, hanter certaines préoccupations plus ou moins conscientes de Mélodie et parfois infiltrer mais pas parasiter la cognition : pensons à sa réaction de dégoût face à la croix gammée qu’elle perçoit dans la dernière figure des cubes de Khos. Pour autant le père n’est pas absent, il partage avec Mélodie un certain nombre d’activités qui ont leur importance, et il semble largement étayer ou contenir sa femme. Lui-même tient cependant des formules étranges condensant sexualité et menaces de séparation voire de destruction quand il dit refuser les entretiens familiaux pour ne pas « baiser » son couple. En bref « ça chauffe » dans la famille et nous allons tenter de comprendre comment Mélodie traite plus ou moins bien cette excitation décuplée par la puberté.
Concernant son style personnel, sa manière d’être et son adaptation à l’examen, j’ai un certain de nombre de questions à poser à Catherine Weismann-Arcache : l’étrangeté de sa réaction face à la séparation d’avec sa mère qui lui laisse son chapeau comme on le fait d’ordinaire avec un petit de 3 ans, ne peut manquer d’interpeller. Mélodie est-elle à ce moment là très angoissée voire désorganisée, et alors quelle qualité d’angoisse (séparation, perte, effondrement narcissique, autre ?) ou n’y a t-il pas une nette composante histrionique adressée tant à l’examinatrice qu’à sa mère. Mélodie n’aurait-elle pas saisi de longue date que l’adhésion plus ou moins authentique à ses craintes était la condition du maintien de l’amour maternel à son égard, voire la condition de la non désorganisation de celle ci, ce qui ne pourra de toute façon manquer de peser sur le travail de séparation inhérent à l’adolescence ? En dit-elle quelque chose et évoque-t-elle son ambivalence à l’égard de ses parents autrement que sur un mode anecdotique (« j’insupporte mon père, ma mère m’a volé mon adolescence »). Comment se reprend-t-elle ensuite, dans la mesure où elle semble très bien investir le bilan, voire même s’amuser franchement face à certaines épreuves, atteignant à ce moment-là (je pense au WISC) un réel plaisir de fonctionnement (« j’adore ce genre d’exercice ») même si celui ci, probablement instable, est ré-envahi par l’excitation et la perte de distance à certaines épreuves comme « Compréhension ». Que dit-elle de ses difficultés, comment se prononce-t-elle par rapport à elles, quel projet et quel choix imagine-t-elle en lien avec la problématique identificatoire ? Il me semble que ces questions et les réponses qu’elle a pu formuler conditionnent non seulement la question posée de la réorientation, mais également celle du diagnostic et du pronostic.
Commentons maintenant les épreuves projectives
On sait depuis les travaux de C. Chabert (1993) que le Rorschach est une épreuve identitaire mettant à l’épreuve la qualité de la représentation de soi, son intégrité, le maintien d’un investissement narcissique suffisant, problématiques particulièrement aiguës chez l’adolescent, contraint à faire face aux modifications de son image du corps, aux bouleversements pulsionnels et aux problématiques de perte. Je n’effectue ce bref rappel que pour souligner que le Rorschach de Mélodie me paraît exemplaire de la réactivation de l’excitation pulsionnelle pubertaire traduite ici par un nombre élevé de réponses et une efflorescence de réponses kinesthésiques et sensorielles (total des K = 11, S = 9, 5).
Mais frappent chez Mélodie les contrastes saisissants entre l’utilisation de ces déterminants, certaines planches n’étant traitées qu’à l’aide des procédés sensoriels (C, C’, Clob, E) exprimant une sensibilité anxio-dépressive majeure, alors que d’autres planches sont traitées uniquement par le biais de kinesthésies signant un investissement important de la pensée. Cependant l’articulation entre ces deux ordres de facteurs manque singulièrement de souplesse dévoilant un hiatus entre imprégnation, voire absorption passive du stimulus et réactivité fantasmatique sthénique d’ailleurs porteuse de scénarios mettant en scène d’intenses charges pulsionnelles agressives. D’autres contrastes marquent également ce protocole, situé « entre génie et folie » dit Catherine Weismann-Arcache : au niveau des contenus symbolisés/crus, actifs/passifs, idéalisés/désidéalisés ou des affects agréables/désagréables sans nuance et enfin des mécanismes de défense de différents niveaux : élaborés/archaïques. Cette succession de mises en contrastes peut bien sûr évoquer des mécanismes de clivage.
La sensorialité peut prêter à deux analyses non forcément contradictoires : la couleur, mais également le blanc, le noir et les dégradés peuvent être utilisées comme écran face aux représentations sexuelles difficilement intégrables car angoissantes (pl. II : « du brouillard, une sorte de brouillard, beaucoup de brouillard, ambiance glauque et flamboyante à la fois, un peu de sang, un peu de ténèbres, ça fascine » ; pl. IV : « Ouh alors là je vois du sombre, beaucoup de sombre, je vois deux ombres noires » ; pl. IX : « des nuages colorés, au milieu, à peine visible, une sorte de château. Une longue tour se dresse un peu comme un obélisque. Elle domine un monde perdu, caché » etc.), écran auquel s’associe une verbalisation labile assez caractéristique qui pourrait faire penser à l’enveloppe d’excitation hystérique décrite par A. Anzieu et M. Khan. Mais un autre aspect plus inquiétant caractérise ces réponses globales impressionnistes associées aux déterminants sensoriels : le défaut d’enveloppe formelle des images (F% très bas : 31%) signe que la délimitation perceptive des objets est parfois très mal dégagée, laissant à voir une enveloppe fragile, évanescente voire franchement absente, et ce en lien avec deux planches (I et IX) sollicitant les représentations maternelles archaïques. La planche I est de ce point de vue très caractéristique des aspects à la fois flous, peu contenants, voire liquides (« une horrible croûte, un insecte écrasé, de la bave d’extraterrestre ») de l’imago maternelle archaïque très référée à des dimensions destructrices. En miroir de ces aspects peu contenants la représentation de soi au féminin chez Mélodie, et donc les identifications féminines, sont très singulières : au meilleur niveau il y a une association entre le registre féminin orificiel et le registre phallique (VIII, IX : « canyon super profond/tour perdue »), alors que dans un autre registre il y a une saturation prégénitale de la sexualité qui de ce fait prend, par projection, une coloration « démoniaque » inquiétante prêtant peu à sourire malgré la formulation (pl. VII : « des demoiselles qui se montrent leur derrière, elles ont de grosses jupes pour cacher le démon qu’elles portent », le démon étant une tête de chien loup aux dents acérées : Cerbère qui garde la porte des enfers). Je pense qu’une des problématiques difficiles à élaborer par Mélodie sera celle de l’assomption d’une intériorité féminine et d’une génitalité qui ne soit ni trop envahie par des fantasmes destructeurs oraux-anaux, ni trop connotée de vide sans fond à l’image de la faible contenance de l’image maternelle. Le surinvestissement des représentations phalliques, érigées, sensible également au TAT à la pl. 11, prendrait alors non seulement le sens convenu d’une revendication phallique mais également le sens d’un contre-investissement maniaque d’une représentation de soi plus évanescente et vide. Sur ce plan il y a condensation entre représentations phalliques et représentation du corps verticalisé, érigé, en appui sur l’axe médian qui fonde la topographie corporelle.
Mais Mélodie a des ressources dans le registre de la pensée et de la créativité dont témoignent les nombreuses kinesthésies souvent moulées dans des G organisés qui jalonnent son protocole. Elles véhiculent et élaborent l’intense excitation pulsionnelle agressive essentiellement, réactivée par certaines planches. Elles servent également de contenant à une image de soi, souvent dynamique, sthénique, érigée (pl. II : « des béliers dressés sur leurs pattes arrières », pl. III : « deux ballerines qui se tiennent sur leurs deux jambes jointes et qui se penchent en avant pour regarder quelque chose »). La pl. X voit une surenchère de mises en scènes, guerrières portées par de petits personnages nantis mais menaçants voire persécuteurs, mise en scène condensée avec un scénario sexuel (se battre pour deux femmes qui se sauvent). Mais cette hyperactivité intellectuelle aurait aussi le sens d’une lutte maniaque contre toute représentation de vide à cette dernière planche. Le registre libidinal n’est pas absent de ce protocole mais plus difficile à traiter et vite recouvert par l’idéalisation et l’abstraction, l’ambivalence des sentiments semblant peu élaborable. Enfin les mécanismes de défense relèvent de registres différents : intellectualisation, abstraction, refoulement mais aussi clivage, projection et idéalisation renvoyant pour l’essentiel à un registre de fonctionnement limite labile (ou hystérique prégénital), l’excitation relevant tant de l’hyperréactivité pulsionnelle que d’un registre hypomaniaque contre une dépression narcissique sensible à travers certains aspects de la représentation de soi.
Le TAT s’avère beaucoup plus restrictif, moins créatif que le Rorschach, voire même « engourdi » à certaines planches, ce qui constitue un nouveau contraste propre au fonctionnement de Mélodie. En fait il existe une diversité de la productivité selon les planches, de même qu’il existe une grande disparité dans les modalités d’écriture des récits et donc des aménagements défensifs ainsi qu’au niveau des problématiques. L’ensemble évoque une certaine discontinuité sinon irrégularité du fonctionnement mental, propre aux organisations dites de caractère décrites par les psychosomaticiens et qu’on peut considérer comme un aménagement des états-limites.
La frange labile, dramatisée, assurant une vivacité libidinale et affective est présente à travers l’investissement de la relation, une certaine théâtralisation des situations appuyée par la mise en dialogue, le recours aux affects plus ou moins forts, mais cette frange labile s’avère insuffisante à déployer et élaborer les problématiques car souvent elle est stoppée par l’inhibition qui nécessite alors la relance de l’examinatrice. L’exemple caricatural en est fourni aux planches 4, 6 et 7 où un scénario conflictuel dramatisé engageant parfois une grande quantité d’agressivité s’amorce avant de retomber comme un soufflet. Du côté des procédés rigides, ceux-ci ne sont pas absents, ils ancrent les récits dans la réalité, tamisent parfois l’excitation au besoin en recourant au fictif (un film, un Hitchcock, pl. 4) ou encore contre-investis-sent certains mouvements agressifs par le biais de formations réactionnelles comme à la pl. 8BM. Notons à l’intersection du A1-1 et du CL2 une sensibilité-sensitivité particulière à la physionomie ou l’air des personnages (Pl. 2 : la jeune femme a l’air légèrement inquiète ; Pl. 4 : il a l’air gêné et boudeur ; Pl. 6 : ça m’a l’air d’être un requin, un maffieux, etc.), sans me semble t-il que cette sensibilité ne dépasse la dimension de paranoïa ordinaire de l’adolescent (Marty, 1997). Par ce biais Mélodie attribue aux personnages ses propres affects ou représentations non traitables autrement. Excepté à la dernière planche blanche les procédés narcissiques ne sont pas surreprésentés comme c’est parfois le cas chez les adolescents pour soutenir les atteintes à l’image de soi. Les émergences des processus primaires ne sont pas envahissantes que ce soit du côté de la massivité de la projection (on aurait pu s’y attendre) comme du côté de la désorganisation identitaire. Le langage est d’une manière générale de bonne qualité, tant sur le plan syntaxique que sur le plan du vocabulaire malgré quelques tournures populaires adolescentes, d’allure hypomane. Notons enfin la capacité à organiser un scénario inscrit dans une temporalité passé/ présent/futur malgré le poids de l’inhibition.
Concernant les problématiques, si l’investissement libidinal soutenant les relations est bien présent dans ses dimensions érotiques (pl. 9) ou tendre (pl. 10) l’œdipe n’apparaît cependant guère structurant : la pl. 2 voit un scotome du personnage maternel ce qui laisse la place à une relation de couple entre l’homme et la femme du premier plan, sans référence triangulaire. La conflictualité est alors rabattue sur une dimension de démunition ou de manque oral (ils auront rien à manger pour l’hiver) possiblement sous-tendue par l’envie. Sur question le personnage tiers devient une servante ce qui situe la relation à un niveau de domination/soumission. Les problématiques prégénitales de vol, d’agression violente reviennent aux pl. 5 et 6 confrontant à la relation aux images parentales. La problématique de perte est traitée différemment selon les planches : à la pl. 3, l’affect dépressif se relie à une problématique de perte d’objet d’amour, assez bon niveau d’élaboration même si la fin est un peu maniaque dans une identification masculine surprenante (« je suis un beau gosse et j’ai toutes les filles qui veulent bien de moi »). En revanche la pl. 13B dévoile la dépendance aux images parentales. La pl. 6 montre les limites de l’hystérisation chez Mélodie, me semble t-il : en effet si l’homme est perçu comme nanti, il en devient aussitôt menaçant sinon destructeur et l’héroïne n’a de cesse de « lui piquer » son flingue pour le tuer, occupant une position très active et castratrice à son égard. Dans le même ordre d’idées les dernières planches (11, 12, 16) moins structurées, confrontant à un univers maternel primaire sont assez inhibées, témoignant des difficultés de régression vers des positions passives positives. Cet aspect « caractériel » qui est en fait une sauvegarde narcissique phallique, me paraît infiltrer la plupart des récits potentiellement violents, violence exposant dès lors au risque de perte (pl. 1: le petit garçon a cassé son violon ; pl. 4 : la femme contrarie alors que l’homme boude, pl. 19 : le décor a été fait à la va-vite par des coups de pinceaux, etc.). Par rapport aux jeunes filles prépubères et pubères rencontrées lors de ma thèse (Chagnon, 2002) me frappe la difficulté à évoquer la thématique de séparation qui était récurrente, parce que tolérée et élaborable, chez celles qui allaient bien, à la mesure de la resexualisation des relations, les deux problématiques sexuelles et de perte étant inéluctablement conjointes. Ici les issues sont souvent brusques, probablement à l’image de Mélodie elle même, excitée, maladroite, empêtrée dans ses mouvements pulsionnels pubertaires vifs, sans trop de modulation entre l’inhibition ou les représentations d’action abruptes menaçant le lien à l’objet. Ainsi et réactionnellement certaines positions prises à l’aube de l’adolescence semblent être excessivement réparatrices et conciliatrices, quand l’adolescent doit prendre le risque de « tuer » symboliquement ses parents pour s’en dégager : c’est ce travail engageant nécessairement des angoisses dépressives qui paraît le plus problématique dans l’avenir.
Je terminerai sur le récit de la dernière planche (blanche) avant d’associer sur le dessin car il me semble qu’on peut voir se dégager à ce niveau les avancées, les potentialités et aussi les risques évolutifs chez Mélodie : « Cette feuille blanche ça me fait penser un peu à mon histoire, une histoire qui se déroule sur une autre planète, une fillette qui a le pouvoir de lire une carte indiquant un emplacement de 12 clefs permettant d’ouvrir la faille du monde des démons, la zone obscure. A cause de ça cette pauvre petite a déjà perdu à sa naissance ses parents, une amie de ses parents, et c’est la sœur de celle-ci qui l’a élevée avec son fils. Il a 16 ans et est beau gosse ; c’est un elfe du feu, immortel du moment qu’il n’est pas blessé ». Il me semble que ce récit ne doit pas trop inquiéter quand aux risques éventuellement délirants sur une thématique « démoniaque ou monstrueuse » que serait susceptible de développer Mélodie.
Ce récit qui reprend, malgré la légère perte de distance (mon histoire), un récit ou du moins les thèmes favoris des scénarios qu’elle écrit, condense toutes les problématiques de Mélodie et met en scène une version narcissico-mégalomaniaque d’elle-même, tuant ses parents dans le roman familial mais leur restant fidèle par le procédé d’écriture (qui vient de sa mère) et les thèmes (mythologiques et démoniaques) qu’elle partage avec son père (les clefs qui ouvrent la porte de l’univers des démons évoque le jeu Age of Mythology). L’amour n’est pas absent du scénario et la référence aux Elfes, personnages mystérieux, bons et graciles, aériens, renvoie aux identifications certes grandioses mais féminines et narcissisantes qu’elle vise et qui soutiennent son narcissisme d’enfant blessée. L’allusion réitérée au monde des démons renverrait dans un clivage, qu’A. Birraux (1996) soutient être normal à l’adolescence, à la projection de la part d’ombre d’elle-même, liée tant à ses pulsions agressives et sexuelles mêlées, condensée avec un monde interne/externe dangereux hérité de l’univers maternel archaïque, part qu’elle peine à intégrer. Mais, à sa décharge, il ne semble pas qu’il s’agisse d’un univers solipsiste, fermé sur lui-même, puisqu’il est partageable avec autrui tant dans le récit lui-même (le beau gosse excitant, Elfe du feu), son père dans la réalité puisqu’elle joue avec lui, et que cet univers est importé de nom breux films ou romans d’actualité (Le seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc.) qui sont objet de discussion intenses entre jeunes du même âge. Ainsi Mélodie poursuit à sa manière par le biais d’un intense travail de pensée soutenu par la fantasmatisation inconsciente sa quête du Graal vers la conquête de sa féminité et l’assomption probablement difficile de son autonomie.
Le dessin de très bonne facture, ce qui surprend tout de même pour une dyspraxique, reprend ou mieux vient figurer cette image idéale, sinon grandiose d’elle-même, à la fois non humaine et délivrée des contingences terrestres par ses ailes, évitant ainsi de tomber, mais également humaine jeune fille sexy illustrant la féminité selon les Cournut (1993) : « j’en montre suffisamment pour exciter le désir de l’autre, mais pas trop pour éviter qu’il ne s’angoisse, ne parte et me laisse seule dans la déréliction de la perte ». Cette Elfe va faire comme sa mère (signe d’identification réussie ?) se marier avec un Elfe d’une autre race et avoir un enfant, un métis : la rencontre amoureuse est bien le lieu qui sépare l’enfant de sa mère, l’échec de l’union amoureuse signant souvent la difficulté de la fille à déplacer ses investissements de son objet d’amour originaire, la mère, vers l’amant, spécialement quand le père n’a pas triangulé la situation. Deux « anomalies » marquent cependant ce dessin l’une ayant valeur d’acte manqué (elle oublie les mains), l’autre délibérée : elle dessine son héroïne sans pupilles. Bien sûr ces deux caractéristiques ne manquent pas de faire associer : angoisse de castration, lutte contre la masturbation, conflictualisation des mouvements de maîtrise sinon d’emprise dans l’oubli des mains, interdit lié au regard voyeuriste et/ou séducteur ou encore écrasement de l’espace et de la profondeur qui sépare de l’autre et que dévoile le regard dans l’absence des pupilles.
J. Bergès (1995) faisait remarquer que la dyspraxie s’associait souvent à un trouble de la vision binoculaire responsable d’une phobie du regard. On ne peut pas non plus ne pas penser au regard-miroir maternel qui enrobe le corps du bébé et lui donne son unité selon la formule chère à Winnicott, un regard qui ici serait manquant, non intériorisé chez l’Elfe Mélodie et donc source de dépressivité. Quoiqu’il en soit je pense que ce dessin montre un risque évolutif possible la concernant, celui d’une trop grande sexualisation du corps et des relations, sexualisation dès lors maniaque destinée à attirer le regard masculin pour pallier au regard interne défaillant et j’associerais ce risque à l’érotisation masochiste de l’angoisse, à travers la fascination pour le sombre, l’effrayant, le morbide. Si beaucoup d’adolescents jouent à se faire peur en visionnant des films d’horreur ce qui leur permet de maîtriser l’angoisse des transformations pubertaires et des pulsions démoniaques, la dimension maniaque de lutte contre la dépression mais également contre les angoisses persécutives – des représentations Elfiques idéalisées aux messes noires Sataniques – pourrait s’envisager comme ultime moyen de lutter contre des troubles de l’humeur en cas d’échec du travail de séparation.
III – Conclusion : troubles instrumentaux versus troubles de la personnalité ?
La dyspraxie se caractérise par la difficulté à combiner l’ensemble des gestes et des attitudes exigés par l’acte que le sujet se propose d’effectuer, la préfiguration, l’anticipation de l’acte étant faussée dans son déroulement spatial et temporel. L’adéquation entre le corps et l’espace est perturbée et à l’extrême l’enfant ne sait plus distinguer son corps de celui d’autrui, le dyspraxique « étant perdu dans son corps propre et dans le monde des objets » (Bergès, 1995, p. 1585). On comprend qu’un tel tableau conjoignant troubles conjoints de la motricité, de l’organisation de l’espace et de l’intégration du schéma corporel ait pu faire penser à des formes de psychose infantile mais Bergès rappelle que ce tableau est constitutif du syndrome tardif de l’ancien prématuré, ce qui doit appeler à la prudence. Au minimum la réalisation est lente, malhabile, dysharmonieuse et cognitivement très coûteuse car l’enfant pallie à cette absence de planification globale par une succession de mouvements séquentiels, la mise en œuvre de stratégies volontaires, contrôlées consciemment. Les conséquences scolaires en sont possiblement graves (difficultés graphiques, de l’écriture, de calcul liés à la difficulté à organiser l’espace et le temps) mais elles sont souvent compensées quand l’enfant a un bon niveau par ailleurs et par l’intellectualisation et le recours à l’abstraction. Selon M. Mazeau dont les travaux sont très en vogue à l’heure actuelle, la dyspraxie a une origine neurologique et quand il n’y a pas d’antécédent neurologique connu on parlera alors de dyspraxie développementale dont il est bien souligné qu’elle est indépendante de tout trouble psychoaffectif. Pour autant comment ne pas comprendre que des difficultés profondes du développement psychique, dans la constitution d’un psychisme autonome, cohérent, structuré, s’intriquent étroitement avec les troubles dyspraxiques ? L’expérience subjective du corps qui dépend bien évidemment de l’équipement organique étaye, on le sait, l’activité mentale (dont la planification de l’action vers une satisfaction : processus secondaire) et c’est sur l’expérience de soi que se construit le sentiment d’identité, le Moi, via le Moi-Peau cher à Anzieu, prenant appui sur le vécu corporel.
Je pense que cette déferlante du « spécifique » repose sur une confusion épistémologique majeure concernant l’objet d’étude et la question de l’étiologie, confusion qui me parait néfaste à la prise en charge de l’enfant qui se doit de respecter celui-ci dans toutes ses composantes. Le cas de Mélodie, comme tous les cas peuvent se lire selon une double approche psychopathologique et cognitive, développementale ou neurologique, ce qui n’implique aucunement l’enfermement dans une étiologie étroite et dans le débat psychogenèse/organogenèse. Cette question me paraît désuète et sans fondement, habilement et démagogiquement entretenue d’ailleurs par les non psychanalystes qui accusent les premiers de culpabiliser les parents. Pour la plupart des cliniciens (pédopsychiatres et psychologues) de formation psychanalytique l’étiopathogénie est un processus complexe, poly-factoriel, inscrit dans une temporalité (Golse, 2005). Dans ce processus où se combinent différentes influences et où les effets peuvent devenir des causes (l’après-coup), ce qui invalide toute causalité linéaire au profit de causalités circulaires et en réseau, nier que des interactions comportementales, affectives ou fantasmatiques dans lesquelles l’enfant prend une part active puissent être pathogènes ne paraît guère plus scientifique que nier une éventuelle organicité. Par ailleurs reconnaître une participation relationnelle dans la genèse ou la pérennisation d’un trouble n’implique nullement une culpabilisation des parents qui n’ont souvent pas besoin des cliniciens pour se sentir coupables. Compte ainsi pour nous beaucoup plus « le comment » (comment fonctionne la structure psychique, comment remédier en tablant sur le maillon le plus faible de la chaîne disaient Lebovici et Diatkine) que « le pourquoi » à jamais inconnaissable et surdéterminé. Notre objet d’étude ou notre mode d’approche en tant que cliniciens ou psychopathologues est bien le fonctionnement mental appréhendé selon les coordonnées de la métapsychologie contemporaine, ce qui n’exclut pas, nous venons de le voir, le recours à d’autres modèles, et non la recherche de « La » cause unique, position idéalisante et illusionante qui peut s’avérer persécutrice en cas de remise en cause d’où le reproche de culpabilisation. De ce point de vue le bilan psychologique complet tel que présenté ici, comportant entretiens, tests intellectuels, instrumentaux si besoin et épreuves projectives est un outil précieux pour analyser le fonctionnement psychique global du sujet et soutenir l’analyse psychopathologique, temps préalable à un abord thérapeutique diversifié, réfléchi et efficace1.
Note
- J’ai développé ces considérations dans trois travaux, l’un général portant sur la tentative d’éradication de la conceptualisation clinique en matière de troubles instrumentaux (Chagnon, 2006a), les deux autres portant sur l’hyperactivité (Chagnon, 2006b) et la dyslexie-dysorthographie (Chagnon, à paraître).
Références Bibliographiques
Berger M. (2006). Les troubles du développement cognitif, Paris, Dunod, 3ème édition.
Berges J. (1995). « Les troubles psychomoteurs chez l’enfant », in Lebovici, Soulé, Diatkine (1995), Nouveau traité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Paris, Puf, 1571-1590.
Birraux A. (2008). La projection, in Marty F. (dir.), Les grands concepts de la psychologie clinique, Paris, Dunod.
Boimare S. (1999). L’enfant et la peur d’apprendre, Paris, Dunod.
Chabert C. (1993). « Narcissisme et relations d’objet à l’adolescence : Apport des épreuves projectives », Bulletin de la Société du Rorschach et des Méthodes Projectives de Langue Française, 1993, 37, 183-194.
Chagnon J-Y (2002). Le pronostic à la préadolescence, Presses Universitaires du Septentrion.
Chagnon J.-Y. (2006). « Avant propos : les TOP, THADA et autres DYS ont-ils un fonctionnement mental ? Si oui lequel, sinon pourquoi ? » (Dossier « Regards cliniques sur des troubles d’actualité »), Perspectives Psy, Vol. 45, n° 4, 314-317.
Chagnon J.-Y. (2006). « Plaidoyer pour un abord psychopathologique de l’hyperactivité », Perspectives Psy, Vol. 45, n° 4, 331-338.
Chagnon J-Y (2008 ou 2009). « Regard clinique sur un cas d’enfant dyslexique-dysorthographique », sous la direction de Marty F., Recueil de cas cliniques en psychopathologie de l’enfant, Paris, In Press, à paraître.
Cournut-Janin M., Cournut J. (1993). « La castration et le féminin dans les deux sexes », Revue Française de Psychanalyse, n° congrès, 1993, 1333-1558.
Flagey D. (2002). Mal à penser, Mal à être, Troubles instrumentaux et pathologie narcissique, Toulouse, Erès.
Gibello B. (1995). La pensée décontenancée, Bayard.
Golse B. (2005). « Quelques réflexions épistémologiques sur les modèles de l’hyperactivité », in Joly F, ed. 2005, L’hyperactivité en débat, Toulouse, Erès, 7-14.
Jumel B. (2005). Comprendre et aider l’enfant dyslexique, Paris, Dunod.
Lucas G. (2002). « Les identifications chez l’enfant », Danon-Boileau L., Fine A., Wainrib S. (2002), Identifications, Monographies de Psychanalyse de la RFP, Puf, 71-109.
Marty F. (1997). « A propos du parricide et du matricide à l’adolescence », in Marty F. (dir.), L’illégitime violence. La violence à l’adolescence et son dépassement, Toulouse, Erès, 95-110.
Mazet P., Houzel D. (1979). Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, vol. 1, Paris, Maloine.
Mises R. (2004), « Troubles instrumentaux et psychopathologie », Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol. 52, n° 6, 353-355.