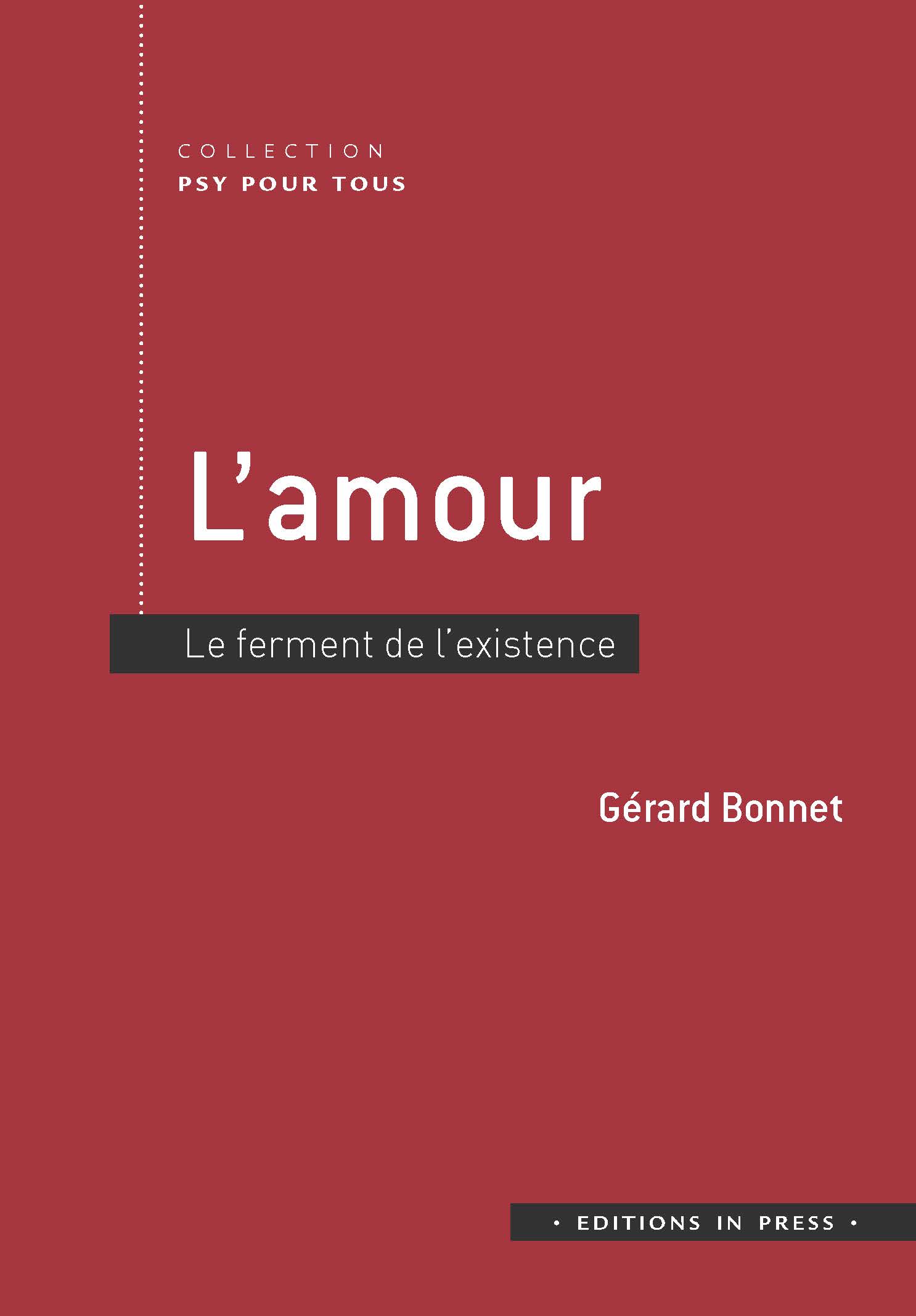C’est avec une citation de François Perrier, constatant que les psychanalystes parlent finalement peu d’amour, que Gérard Bonnet nous invite à une réflexion sur ce thème. Pour engager son propos, l’auteur rappelle l’importance de l’amour dans la vie de Freud, à commencer par l’amour de la vérité qui n’a cessé d’aiguillonner son œuvre. Sur le plan biographique, Bonnet souligne que Freud a été très aimé par ses proches, notamment par sa mère, sa femme et ses enfants. Les amitiés de Freud auraient pu être ajoutées à la liste, tant ces relations homosexuelles sublimées ont compté dans sa vie et dans son œuvre. Puis, Bonnet pose que l’on ne peut se dispenser de faire l’analyse de l’amour en tant que tel, ne serait-ce que parce qu’il est au fondement du transfert, qu’il en conditionne la fécondité et que la clinique nous y confronte constamment. L’histoire de l’amour de transfert est alors retracée : d’abord considérée comme une perturbation du traitement puis une résistance, l’amour de transfert sera finalement reconnu comme un allié précieux. « L’amour a donc fait son entrée dans l’analyse comme une force indubitable mais suspecte, et il faudra un long temps à Freud pour repérer la différence entre l’amour d’aujourd’hui utilisé comme instrument de travail transitoire et les amours du passé, problématiques, dont il facilite la mise à jour et l’analyse », (p. 15). En s’appuyant sur l’amour de transfert, l’un des objectifs majeurs d’une cure sera de restaurer en chacun ses capacités d’aimer par l’analyse des amours déficients du passé.
Après avoir placé le pulsionnel au cœur de l’amour, rappelé la variabilité de son objet et de son but, Bonnet prend le parti original d’aborder en premier lieu l’absence d’amour, à commencer par le désir de mort avant même la conception. L’amour…
Déjà abonné ?
Les abonnements Carnet Psy