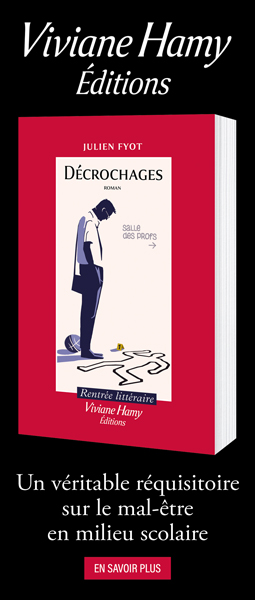Friedrich Nietzsche, né en 1844, meurt en 1900, année de parution de L’interprétation des rêves, ce livre où, comme le dit O. Mannoni, « s’est ouvert l’inconscient ». Dix années de silence consécutives à l’effondrement vécu, en 1889 à Turin, lorsqu’il est témoin de la maltraitance d’un cheval par son charretier, ont précédé sa mort ; il ne pouvait connaître l’œuvre de Freud.
Et Freud qui, lui, connaissait l’œuvre de Nietzsche n’aura cessé de s’en défendre. Il s’en expliquera dans Sigmund Freud présenté par lui-même, son autobiographie écrite en 1925-1926 : « J’ai soigneusement évité de m’approcher de la philosophie proprement dite… Les larges concordances de la psychanalyse avec Schopenhauer… ne peuvent se déduire de ma familiarité avec Schopenhauer. J’ai lu Schopenhauer très tard dans ma vie. Quant à Nietzsche, l’autre philosophe dont les pressentiments et les aperçus coïncident souvent de la manière la plus étonnante avec les résultats laborieux de la psychanalyse, je l’ai longtemps évité précisément pour cette raison : la priorité de la découverte m’importait moins que de rester sans prévention ». Si Freud peut reconnaître en Nietzsche une égale passion pour déchiffrer, éclairer toutes les dimensions de la vie psychique et, dès 1908, rendre hommage à son « degré d’introspection qui n’a jamais été atteint par personne avant lui et ne le sera sans doute jamais », il ne saurait, pour autant, céder sur le privilège qu’il accorde pour assurer la légitimité des connaissances sur la psyché aux « résultats laborieux » acquis par l’observation scientifique sur la pensée spéculative.
On doit admettre qu’ils ont en partage une exceptionnelle aptitude à affronter et à « objectiver » la réalité psychique, et bien des modes de penser la vie psychique leur est commun. L’un et l’autre fondent la psychologie sur une récusation de la dualité âme-corps, et reconnaissent également l’importance de la vie pulsionnelle dans l’humain, la nécessité de réintégrer cette vie pulsionnelle dans la conscience de soi. Déchiffreurs des forces obscures qui gouvernent l’homme à son insu, l’un comme l’autre fonde la possibilité du développement de l’humanité, son gain d’humanisation, sur une recherche intransigeante de la vérité. Leur destin commun de créateurs est bien d’être, comme le dira Stefan Zweig de Freud, des « incurables désillusionnistes », mais la forme que prendra leur combat pour faire advenir à la connaissance ces ressorts de notre barbarie intime décidera de destins personnels qui s’opposent. Nietzsche, le créateur artiste, dont l’indomptable marche vers la connaissance de soi-même, – il en parlera comme « d’une besogne de bourreau vis-à-vis de soi-même », « d’une incision dans sa propre chair » -, s’affirme comme une nécessité intime de mettre les choses en lumière, de mettre en parole ces vérités qui s’accumulent, de faire se rejoindre les ténèbres et la lumière, succombera à cette expérimentation hors limites. Gide dira : « Nietzsche s’est fait fou, il a gagné puisqu’il est fou ». Freud, le créateur scientifique, en fondant sur l’observation clinique les phénomènes psychiques inconscients, en construisant un cadre théorique pour les penser, la métapsychologie, et en créant une pratique susceptible de les prendre en compte pour les infléchir, pourra prétendre offrir à l’humanité une possibilité de lutter contre les forces « démoniaques » sans y succomber. Il écrira à Stefan Zweig : « notre façon prosaïque de lutter avec le démon consiste en ceci que nous le considérons comme un objet scientifiquement saisissable ».
Et même si, à partir d’Au-delà du principe de plaisir, avec l’introduction de la pulsion de mort, le visage de la lutte contre le démon va, chez Freud, se modifier pour faire une place à la pensée spéculative et, en opérant l’intégration du mal par la reconnaissance de la barbarie dans l’humain et la capacité d’autodestruction de l’humanité, se rapprocher du tragique nietzschéen, il ne le rejoindra pas sur sa conception de la culture et sur celle de la sublimation culturelle, de la création. L’opposition qu’il formule dans Malaise dans la culture entre un principe d’unification, Eros, opposé à Thanatos comme principe de désunion, conflit de forces opposées dont il fait le moteur de la vie psychique et le destin de l’espèce, ne s’accorde pas à la vision de Nietzsche pour qui la croyance en une opposition essentielle du bien et du mal, en une essence humaine, n’est que « préjugé de philosophe ». Ce n’est pas le conflit mais, à l’inverse, la coexistence des contraires dont Nietzsche fait le motif de la vie psychique. Il fait de la nécessité à vivre avec les oppositions et non d’apprendre à les surmonter la condition de l’esprit libre. Là où Freud fait de la rationalité le socle de la positivité humaine, postulant une nécessaire soumission à la « dictature de la raison », Nietzsche voit, à l’inverse, dans le fond de primitivité de « l’humain-trop-humain » dans lequel la barbarie trouve son origine, le sol de cette positivité. Tout ce qui nie le monde violent des instincts ou qui prétend lui imposer silence n’est pour lui que mensonge : l’idéalisme, la religion, la rationalité moderne initiée par Socrate, l’idéologie du Siècle des Lumières… « Tuer les passions, là est la source du mal » car « nos passions sont les roches nues de la réalité ». Et puisque dieu est mort, et avec sa mort les sources d’espérance et d’amour, il n’y a pour l’homme d’autres prémisses possibles pour penser le progrès de l’humain, l’humanisation, que d’accepter le chaotique et le monstrueux, tel que pour lui il avait droit d’existence dans le monde homérique avec l’apparition de Dionysos, dieu immoral, figuration du monstrueux, du chaotique, source d’effroi, face d’ombre de la figure du héros solaire apollinien sur la scène de la tragédie attique, pessimiste, celle d’Eschyle et de Sophocle qui dit la douleur de l’existence. Accepter ces forces inconscientes obscures, le démoniaque de la toute-puissance des instincts et tenter un effort désespéré pour que le monde puise en soi la capacité de se transcender, tel est son credo de la création comme valeur des valeurs : « il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante ».
On conçoit bien comment la conception freudienne de l’inconscient construite sur une théorie des pulsions et du refoulement se refuse à ce hors-la-loi de la nature prôné par Nietzsche. Par sa théorie de la représentativité, Freud rend possible un savoir indirect mais objectif sur la pulsion, fondant ainsi une psychologie capable de penser le démoniaque et d’en démobiliser les effets pathogènes. La psychologie de Nietzsche est, elle, une affirmation de la suprématie de la sensorialité contre tout idéalisme. Elle se veut interprétation du corps pulsionnel, du corps qui éprouve, du corps qui souffre car il constitue l’unique réalité à laquelle nous ayons accès et pour laquelle il est possible d’élaborer un système de représentations permettant de le décrire. « Je suis corps de part en part » clame Zarathoustra. Ni unité ni instance première, la pensée n’est qu’une instance dérivée descriptible à partir du jeu des instincts, des besoins et des passions qui constituent le corps. Ainsi « la majeure partie de notre activité psychique se déroule inconsciente et insensible à nous-mêmes ». Nietzsche, homme tourmenté par la maladie fait de sa météorologie corporelle le critère de vérité sur sa scène psychique intérieure : « la pensée est une tentative de gagner de l’espace qui puisse faire éclater cette emprise de la douleur ». Lou Andreas-Salomé écrira que « l’histoire de cet homme “unique” est du commencement à la fin une biographie de la douleur ».
A ce corps de souffrance dans lequel ses pensées trouvent leur origine, s’oppose la splendide santé de Freud. Dans son essai sur Freud paru en 1931, Stefan Zweig décrit la vigueur surnormale de ce bel homme. Il évoque sa puissance démoniaque de travail, son étonnante virilité, son énergie tranchante et implacable, sa volonté inexorable. En contraste du corps tourmentant de Nietzsche le mettant toujours en menace de faillite, d’effondrement, de délitement, c’est l’armure d’un combattant que ce corps figure – et l’on sait la fréquence des métaphores militaires dans l’œuvre freudienne.
En contraste, aussi, l’élément imaginaire dominant chez l’un et chez l’autre. Chez Nietzsche, précurseur de la psychanalyse, l’amour de la musique qui ressortit à la tendance à sortir de soi, à déborder dans l’espace, à s’éprouver dans un élément sans contrainte ni barrière, ce qui permet de s’envoler et de se dissoudre dans l’éphémère et l’infini : « sans la musique la vie serait une erreur, une besogne éreintante, un exil ». Pour Freud, fondateur de la psychanalyse, l’amour de ce qui figure, est matière, lui offre des formes concrètes, se conserve, trouve une place stable et permanente dans l’accumulation d’une collection. Deux ancrages imaginaires contrastés étayant deux modes différents de penser le travail créatif.