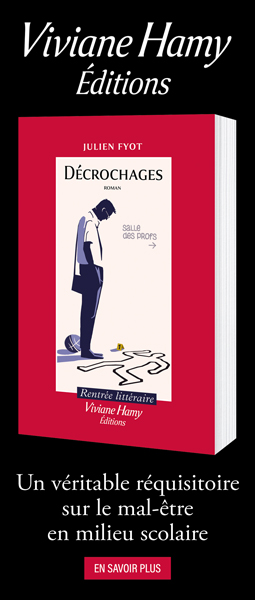« Il faut de tout pour faire un monde, et plus que tout dans le même être… à comprendre, vous avez bonne mine ! »
Pour commencer, considérons la chose sous l’angle du lieu commun : Céline, c’est d’abord une énigme paraissant répondre de forces qui toujours se dédoublent sans résolution mutuelle. La logique du clivage est incessamment sollicitée, par exemple le bon écrivain avant les pamphlets, le salaud haineux et ratiocineur par la suite mais, comme diraient les publicitaires, Céline est une valeur clivante depuis ses débuts. Dès la parution en 1932 de Voyage au Bout de la Nuit, l’écrivain aura divisé remarquablement à l’intérieur même des lignes de clivage ; plus que cliver, Céline fragmente d’emblée les repères les plus habituels. C’est dire que l’œuvre pose inauguralement autant que constitutivement un problème d’intégration, ce que nous allons suivre ici, considérant qu’elle nous entretient de ça, de ce souci d’intégration qui nous incombe à tous, le trait d’union par exemple qu’on peut mettre dans le mot psycho-somatique (sur ce trait : bâton cassé d’avance aura-t-il précisé, mais quand ?). Céline ce serait comment le négatif, entendez là la haine, le rédhibitoire, tout ce qui écarte jusqu’à la mutilation, comment ce négatif peut faire trait d’union, ou pas. Et ce sera l’intérêt, il faut le dire, des outrances de l’auteur que de nous amener sur l’arrivée à tenter de répondre à travers cette autre interrogation : qu’est-ce que ça fait l’écriture à Céline ? Comment l’homme se tient à travers la littérature, ceci autant que comment le lecteur peut tenir, ou pas, l’écriture de Louis-Ferdinand Céline ?
De manière évidente (trop ?), ce souci d’intégration renvoie à l’objet maternel et, sur cette lignée, quelques singularités interpellent immédiatement, ne serait-ce que ce choix du pseudonyme qui recouvre le récit dès la page de garde : Céline, prénom de sa grand-mère maternelle, un choix rare pour un homme, jusque-là d’état civil Louis Ferdinand Auguste Destouches (sans trait d’union). Il y a aussi la récurrence des femmes enceintes dans les romans, dont l’accouchement est invariablement problématique, ou abruptement dissimulé au lecteur; le fait que Céline soit médecin et que, surtout, il ait consacré sa thèse à Semmelweis. Il semble se désigner ainsi, dans le moteur de l’écriture, un axe tournant autour du féminin, peut-être plutôt autour du maternel, un maternel souvent grave, gravide, en voie pour une délivrance irrésistiblement ambiguë.
Suivre tout ce qui infiltre et soutient l’architecture célinienne s’avérant tâche impossible, nous nous permettons une citation, ce pastiche dans Mort à crédit : « j’ai eu souvent extrêmement soif près de la fontaine. Ma mère s’en est je crois aperçue, elle m’a donné encore deux francs. »1, ou comment la comédie infiltre le style, une intertextualité constante aussi, ici la référence à Villon, un matériel décalé dans la forme qui parle précisément du décalage, de l’inadéquation entre la mère et les besoins de l’enfant. Et, juste pour laisser entrevoir combien l’architecture célinienne est immense, cette reprise, couture dans le récit, à la toute fin l’oncle maternel qui chante : « Y a de la goutte à boire ».
Sur cette complexité, Alexandre Vialatte évoque « des cathédrales de vomissures qui se mirent dans des lacs de purin »2, toutefois, repliant le primat de l’oralité prônée par l’auteur sur le manifeste de l’analité débordante, Vialatte ne voit-il pas un peu juste ? Surtout, musclant notre capacité à lire, ce à quoi nous invite Céline, on découvre qu’il se trouve toujours quelques trouées, quelques étoiles dans la nuit : le voyage n’est pas fondamentalement aussi noir, ni si merdique, qu’il se laisse apparaître. Pour ces clartés, possiblement refusées, l’auteur utilise régulièrement des êtres, mère, grand-mère ou oncle, diverses choses mais toujours de qualités maternelles évidentes et, de manière constante dans les romans, le texte se clôt d’ailleurs sur une telle figure, un lien non plus avec la violence ou le nihilisme, avec une sexualité crue et débordante, un lien contrepoint avec une possibilité de tendresse. Comme, par exemple, lorsque Lili la compagne danseuse, en terminaison de Féérie pour une autre fois, lui demande enfin : « mon petit… où as-tu mal ? ».
Sa maîtrise est décrite par Céline comme une habilité à coudre des dentelles, évocation nostalgique suivant le décès de la mère en 1945 qui rappelle que celle-ci était couturière, spécialiste aussi des dentelles. Le vœu d’emprise sur son art contient logiquement l’emprise sur un objet absent, la mère après les pamphlets, le lecteur toujours. Dans son roman le moins fin, le premier, ce fil du roué Céline est préfiguré par l’image d’une corde, du bon bout pour tenir l’autre, en particulier lorsque Bardamu fascine Lola par la description du cancer du foie de sa mère à elle. Justement, le foie est l’organe qui se régénère : on en coupe un bout, ça repousse et, par-là, Prométhée se trouve éternellement enchaîné. Dans sa démétaphorisation, le ravalement du sentiment au niveau du plus organique, le narrateur célinien ne semble cesser d’évoquer un espoir qui reste en lui, en fait une foi, l’attente quoiqu’il en dise d’une tendresse qui pourrait bien exister, du moins son attente du tendre, et qu’il vaudrait mieux s’en moquer plutôt qu’en subir, en l’absence de réponse suffisamment accordée, les coup de becs malignement mortifères. Plus merdification que merde au fond, un espoir, une tendresse déçus.
La gerbe fantastique dont parle Vialatte apparaît d’ailleurs bien comme un procédé, Céline le confiant dans sa correspondance : « Et puis savoir ce que demande le lecteur […] Je choisis la direction adéquate, le sens indiqué par la flèche, obstinément. J’embrasse ma maman et mets du caca partout si cela amuse le public.»3. Cette flèche nous évoque le pictogramme décrit par Piera Aulagnier, le premier schéma relationnel de la rencontre sensorielle avec l’objet, l’« objet-zone complémentaire » qui aurait pu être crevasse, ou sembler ainsi sec.
Mais si l’origine paraît clairement posée par l’écrivain (premiers mots : « ça a débuté comme ça »), un mystère semble surtout totalement refermé sur lui-même : mystère de l’origine comme du but, on ne saura jamais ce qui est cause de l’engagement de Bardamu. Céline rejoint Kafka dans cette capacité à amplifier l’histoire à travers la mise en scène des effets persistants d’un mystère lui échappant inexorablement, une intrigue préalable dont on ignorerait tout, sauf qu’on se dirait qu’elle est non résolue et qu’elle continue à ébranler le sujet, et son lien au tendre.
Il y a toujours un mystère, on tourne autour, comme l’espèce d’antihéros célinien, et on décrit des cercles, qui ne sont pas les cercles des enfers, ou pas seulement, qui sont plutôt les strates de l’histoire, et pas seulement l’histoire de Ferdinand… on circule dans les strates de la littérature : d’une intertextualité puissante et incessante, on croise les classiques grecs et latins, Shakespeare, Dante et Rabelais, Villon, Montaigne bien sûr, plein… jusqu’à des contemporains, Proust le premier, et même Freud. Ce serait là comme l’expression d’un souci historique de Céline qui nous donne l’impression d’avoir substitué aux énigmes généalogiques l’ensemble de l’histoire littéraire (probablement des lectures auto-calmantes dans l’enfance).
A la question : comment vous écrivez ? Céline aura répondu le plus souvent « c’est mon secret ». Peut-être il faudrait penser que secret il y a, et pour Céline lui-même, et que son intranquillité, itérativement belliqueuse, autant que sa volonté d’empoigner l’histoire, seraient l’effet d’un mystère qu’il sentirait peser, intimement, sans en avoir lui-même la résolution. A ce point, évoquer un peu la biographie de l’écrivain permet surtout de constater qu’elle suscite plus de questions qu’elle n’apporte de solutions. La première interrogation (par exemple celle des pamphlets) c’est : « mais comment a-t-il pu faire ? », c’est même la question qui se répète, qui se décline tout du long, comme si l’œuvre écrite avait pris pour charge de faire chronique du mystère. Comment a-t-il pu ? tenir en lui-même le bon, le mauvais… mais avant ?
Comment a-t-il pu, lui fils de petits boutiquiers, sans éducation littéraire officielle, devenir cet écrivain aussi large ? Avant ça : comment a-t-il pu, lui qui avait plutôt peur des chevaux, s’engager volontairement à 18 ans tout juste au régiment de cavalerie. En 1912, ça va donc le tenir, douloureusement, jusqu’à la guerre. Comment a-t-il pu vivre l’expérience militaire et, surtout, se porter volontaire pour une mission extrêmement périlleuse, dans le contexte des premiers combats, une mission qui se termine par sa blessure au bras droit et une commotion cérébrale due au souffle de l’explosion d’obus.
Comment a-t-il pu noircir tant de pages avec ses séquelles ? La douleur réactivée du nerf de la guerre, son névrome (il est invalide à 75%), auquel il faut associer les vertiges plus ou moins liés à la commotion, les accès de fièvre aussi plus ou moins liés à un paludisme. Il faudra bien sûr parler de la transe de l’écriture chez Céline, quelque chose qui participerait de ces douleurs, les reprendrait, les raccommoderait.
Semblant vouloir initialement épouser la carrière de commerçant pensée pour lui par ses parents, comment a-t-il pu se lancer dans une carrière des plus aventureuses, jusqu’à l’inscription en médecine après avoir passé son bac, une détermination qui va lui permettre surtout de continuer à voyager alors qu’il aurait pu s’encotonner, à nouveau, dans un confort bourgeois. Comment a-t-il pu séduire d’ailleurs, si vite et si bien, le directeur de la faculté de médecine, sa famille entière, en épousant la fille au passage ? Il y a chez Céline, celui qu’on connaîtra plus tard révolté et abject, il y a du moins chez le jeune Destouches des capacités adaptatives absolument étonnantes, un conformisme même dans sa jeunesse, une enfance régulièrement sentencieuse telle qu’elle apparaît dans ses premières lettres.
Bien plus tard… comment a-t-il pu manquer le Goncourt ? Il était allé devant chez Drouant avec dans la poche le hochet de son enfance, qu’il aurait jeté par terre à l’annonce du résultat. Un doudou en dur… le dur désir de durer dans le regard de l’autre ? La rage semble conséquence d’une quête de reconnaissance échouée, d’un regard toujours insuffisant parce que pas accordé à l’intensité de l’attente ; hochet jeté et brisé ne pouvant dans cette frustration faire jeu de bobine, partir-revenir en tamisage des angoisses abandonniques. Enfin la question n’est pas de manquer le Goncourt, c’est plutôt comment a-t-il pu, d’emblée, avec son premier roman, faire une telle bombe ?
Avant de retomber sur la question des pamphlets, nous relèverons, effectuant un retour sur la bombe, l’embrasement, qu’un de ces « comment a-t-il pu ? » n’est pas singulier à Céline : c’est la question que pose la fameuse fleur au fusil, l’érotisation dans la violence fondamentale, dans le meurtre et le suicide certainement. En 1914, Céline s’est donc porté volontaire, en cette plaine du nord totalement dégagée, sous la mitraille allemande, il part seul, porteur entre deux unités mobiles d’un ordre de liaison. Logiquement, ça ne pardonne pas, donc blessure, mutilation. Le futur écrivain a-t-il fait une TS ? Tentative de Suicide, ou Tentative de Sortie ? nous penserions aux deux, en même temps. L’homme se tue déjà à la tâche, celle de son propre conformisme qui rejoint l’ordre social de cette époque ; il échouerait dans son suicide, mais s’en dégageraient des stratégies adaptatives qui le mutilaient. Dès lors, ce seront les aventures effectivement : Destouches en roue libre, surtout devenant davantage lui-même, se raccordant par exemple dans ses aventures scientifiques à l’épistémophilie infantile, la médecine puis, ce sera contigu, la littérature qui fait Destouches devenir Céline.
Deuxième phrase du Voyage : « Moi j’avais jamais rien dit. Rien. », jusque-là Destouches n’avait rien dit (enfance sans histoire), maintenant il ne cessera de parler, enfin d’écrire. Derniers mots du Voyage : « qu’on en parle plus », toute l’œuvre est dans cet intervalle, l’œuvre semble intervalle même, comme trois points de suspension tenant l’équilibre entre l’impossibilité de se taire, le Céline prétendu chroniqueur, Céline toujours vivant, et la tentation du silence – en passant, trouver une issue entre l’impossibilité de se taire et l’envie du silence, on sait que c’est la problématique d’un enfant traumatisé.
Céline pratiquera une moquerie constante vis-à-vis du faux-self littéraire, les écrivains qu’il qualifie de « àlamanièrede ». Il se pose expert, comme s’il en connaissait bien quelque chose de ce faux : oui, la dimension chromo qu’il accuse rejoint le conformisme qu’il a pu un temps adopter dans sa famille. Et, dans les pamphlets les plus antisémites, on note une flagrante rechute, un vrai style « àlamanièrede » puisque l’auteur y effectue de réels copier-coller de la vulgate raciste de son époque (des pages et des pages qui ne seraient donc plus du « vrai » Céline au sens du « trouvé/créé » littéraire de Destouches).
Comment protéger et/ou se protéger ? la question est récurrente dans l’œuvre : recouvrir de projections diverses, de caca, de vomi, en un mot de haine, quelque chose, du plus tendre peut-être, un espoir irrésistible vis-à-vis de ce plus tendre, c’est ce qui semble se passer dans les romans mais, surtout, c’est ce qui s’organise dans l’œuvre elle-même. Comme si le réel de son agencement reprenait la contrainte qui incombe à Céline ou à Destouches, parce que cette contrainte remonterait à avant l’écriture. Ce que nous voulons désigner par là c’est bien que les pamphlets à partir de leur parution recouvrent l’œuvre, la merdifie. Et ça n’est pas seulement Voyage, Mort à crédit et les autres romans qu’on ne peut plus lire de la même manière, l’écriture pamphlétaire a directement oblitéré, et même mutilé, un récit sur lequel Céline travaillait tandis qu’il a été pris dans sa « folie raciste » (dit par lui-même dans l’Ecole des cadavres). Ce roman perdu, nous en avons quelques pages et on y retrouve la figure maternelle.
Mais sur la mutilation, comme inexorable dans la geste célinienne, ce négatif extrême, il faut quand même évoquer Semmelweis, la thèse de médecine. Beaucoup de pages en sont troublantes, pas seulement au sujet d’une vocation hygiéniste qui fera retour au sein des pamphlets, surtout, en appui sur le mythe romantique du médecin brûlé à son propre génie, dans la préfiguration par l’étudiant Destouches du destin de l’écrivain Céline. Par exemple cette conclusion : « nous devons à la vérité signaler un grand défaut de Semmelweis : celui d’être brutal en tout et surtout pour lui-même (… 🙂 l’enfer commence aux portes de notre raison… la douce impuissance de nos esprits, cette heureuse prison des sens nous protège d’une intelligence infinie… »4
Sujet de la thèse : si Semmelweis avait été un tendre, s’il avait connu suffisamment bien pour l’intérioriser la tendresse (le portrait de la mère de Semmelweis est celui d’une mère opératoire et, bien vite, mère morte), ce négatif en forme d’inhibition quant au but, « douce impuissance », il aurait mieux réussi… oui mais… sa quête intellectuelle serait-elle passée par cette interrogation sur l’agonie des mères ? En tous cas, le docteur Destouches évoque la nécessité pour la raison de s’établir sur ce manque bien tempéré, négatif structurant et non pas, surtout pas, une excitation sans frein, un négatif hors duquel l’absolu sera embrasement : de ne pouvoir être freiné à l’intérieur, coupé (en voie terminale, structuration du fantasme de castration), Semmelweis en vient à se couper lui-même, achevant sur lui ce négatif qui n’aura pu se structurer autrement.
Semmelweis annonce Céline, la thèse est prétexte tant la mutilation apparaît centrale dans la suite de l’œuvre, celle-ci qui ne pouvait sans doute pas exister sans elle, même si on aurait souhaité que le négatif de l’auteur soit moins térébrant, que son besoin d’interrompre, de décrocher, reste par exemple contenu dans ses fameux points de suspension qui ne cessent de marquer la page. Remarquablement, le mot chez Céline est toujours à la fois large et précis, le roman auquel les pamphlets ont cassé la pipe devait s’appeler Casse-pipe (principe agonique de condensation : en même temps allusion morbide et libidinale).
Et le fragment conservé correspond fidèlement à l’histoire « j’embrasse ma maman et je mets du caca partout ». L’auteur décrit le début de son incorporation dans un régiment de cavalerie, il faut relever des hommes de garde mais le brigadier a perdu le mot de passe ; les soldats se planquent dans la chaude moiteur d’une écurie ; tous s’amoncellent dans le crottin et le foin pour une agonie liée à l’oubli du verbe, la perte des acquisitions symboliques, une régression jusqu’au boutiste, intra-utérine, confort devenant suffocant. Dans le fond du caca, tandis qu’on pense à s’en dégager, à l’expulsion… d’un coup un soldat s’embrase. Céline nous décrit, encore une fois, une transe, ce qui semblera s’avérer une crise d’épilepsie ; le planton gémit, le son mmm, puis « Maman… Mar… gue… rite », le brigadier exulte alors de reconnaître le mot de passe. Une page plus loin, les hommes doutent, même si c’est bien le mot, pourquoi Marguerite ? « encore un nom de putain » conclut l’un d’eux. Marguerite, c’est précisément le prénom de la mère de l’écrivain, mère qui est rabaissée, de la manière la plus générale, mais mère qui est néanmoins vitale : mot de passe, langue maternelle dans ses déterminants les plus intimes d’indifférencier corps et verbe. On retrouve l’ambiguïté célinienne et, aussi, combien cet auteur peut être précieux, à travers le fumier certes, de nous permettre de penser cette complexité indéterminant si c’est le fait d’avoir perdu la mère, le mot, qui fait s’embraser, ou bien si, au contraire, c’est le fait de la posséder.
Casse-Pipe nous préciserait l’originaire de la mutilation ou de l’embrasement, dans le manque maternel autant que dans sa possession. Céline c’est des histoires de bombardements, bien sûr… mais il ramène tant de choses, l’histoire de la littérature, son histoire à lui, les filets sont tellement larges que, au fond, il s’agit peut-être effectivement de reprendre un embrasement plus intime. C’est trop pour qu’on n’interroge pas le très jeune Destouches, celui là qu’a-t-il dans son barda ? qui le met comme ça en branle et qui aura été précédemment recouvert d’avoir sans doute paru trop menaçant? D’un lien à la tendresse frustrée, l’hypersexualisation ?
Barda mû de ne pouvoir être barde d’amour ?
Pour débrouiller cette énième interrogation, regardons la besace qu’il trimballe durant son périple entre l’Allemagne et le Danemark (dans Rigodon), il s’y trouve Bébert, le chat traité comme un enfant. Celui-ci est bercé dans cette musette mystérieuse, petit barda à secret qui contient un double fond sous l’animal. Là un compartiment pour les vrais passeports, le livret de mariage et 4 ampoules de cyanure, ce que précise Céline à la fin puis, deux pages plus loin, un nouvel objet semblant encore plus secret : un pistolet. Des objets planqués par devers lui par le bébé Bébert, qui entremêlent les thèmes de l’identité, du lien et de la mort, d’une mort équivalant dans ce contexte à une délivrance, là encore référence à l’accouchement, l’irrésistible ambiguïté de l’œuvre comme posée sur fond originaire d’un court-circuit mort-vie. Ici un détail dans le détail, le pistolet : de quelle marque ? C’est un Mauser, figure maternelle et possibilité assassine de délivrance à jamais renfermées dans le barda.
Bébert dont le nom rappelle l’enfant mort, le jeune Bébert dans Voyage au Bout de la Nuit, encore un enfant dont la filiation n’est jamais explicitée, comme plus tard le chat recueilli, cet enfant présenté ainsi : « teint trop verdâtre, pomme qui ne mûrira jamais »5. Céline serait celui qui nous entretient du traumatisme précoce tel que S. Ferenczi va le théoriser dans son article Confusion de langue, en 1932 précisément l’année de parution du Voyage ; l’analyste qui évoque l’enfant abusé comme un fruit gâté, l’écrivain qui filera, lui, tant de figures d’une corruption de la tendresse et/ou de l’infantile par la sexualité – ne serait-ce que parce que le tendre, comme contenant premier, aura manqué. Trop vert, l’enfant Bébert meurt à 7 ans, à peu près l’âge de Ferdinand lors de l’abus sexuel allégué dans son deuxième roman Mort à crédit.
L’embrasement, la bombe… jusqu’à la traumatophilie de se retrouver cap au pire, l’obsession célinienne pourrait lever un coin de son mystère en y accolant la figuration maternelle et le trauma voire l’abus. Comme le train en temps de guerre, Céline c’est « l’affecté très spécial », surtout c’est l’agonique, comme il le dit lui-même. Tout se passe comme si l’auteur, le narrateur nous parlait d’un beaucoup trop, une agonie plus qu’une mort, mille morts dans la chair vivante qui la morcellent en autant de fragments, ce moment, cette bascule entre l’hallucination vibrante et son épuisement (temps d’exacerbation avant le retrait autistique secondaire dans le détachement absolu de la relation d’objet frustrée, ce triomphe du négatif destructurant décrit par R. Spitz). Ce serait la racine du naturalisme fantastique de l’auteur : quelque chose, non pas de vide, mais d’un trop plein d’excitation, engrammé chez Ferdinand, un trop plein en risque de débordement bien sûr mais aussi de rupture et d’épuisement, un trop plein interne dont l’évolution naturelle serait le désespoir, un nihilisme aussi intense et violent que l’excitation pouvait l’être, désespoir qui pourrait se raffiner jusqu’à l’autisme et qu’il faudrait surtout contrecarrer au prix de devoir se concentrer plutôt sur l’embrasement.
Nous l’avons dit ailleurs6, pour ce qui concerne le fonctionnement limite (notamment : prédominance du fétichisme sur le transitionnel, pauvreté structurelle des aires intermédiaires, carence d’organisation des fantasmes originaires, manque d’une structuration de l’angoisse comme signal d’alerte, récurrences traumatiques), une nosographie étiologique de Traumatisme Complexe nous apparaît moins pertinente que la notion que nous proposons d’un Complexe Traumatique où la perspective s’inverse : la cicatrice, comme structuration fibreuse des fantasmes originaires, précède le coup du trauma. C’est l’hypothèse d’un traumatisme « toujours déjà là », avec des points d’appui inter et transgénérationnels, tellement de points qu’ils entraînent le sujet – comme le lecteur est entraîné par le style célinien – qu’ils se constituent en lignée générant cette trajectoire limite, c’est-à-dire amenant le sujet à devoir se retrouver dans le traumatique. Le bâton, celui du relai de la transmission des représentations de transmission, celui des constructions originaires, est cassé bien antérieurement à l’avènement de ce sujet lequel en ressent, comme un cal vicieux, le rafistolage énigmatique dans l’union parentale. Céline, tant le parcours de l’homme et ses contradictions et ambiguïtés, que le style de l’écrivain, constituerait la démonstration de ce complexe traumatique. En retour, la théorisation du complexe, l’attention envers l’entente originaire préalable au sujet, mère et père, comment ils s’accordent dans le « filage » de leur propre trauma, permet d’avancer quelques hypothèses nouvelles sur l’homme et son œuvre.
A propos de trauma, il semble d’abord naturel de dériver de l’obus, reçu en 14, vers l’abus (de l’o vers l’a, queue en haut et activité, versus queue en bas et passivité). Ici, il ne peut y avoir que des conjectures mais on peut lire Mort à crédit comme un document clinique, le témoignage d’un enfant maltraité psychiquement, également sexuellement. Toutefois… l’hypothèse de l’abus paraît encore insuffisante pour tenter d’expliquer l’énigmatique trajectoire célinienne. Il faudrait conjecturer sur le contenant le plus primaire, celui qui engage effectivement la mère et l’établissement du courant tendre. Regarder vers la mère d’autant plus que le père est traité comme un enfant dans l’œuvre et que différents détails biographiques nous le laissent imaginer ainsi ; comme Marguerite, lui aussi il perd son propre père avant l’adolescence, racine peut-être d’une difficulté pour Fernand Destouches à tenir l’incarnation paternelle. Au sein d’un domicile conjugal marqué de sa disqualification par la grand-mère Céline, l’objet de l’objet ne paraît s’être pas constitué pour le futur écrivain dans la voie d’une identification soutenante lui permettant de ne pas rester en prise avec l’objet archaïque. Conséquemment, toute écartade de celui-ci ne pouvait être vécu que comme un manque non seulement pour lui mais de lui : si mon objet n’a aucun objet sérieux qui l’attire, et bien si cet objet s’écarte de moi c’est que vraiment je suis incapable de le retenir, je suis un moins que rien (expression du négatif le plus mortifère), je suis une merde, pas loin sur cette rétroversion de l’équation symbolique (en principe fèces = cadeau = pénis = enfant), un déchet, un toxique.
L’objet de la mère c’était les dentelles, donc ce mélange de vide et de plein dans le tissu qui illustre remarquablement la condensation d’ambiguïté du complexe traumatique. Par commodité, parce qu’il s’agit de décrire (ce que n’entreprend pas de faire Céline, son style étant donc plus « parlant » sur le trauma), nous devons d’abord choisir une de ces dimensions antagonistes et, selon une habitude (la carence, le défaut fondamental, les angoisses agoniques…), c’est le vide qui est privilégié, ici la mutilation. Ce thème est accolé à la mère qui, de par sa boiterie, va à cloche-pied, l’auteur en donnant le rythme au début de Mort à Crédit : «Ta ! pas ! tam ! Ta ! pas ! tam ! »7 … t’as pas ta maman, voilà ce qui s’entend donc, ce manque qui pousse à l’excitation, à l’hallucination, à la transe puis au désespoir, au décrochage, à la mutilation encore… à moins de l’accuser et d’en constituer (féérie ?) le rythme même de l’écriture.
Du côté de la mère, de ce qui l’aurait rendu préoccupée, s’il s’évoque un éminent transgénérationnel, c’est toujours de la dentelle (encore et déjà : le temps du complexe qui ne passe pas), c’est la robe de baptême du roi de Rome qui symbolise assez bien le poids du narcissisme parental et le malheur afférent, la perte de l’enfant. Le petit Louis aurait été baptisé dans cette tunique précieuse, sa grand-mère Céline, antiquaire, en ayant la possession. On rappellera que ce Napoléon II avait dû renier ses parents, qu’il meurt à 21 ans de tuberculose durant son service militaire. Céline lui sera dans sa 21ème année quand il prend cette balle et ces obus qui dévient sa destinée. Bon… tout ceci ce sont des images, comme la dentelle qui rappelle l’écriture célinienne. Que faire de ces concordances ? Au moins en relever le narcissisme maternel et grand-maternel projeté sur le petit, en même temps relever que quelque chose confirme ce narcissisme dans une impasse négative (Choiseul devient Passage Bérézina dans Mort à crédit). C’est le fait que, à côté de cet investissement grandiose de l’enfant unique, Louis est éloigné de ses parents, de sa mère en particulier pour protéger la santé de celle-ci, ceci durant ses trois premières années. On craignait que l’enfant ne fasse rechuter la poliomyélite maternelle dont la séquelle était la fameuse boiterie. A la fois enfant roi et pas un cadeau donc, plutôt un toxique, ici se repère la dramatique équation symbolique qui, pour nous, marque l’originaire du complexe traumatique.
Début de Mort à crédit, Céline évoque sa naissance comme un Narcisse, comme celle du Roi de Rome si on veut : « je suis né en mai. C’est moi le printemps ». Narcisse tragique, quelque lignes plus loin, la grande dégradation, aussi bas qu’il aurait pu être aussi haut, la fleur maladive s’absout dans la pourriture mélancoliforme : « je suis navrant et je m’adore autant que la Seine est pourrie »8. On peut lire aussi scène, primitive, qui génère du toxique et qui est toxique : le Passage Choiseul immuablement décrit comme cloche à gaz inscrit dans l’œuvre le fantasme de la contamination/transmission toxique.
La mère inaccessible, peut-être secrètement mélancolique depuis la perte de son père à 11 ans (l’âge où finit l’enfance dans Les beaux draps), cette mère à la bobine désaffectivée suscite chez son petit le besoin d’agripper, le besoin de comprendre au plus démétaphorisé, le besoin de suivre. S’identifier, ou plutôt incorporer, avaler la mère absente, c’est moyen de la garder et de s’enchaîner dans une fidélité mutuelle : à la vie à la mort. Céline ranime, souvent à sa manière qui engage violence, de contenir aussi en lui une mère agonique et ses récurrences explosives sont Destouches projeté, l’agonique en lui animé sur page blanche (affaire de digestion : passant de tout dévorer à tout transformer).
Encore une fois, lâcher l’enfant après l’avoir traité comme un roi, même si roi de Rome, c’est déjà abuser. C’est frustrer la tendresse au bénéfice d’une excitation, celle du manque, de l’avidité qui fait enrager, qui déborde, qui mutile en l’absence de réponse. Manque qui peut faire le lit d’autres abus, ainsi se constitue, ou plutôt se fortifie le complexe traumatique : l’enfant qui n’a pas été bien contenu, bien protégé, ne sait pas comment se protéger d’autant plus qu’il a en lui cette excitation dont il ne sait pas que faire (il la range d’abord sous le couvercle du faux-self, empruntant l’Idéal des autres pour, sans faire trop de bruits, continuer d’être dans leur regard).
En passant, ce n’est bien sûr pas parce qu’on penserait le traumatique comme dynamique continue, qu’il ne faudrait pas reconnaître l’à-coup traumatique, tel un abus sur une trajectoire déjà marquée, (qu’il ne faudrait pas par exemple reconnaître un enfant, un ado victime à nouveau). C’est peut-être effectivement le manque de reconnaissance après la révélation des abus dans Mort à crédit qui pousse Céline vers davantage de rage encore, c’est-à-dire vers les pamphlets. Ce manque nous le situerions volontiers comme lié à la formulation codée que l’ancien enfant traumatisé emploie (cas régulier des confidences prises entre la tentation du silence et l’envie de hurler), ambiguïté stylistique inexorablement réactivatrice du mépris des besoins primaires de reconnaissance et, de plus, nous pouvons penser que ce manque aura activé puissamment celui du père, décédé peu avant la publication du premier roman, père qui n’aura donc jamais vu cet écrivain qu’allait devenir Louis. Alors que Céline s’est résolument moqué de l’antisémitisme paternel dans Mort à crédit, c’est pourtant ce discours qu’il reprend quelques mois après la réception critique du roman, semblant canaliser l’agressivité vers un autre objet et le saisir pour se ressaisir lui. Grande gueule ouverte d’une incorporation mélancoliforme, ou plus mélancolique (plus pleine, plus noire) via l’incorporation du dur du père, notamment son racisme, pour se déprendre du « plus vide » représentatif, ou « plus embrasé », rencontré avec la mère et réactivé par la réception critique en demi-teinte et la hantise de la guerre à revenir.
Le hochet dans la poche nous évoque la contrainte à tenir un objet suffisamment dur là où la bobine doudou n’a pu s’installer avec sa qualité de souplesse alliée à la solidité, le fétichisme supplantant le transitionnel inatteignable (sur la base d’un autoérotisme, ce tendre, en carence : au moins la capacité de rêverie maternelle). Nous nous méfions pourtant de nous enferrer sur certains clichés en désignant surtout la mère dans le manque excité du futur écrivain : surtout la forte désignation par Céline des figures maternelles, l’auteur nous ayant prévenu qu’il est menteur (comme son père donc, celui-ci qualifié ainsi par une voisine jalouse dans Mort à crédit) nous conduit à ne pas mésestimer l’attente du père, d’autant plus que l’hypothèse du complexe traumatique, son amplification transgénérationnelle des difficultés à structurer les fantasmes originaires, nous stimule à réfléchir davantage sur l’accordage du couple parental, ce que chacun trouve chez l’autre pour maintenir le silence, nous entraîne même à repérer dans les fameux points de suspension célinien une dynamique qui pourrait avoir affaire avec le recouvrement d’un secret familial du côté paternel.
Falot ce père ? Ne serait-ce pas trop croire la grand-mère maternelle, et/ou la hantise par son fils du lien homosexuel ? Les photographies cependant le montrent portant bien beau et, comme le sera son fils, lui aussi est passionné des bateaux ; il possèdera aussi deux esquifs (argent hérité à la mort de la grand-mère : à malin, malin et demi ?), modeste canotage sans doute, mais qu’on imagine joyeux, loin de Choiseul, du bureau et des boutiques. Il aurait apprécié aussi les danseuses…
La mère à séduire, retenir, agresser, secouer, à réanimer, à coup de mots-choses, raconter pour empêcher la mort quitte à se figer sur l’agonie, ce portrait de Céline en Shéhérazade, il nous paraît bien possible qu’un identique mouvement s’adresse en même temps au père. L’interpeller lui aussi, le solliciter à voir : le « en même temps » désignerait deux unités mobiles, mère dans son opératoire autant que père dans ses plaisirs solitaires, vis-à-vis desquelles l’enfant aurait comme l’ordre, l’impératif, de tenter une nouvelle opération de liaison.
D’ailleurs ce père, par petites touches dans l’œuvre, n’est pas aussi minable que ça. Ses qualités peuvent même engager un manifeste trait d’identification avec le fils écrivain (monter des bateaux). Ses danseuses ? Discrétion… sur ce point on se rappelle que, dans la taxinomie célinienne des beautés féminines, une très belle femme (souvent une danseuse) sera désignée comme un « trois-mâts ». Père contre-modèle ? le sujet paraît bien plus mystérieux, c’est comme si Céline voulait faire tomber son père au sens de le faire dégringoler (sa grande dérouillée dans Mort à crédit) mais aussi, en même temps, au sens de pouvoir enfin le rencontrer, et vraiment : être le tombeur de son père, le séduire.
Dans Nord, écrit presque trente ans après Voyage et sa référence au père qui ne regarde jamais sa famille, un extrait du poème de Goethe Le Roi des Aulnes est cité comme un leitmotiv : « ô Vater, ô Vater », seul ce début de strophe. Référence classique d’un père ne s’apercevant pas que son enfant est touché par le Roi des Aulnes, une instance pédophile, et que l’enfant meurt dans ses bras parce qu’il n’a pas vu, ou pas voulu voir. Père, père ne vois-tu rien ? ainsi Céline ne cesserait de s’adresser aussi à lui. Par quoi Céline est-il touché, hanté ? un abus précoce ? conjecture… un ou plusieurs fantômes (l’incorporation d’un objet absent aux besoins) ? probablement.
Un aïeul ? Que Destouches s’appelle Céline peut faire penser bien des choses : qu’il veut réactiver un maternel qui pourrait se permettre d’être plus libéral parce qu’il y a là, du fait de l’âge, une naturelle supériorité de la tendresse sur le sensuel, d’où moins d’inhibitions réciproques. Que l’écrivain fait survivre sa grand-mère, bien sûr, qu’il l’entretient, elle comme sa moquerie plus ou moins rageuse du père mais, en même temps, qu’il protège aussi le nom du père d’une œuvre liée d’emblée à la violence et à la haine dont Céline sent bien qu’il recevra coup pour coup. La retenir également parce qu’il s’y tiendrait comme un savoir du dessus sur la mère : grand-mère préfiguration des personnages récurrents de concierges, maîtresses des clefs et des secrets, en sachant en principe plus sur l’ascendance généalogique que les parents eux-mêmes. Se hisser pour distinguer enfin une solution au mystère originaire ?
C’est le détail rétrospectif de la course du complexe traumatique que de nous ramener toujours à cette question : avant ? sans résolution, comme on l’a vu à propos des contradictions dans la biographie de l’auteur, comme on l’a considéré dans son style même, constitué d’un ébranlement persistant du sens sans que la cause véritable ne soit donnée. Un autre aïeul encore? On en trouve un, et rien de moins qu’un maître de la terreur mis au secret. Céline en connaissait-il l’existence ? Aucune évocation ne permet de l’attester. Aurait-il pu être « parlé » par cet ancêtre ? C’est une idée qui tente, notamment lorsqu’on relève l’étonnant début de sa thèse, consacré de manière hors sujet à une petite histoire pleine de sauvagerie de la révolution française (inaugural, du pur Céline).
Dans l’arbre généalogique du père, Thomas Destouches est arrière-arrière grand-père de Louis (trisaïeul donc), ce fut un des administrateurs du Morbihan sous la Terreur9. D’une discussion avec l’historien Gaël Richard, il ressort que Céline n’a probablement pas eu accès aux papiers de famille le concernant, lesquels auraient pu être mis au secret par son fils Clément Destouches (1800-1884), cet arrière-grand-père décédé à Lorient dix années avant la naissance de l’écrivain. Le fils de Clément, Auguste, mort au Havre en 1870, semble avoir entrepris une recherche de repères généalogiques ; les papiers conservés par lui et transmis à Fernand, puis à Louis-Ferdinand, étaient cependant orientés sur la piste d’une hypothétique et autrement glorieuse noblesse, celle de la figure historico-littéraire du Chevalier Destouches.
Il n’est pas précisé dans les biographies ou les études familiales succinctes un quelconque état des relations du père de Céline avec son grand-père lequel avait survécu à Auguste et qu’on imaginerait avoir été sollicité par la situation de son jeune petit-fils. Nous relevons là une mystérieuse absence de lien, superposable en quelque sorte au « blanc » entre Thomas et Clément, à la place de quelque chose qui aurait pu/dû être plus plein. L’hypothèse suivie ici est qu’une répétition de ce genre de vide fait partie de la lignée Destouches, qu’elle s’impose à elle tout en stimulant une recherche qui recouvre d’autant plus l’énigme – comme ce déplacement de l’interrogation originaire vers une mythologie littéraire (comme, dans l’œuvre, l’absentification des repères généalogiques renvoie Bébert à l’histoire littéraire, d’abord dans le récit célinien lui-même : du chat à l’enfant de Voyage, et de celui-ci vers une figure agonique d’abord inventée par Zola).
La complexité de l’écriture dans laquelle se « débobinent », passé le trop de merdification des écuries d’Augias, quelques étoiles maternelles en creux, nous laisse à penser que du trop réside peut-être encore dans ces fanaux que nous avons suivis et que, derrière ceux-ci, se tient peut-être la continuation d’une œuvre paternelle de recouvrement. L’ambiguïté serait ancienne, portée par des points de suspension déjà « trouvés » par l’arrière grand-père Clément et le grand-père Auguste, soit une interruption de la lignée par quelque chose qui tout autant propulse l’imagination (Auguste déviant le regard vers la chouannerie et la littérature). La musette Bébert : l’enfant qui protège en l’ignorant un fond secret.
Il se conçoit aussi, facilement, que le plus impérieusement contraignant n’est pas dans une telle dynamique de révéler le fameux secret… mais de pouvoir s’extraire vis-à-vis d’une énigme qui pèse et fascine obscurément l’esprit, « mettre les voiles » (contrainte répétée par Céline, qui ranime aussi un goût partagé avec son père). Filer, mot d’ambiguïté : à la fois fuir et suivre, le narrateur célinien file sa bobine énigmatique, plus qu’il ne peut se défiler. Ainsi le père pouvait être lui-même occupé, incorporé, préoccupé des pères avant lui, et absent à certains besoins de son petit. Père, père, ne vois-tu rien ? Dynamique du talion : l’écrivain semblera mettre son père loin, et l’ensemble des pères, comme il aurait pu se sentir mis loin par lui tandis que l’attente s’en faisait plus sentir pour apaiser l’excitation mortifère liée au maternel.
L’objectif récurrent du rassemblement, le mot de passe qui tient ensemble libido et destrudo, nous ramène à la question de l’extraction : comment passer à autre chose ? La dynamique transgénérationnelle que nous qualifions de complexe traumatique semble pointer pour seule possibilité de filer à quelqu’un : au lecteur ? L’impératif de l’écrivain n’est pas seulement comment s’en sortir, c’est surtout : comment jouir quand même du verbe ? Céline répond en ayant une écriture qui soit une transe, bien périlleuse d’être tout autant véhicule traumatique, principe de continuité ou plutôt de fidélité au trauma et à l’énigme originaire, qu’un véhicule qui fasse se sentir mieux (à la manière, oui, des hypno-thérapeutes). Transe dont on connaît aussi le pouvoir saisissant. Rappelons cette histoire mythomaniaque, sa trépanation après la blessure de 14, qu’il aurait surtout gardé dans le crâne un morceau de fer, éclat de projectile ; le sentir, se représenter de fait l’incorporation et le métal comme une mère dure et froide, l’œuvre se constituant entreprise d’excoriation du Mauser autant que réversion des emprises. C’est l’autre qui va la sentir : « Le lecteur qui me lit ! il lui semble, il en jurerait, que quelqu’un lui lit dans la tête !… dans sa propre tête !… »10, Céline nous passe la balle.
Il nous embobine ainsi, à son tour. Ecrivain pervers ? Dans sa grossièreté, c’est-à-dire dans son évidence, Céline ne nous parle que de ce que c’est la littérature et de ce que c’est que d’écrire. Enfermer les lecteurs dans le métro… oui, mais… c’est qu’il s’agit surtout d’empêcher le déraillement, d’empêcher la folie qui fait sortir du sillon, contenir tous ceux-là, les fragments en fait, et les amener à meilleur port. Céline parle du lecteur autant qu’il parle de lui, dans l’ombre confondante peut-être primairement une mère absente qu’il faut tenter d’agripper, la diriger enfin dans son sens, dans ses sens, sinon c’est l’agonie. Un tout petit qui, de sa main, cherche à agripper le menton de maman pour la rediriger vers lui : avoir un meilleur port, voilà la petite clinique énorme dont nous cause Céline.
A la fin de l’œuvre, « la butte qui fait cloche », dans Rigodon le terme vrai, ce parcours anatomique de retour intra-utérin où Céline croise même les traces du père, du moins peut-on distinguer, avec cet « épicier cadavre qui perd ses boyaux dans la glaise »11, les traces spermatiques paternelles que l’auteur dépasse pour se saisir du fond. L’interrogation Avant ? est magistralement devenu En avant ! Céline remontant très loin, très dedans, son écriture tournée, comme la chienne Bessy, vers un originaire à reconstruire autant qu’à réanimer. L’auteur, expert es régression, se pose phénomène du contre-courant, c’est-à-dire jusqu’à l’utérus, libidinalisation qui reprend surtout l’envie d’être bien dans la tête de maman (au-moins celle-ci).
Sauf que… le matériel recherché n’est pas dans le verbe : but inaccessible autant qu’ombilic irrésistible. L’écriture ne résout pas l’énigme, puisque celle-ci, du trop plein avec du trop vide, du trop chaud en même temps que du trop froid, embobinée déjà aux étages grands-parentaux, sa résolution ne saurait être dans le verbe, d’où l’ambivalence quant à la langue même (telle qu’on peut la lire chez Beckett), ambivalence qui peut-être fait partie de la tache de l’écrivain, enfin de celui qui va faire Job d’écrire. Ceci chez Céline : « nous avec la tête pleine de mots, effrayant le mal qu’on se donne pour s’emberlifiquer en pire ! plus rien savoir !… tout barafouiller, rien saisir !... »12, l’inventivité verbale est notable, qui fait contraste avec le constat d’échec, barafouiller par exemple… mais c’est le constat d’échec qui aiguillonne la création, qui la relance encore et toujours. Ainsi se comprend aussi ce mouvement « toujours plus » chez Céline.
Ça fait mal, et l’agressivité est centrale dans l’écriture, même si la haine est secondaire. C’est bien sûr une volonté d’emprise, c’est bien sûr l’inaccessibilité du but qui nourrit la haine autant que la sensation confuse du trauma. La haine est utilisée par Céline, c’est aussi son tour de force, elle est utilisée dans la direction de l’écriture c’est-à-dire dans la direction de la régression pour mieux toucher, fouiller. Elle est contiguë au comique, là où Céline est aussi doué, haine et comique étant également antésocial, de subvertir un ordre établi pour diriger puissamment l’attention vers celui qui s’exprime : c’est encore un ordre de liaison pour des unités mobiles prêtes à s’écarter.
Soutenir que cette écriture est une transe vise d’abord à rappeler que l’étymologie de transe (transir, aller à travers) renvoie encore à l’agonie (en-corps). Et Guignol’s band sera d’autant plus le grand roman de la transe, jusqu’au déséquilibre, que l’auteur entreprend, après la décharge pamphlétaire, d’y gravir/graver à nouveau les pentes de la littérature. Définition d’un trouvé/créé, auto-friction, « je m’iragine »13 écrit Céline qui se met à bouillir (récit en anagramme de migraine), à s’enfièvrer, à s’halluciner. Il se met dans un état de fusion, au risque de la confusion bien sûr, et cette fusion est fantasmatiquement, mais au plus près des éprouvés corporels sollicités par les douleurs multiples, un retour intra-utérin ou plutôt une inclusion dans une unité corporéisée devenue par l’épreuve plus vaste que lui. C’est de là qu’il écrit, pour résoudre son mystère même si, des mots aux plus près des choses, il ne fera que recouvrir au lieu de recouvrer, drame qui constitue à la fois l’aiguillon excitant de sa recherche et la perpétuation de la frustration.
La fascination pour les bêtes, les ondes, les danseuses… renvoie à la recherche de ce véhicule plus puissant que le verbe, plus apte à saisir un matériel (« fleur du secret » est-il dit dans Guignol’s band) enserrant ce traumatique qui date d’avant mais encaissé comme cristallisé au point agonique originaire. « L’émotion du langage parlé à travers l’écrit », Céline l’a assez dit, ce qu’on range souvent dans une élévation à peu près inédite du langage populaire dans la langue littéraire, alimentant là encore une méprise possible, voire le refoulement collectif. La tectonique célinienne est autrement plus compliquée : quel populo parle ou a parlé comme lui ? Il n’y a pas qu’une langue chez Céline, sa tectonique affronte quantités de niveaux différents, de langues et de littératures. De l’abus, notamment sexuel, ne serait-ce que par manque premier de tendre, Céline a pu devenir un abuseur textuel. C’est là la patte de l’auteur, il saisit tout, son avidité le fait agripper tout, y compris le populo. Il lui faut surtout être au plus près du corps, reprendre l’affect au plus près de sa source, démétaphorisation nécessaire d’un style poussé de mots-choses. Et tenir le lecteur pour se tenir lui, Céline, qui n’écrit en fait que sur son être de papier, s’acharnant à rassembler ses fragments, comme ces enfants agoniques de Rigodon (lorsque l’officier les compte, il s’en trouve un de plus par rapport à l’énumération précédemment effectuée par le narrateur : un de trop ? L’auteur lui-même qui s’est rassemblé)14.
Qui est l’interlocuteur que Céline harangue incessamment ? Du limon d’une séduction originaire mutilée, ses parents qui ne pouvaient jouer avec lui, Céline a ce besoin du lecteur, frère lecteur qui pourrait extraire la pierre de folie mais, surtout, constater le trauma, devenir frère un peu petite mère : quelqu’un qui va faire le job avec lui, penser les pensées, mettre du lien entre des unités mobiles. Alliée à cette complicité herméneutique active recherchée chez son lecteur, il se trouve aussi un principe de discontinuité dans l’écriture qui renforce l’accordage à notre capacité de rêverie : sa bobine nous parle puisque la discontinuité, ces ruptures, ne rendent pas forcément compte d’une agonie aussi dramatique que le complexe traumatique indique. Après tout le négatif, la suspension est en chacun de nous : le fond de notre être est hallucinatoire, pulsionnel, sauvage qui pousse à la décharge, il faut bien que des barrières s’érigent pour que nous soyons ce que nous sommes, en somme. Notre pensée est heureusement discontinue, ce qui lui permet l’espace disponible pour l’imagination (et le regret), et le style célinien trouve sa force de s’accorder à ce niveau-là. Ainsi ce négatif peut devenir un trait d’union, pour nous la visée célinienne originaire.
Ce n’est pas dans le seul excès que l’auteur est le meilleur (voir les pamphlets) : c’est précisément dans un excès suffisamment tamisé. La « trouvaille » des trois points est celle d’un pivot positivant le négatif célinien en fractionnant ses embrasements (on travaille mieux sur de petites quantités). Nous « entendons » ces trois points comme les coups sur le plancher de la salle de danse de Lucette à l’étage juste au-dessus du bureau d’écriture, comme des bruits rythmiques qui ponctuaient la transe dans laquelle Céline se plongeait au risque de se vautrer.
Alors entre les trois points, encadrée effectivement, la pâte littéraire, tous les jeux et toutes les combinaisons, tous les croisements, toutes les hybridations de la langue, pour se fragmenter et recoudre les fragments. Au plus près du corps, au plus près du Ça, dès l’entame celui-ci mis en exergue et répété, obstinément fouillé par la suite.
Ça a débuté comme ça, ainsi se terminent mes propositions.
Question du public : « Vous parlez quand même peu de l’antisémitisme de l’écrivain, ne trouvez-vous pas que, peut-être effet de votre goût pour lui, vous excuseriez les pamphlets ? »
Cette question est toujours sollicitée par une présentation consacrée au sujet Céline. Peut-être n’ai-je effectivement pas développé suffisamment ce point, considérant qu’il ferait partie d’une sorte de lieu commun et que, de plus, je n’ai pas à me servir de l’écrivain pour mettre en avant mon propre humanisme. Toutefois, rien qu’à la considérer, là, c’est peut-être cette expression de « lieu commun » qui reflète au mieux la problématique que vous indiquez légitimement : Céline ne vient-il pas, tout à fait à dessein, nous saisir dans le lieu commun de notre abjection, l’intolérance à un autre par exemple ?
La bobine, le fil que j’ai tenté de suivre, est quand même la prise en compte de ce contraste posé par Céline : c’est le même qui peut nous ravir, c’est le même qui peut nous horrifier. Dans cette difficulté d’intégration, j’ai dit voir la marque du traumatique, au sens d’un complexe traumatique qu’il nous passe, dont Destouches aurait eu à se débrouiller, parfois à s’embrouiller. Que les pamphlets ne soient pas de la littérature c’est la position que j’ai tenue, alors, oui : c’est une position un peu facile.
On ne fait pas de littérature avec de bons sentiments, c’est connu, c’est surtout démontré de la manière la plus évidente par Céline. La perle est gâtée, je le regrette aussi, mais ce que j’ai tenté de désigner, en appui sur la conception ferenczienne du trauma, c’est que la perle gâtée est probablement consubstantielle à la dynamique de l’écriture.
Ensuite, si j’évoque l’hypnose à propos de la puissance du style célinien, c’est en sachant naturellement quelle problématique je croise : l’écrit pousse-t-il à l’acte ? Reprendre ceci c’est différencier la réalité du fantasme, celui accordé à l’hypnose de pouvoir contrôler l’autre, et même de pouvoir lui imposer des actes contraires à ses repères moraux. C’est comme cela que certains écrivent sur Céline, ayant perçu assez correctement son talent mais, à mon avis, lui prêtant ce fantasme populaire et confondant chez lui une pulsion, d’emprise, avec une réalisation dans la tête du lecteur. J’ai parlé de « transe » parce que cet écrivain en parle, également parce que, remarquablement, les formulations théorico-pratiques de l’hypnose semblent parfaitement mises en écriture par lui, tout ce qu’utilisent les hypnothérapeutes dans leurs injonctions et qui, évidemment, vise à passer, faire passer, qui renvoie à l’agonie.
Pour Céline probablement s’en défaire et s’en refaire… ce faisant se faire le lecteur ? Peut-être, mais certainement pas défaire ce lecteur, en particulier de ses repères moraux. C’est précisément, pour moi, le contraire de la machine à décerveler : penser les pensées avec lui stimule à éprouver sa différence, le lecteur est également par là frère d’arme comme compagnon qui va se prêter à l’entraînement du combat.
Enfin, je dirai surtout que faire de la littérature c’est justement s’élever du lieu commun. Sur la subsistance de la littérature dans les pamphlets, sur la substance de l’écriture romanesque à transporter, son auteur lui-même, au dépassement de ses propres positions, je renvoie l’auditoire à la conclusion du Céline de Henri Godard, il exprime lumineusement ce que j’ai tenté ici de différencier et qui tourne autour de cette idée, combien précieuse pour l’analyste, que certains formants narratifs promeuvent effectivement le dépassement de certaines limites ou complexes, voire folies privées.
Notes
- Mort à crédit, p. 793.
- Alexandre Vialatte, Chroniques du décès de Céline, pour La Montagne du 1 août 1961.
- Lettres, Pléiade V, p. 370, lettre du 13 mai 1933.
- Semmelweis, p. 41 et 46.
- Voyage au bout de la nuit, p. 242.
- Corcos M., Loisel Y., Jeammet P. (2016), « Expression névrotique, état limite, fonctionnement psychotique à l’adolescence », E.M.C., Psychiatrie, 2016, 1, 14, 37-215-B-20.
- Mort à crédit, p. 560.
- Mort à crédit, p. 527.
- Voir à ce sujet le premier chapitre de l’excellent ouvrage : La Bretagne de L.-F. Céline, Gaël Richard.
- Entretiens avec le Pr. Y., p. 545.
- Rigodon, p. 867.
- D’un château l’autre, p. 128
- D’un château l’autre, P. 125.
- Rigodon, p. 898.