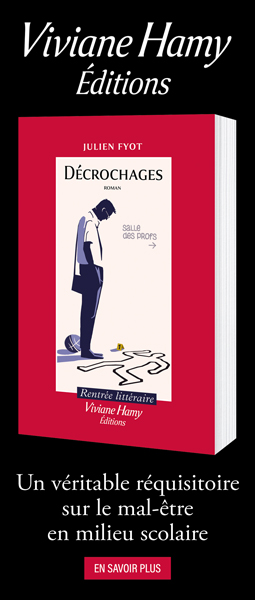L’UCSA (Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires) existe au sein de tout centre pénitentiaire depuis 1994. Ce dispositif, souvent nommé « infirmerie » par les détenus, fut ainsi créé dans l’objectif d’accéder aux soins tant somatiques que psychiques, sans quitter le lieu de détention. Service situé au sein même d’un établissement à but répressif, les difficultés de cohabitation se font parfois sentir ; à l’image de l’appareil psychique, imaginons un Surmoi (centre de détention) qui abriterait un Moi (UCSA), ce dernier faisant ainsi fonction de Moi-peau, souvent défaillant chez le patient-détenu.
Passage à l’acte et Moi-peau chez le patient-détenu
A travers mes expériences en milieu carcéral, notamment en UCSA en tant que clinicienne, j’ai réalisé combien il était fréquent de retrouver chez la personne détenue une recherche de Moi-peau extérieur, sorte de contenant substitutif. J’avais pu constater à travers le vécu de ces personnes l’inexistence ou la défaillance du holding maternel.
C’est également ce qu’ont pu expliquer C. Balier (1998) et A. Ciavaldini (1999), en mettant en lien passage à l’acte agressif et défaillance de la relation primaire à la mère. Aussi, s’il existe des troubles des fonctions du Moi-peau, et plus particulièrement la fonction de contenant des pulsions du psychisme, ils pourraient effectivement expliquer en partie l’absence de limites pulsionnelles exprimées dans le passage à l’acte, ainsi que l’altération du sentiment d’individuation, ce qu’explique C.Ciavaldini : « ces sujets touchent n’importe quel autre, n’importe comment, en fonction de leur montée d’excitation. Il y a là une forme de distinction qui n’a pu s’opérer. L’autre, dans sa dimension d’altérité n’est pas véritablement perçu » (C.Ciavaldini, 1999).
C’est durant un stage de DESS en maison d’arrêt (2003), que je me suis questionnée autour de cette problématique, notamment en élaborant mon travail de recherche, intitulé « Moi-peau et passage à l’acte agressif ». A travers le suivi de deux patients-détenus, et plus particulièrement les réponses recueillies au test projectif du Rorschach, j’avais pu constater la grande faiblesse d’un Moi, envahi par un Ça ainsi qu’un Surmoi quasi inexistant ; la déficience des limites internes rendant donc impossible la contention d’une trop forte excitation pulsionnelle. Aussi, les éléments de réponses au Rorschach faisaient majoritairement référence à la pénétration, l’intrusion, voire la persécution (« objets tranchants, pinces de crabes, organes internes, gueule de loup,… »), mettant en exergue l’absence d’imperméabilité entre le dedans et le dehors.
Le constat établi en milieu carcéral est que l’on retrouve tout particulièrement des pathologies dites limites ou des problématiques de type psychotique, ce qui s’est confirmé notamment chez ces deux personnes ; l’une révélant une pathologie limite teintée de traits paranoïaques, l’autre mettant en avant de grandes failles des assises narcissiques, dont l’état dépressif et la dépendance à l’alcool en fondaient les symptômes.
Didier Anzieu, dans le chapitre Altération de la structure du Moi-peau chez les personnalités narcissiques et les états-limites, (D. Anzieu, 1998, p.147) démontre en effet la fragilité de ce processus chez ces sujets. « Le moi-peau « normal » n’entoure pas la totalité de l’appareil psychique et il présente une double face, externe et interne, avec un écart entre ces deux faces qui laisse la place libre à un certain jeu. Cette limitation et cet écart tendent à disparaître chez les personnalités narcissiques ».
« Dans les états-limites, l’atteinte ne se limite pas à la périphérie ; c’est la structure d’ensemble du Moi-peau qui est altérée. Les deux faces du Moi-peau n’en font qu’une, mais cette face unique est tordue à la manière de l’anneau décrit par le mathématicien Moebius et auquel Lacan a le premier comparé le Moi : d’où ces troubles de la distinction entre ce qui vient du dedans et ce qui vient du dehors. Une partie du système perception-conscience, normalement localisé à l’interface entre le monde extérieur et la réalité interne, est décollé de cet emplacement et rejeté en position d’observateur extérieur (le patient état-limite assiste du dehors au fonctionnement de son corps et de son esprit, en spectateur désintéressé de sa propre vie). » (p.150)
L’UCSA ou mère suffisamment bonne
Le contexte d’enfermement peut être vécu lui-même comme une sorte de contention psychique. Au cours des entretiens cliniques, beaucoup de patients détenus s’expriment autour de la découverte d’une réflexion sur soi, d’une possibilité d’introspection, méconnue ou impossible jusqu’à la mise en détention ; « dehors, je ne pense pas, je suis toujours dans l’action. Ici, seul et enfermé toute la journée, j’arrive à réfléchir » » relate Tony, détenu récidiviste, dont j’amènerai la vignette clinique peu après. A l’extérieur, l’élaboration psychique fait défaut, l’accès au symbolique n’y est pas.
Si l’enfermement peut amener le patient détenu à accéder à la pensée, l’UCSA, quant à elle, peut lui permettre de la mettre en mots et d’accéder à la fonction d’individuation, ne serait-ce qu’à travers la relation et le regard du soignant. L’UCSA est un lieu de régression, où les défenses se fêlent et où peuvent enfin se révéler des émotions jusqu’ici étouffées par les pulsions agressives. Certains patients-détenus passent par l’infirmerie pour y soigner leur enveloppe corporelle si souvent malmenée, d’autres attendent leur rendez-vous avec le psychiatre ou le psychologue pour y déposer leur mal-être et leur réflexion. L’ébauche d’un narcissisme secondaire devient alors possible.
Nous parlions à l’instant de récidive ; plusieurs patients-détenus ont pu se sentir « perdus » à l’extérieur, malgré un travail de réinsertion et d’aménagement des conditions de vie à la sortie, pour certains d’entre eux. « Dehors, je n’arrive pas à me contrôler » sont des termes qui reviennent très souvent chez ces personnes qui vont et viennent entre le dedans et le dehors, et pour lesquels seul le franchissement de la barrière de l’interdit leur permet de retrouver un contenant, peu confortable mais tout de même sécurisant.
Il est intéressant de se pencher sur la possibilité (ou l’impossibilité) de faire cohabiter deux instances différentes et pourtant très complémentaires. D’une part l’UCSA, lieu de réceptacle du mieux-être de la personne, de la prise en compte de celle-ci en tant qu’être humain, quel que soit le geste et le comportement qui l’ait mené entre ces murs, et d’autre part l’établissement et l’administration pénitentiaire, lieu de répression, de privation de liberté qui marque chaque seconde de la notion de sanction, relative au passage à l’acte.
L’une abrite l’autre, ainsi l’UCSA se plie inévitablement à certaines règles du fonctionnement pénitentiaire, tel le Moi censuré par le Surmoi, ce qui permet de recréer à l’extérieur ce qui nous anime de l’intérieur. Or, il n’est malheureusement pas toujours évident d’articuler ces deux instances sur le terrain.
En effet, la notion de secret professionnel peut ne pas être entendue par l’équipe pénitentiaire. De ce fait, le dialogue et le travail de complémentarité autour du patient-détenu deviennent alors impossibles. Par conséquent, se crée un clivage entre le statut de détenu et le statut de patient ; l’un perçu comme bon, l’autre comme mauvais.
J’ai en tête l’exemple de ce patient-détenu qui s’était investi dans un travail thérapeutique régulier, et qui était parvenu au fil des séances à trouver lui-même des réponses à ses agissements faisant tant de mal aux victimes. Il fut transféré du jour au lendemain dans un autre établissement de la région. Le transfert pénitentiaire signe symboliquement cette notion de clivage entre le soin et la sanction, une sorte de répétition du passage à l’acte qui mène à la rupture brutale de la pensée et de l’élaboration.
Si certains utilisent l’espace de parole thérapeutique à des fins stratégiques (telles que l’obtention de remises de peine, ou dans le but de donner bonne impression au Juge d’Application des Peines pour un aménagement de sortie ou une permission) et n’investissent nullement cette aire « à penser », d’autres parviennent à constituer un lien avec le thérapeute et accédent à l’étayage qui leur est proposé pour avancer sur soi. J’ai su plus tard que ce détenu, qui avait vécu ce transfert pénitentiaire à un moment où il avançait particulièrement en thérapie, a refusé de poursuivre ce travail au sein du nouvel établissement où il avait été placé. Si la sanction est inévitable et que l’acte commis doit bien entendu être puni par la loi, il semble important qu’elle soit constructive et mène à l’élaboration de ce qui a mené à cet acte.
Tony
J’ai reçu Tony en entretien à sa demande. Grand et imposant, marqué au visage par de multiples balafres et cicatrices, ses bras remplis de tatouages en tout genres ne laissant plus entrevoir la moindre parcelle de peau, il s’est immédiatement présenté à moi par le signifiant « braqueur récidiviste », telle une identité à part entière, qui lui colle à la peau depuis sa jeunesse. Tony raconte dès lors ses braquages de banques, ses plans prévus des mois à l’avance pour que tout fonctionne, cette « adrénaline » tant recherchée au moment des faits ainsi que la jouissance finale du butin amassé puis partagé avec chacun des malfaiteurs.
Cette présentation de surface, teintée de défenses d’acier, a pu rapidement laisser place à une importante fragilité. L’objet premier de sa demande à voir un psychologue en détention était de « parler à quelqu’un », « exister ». Tony a purgé deux autres peines avant celle-ci, toujours pour le même motif : braquage à main armée. Il avait entamé un suivi thérapeutique lors de sa dernière incarcération, qui l’avait amené à réfléchir. Il avait préparé sa sortie avec les intervenants du Service Pénitentiaire Insertion et Probation, s’était tenu à un travail, avait un logement qu’il partageait avec une femme dont il était très épris. Ils avaient même pour projet de fonder une famille. Puis, quelques années plus tard, licencié économiquement de son travail, il ne parvenait plus à joindre les deux bouts, sa vie de couple commençait à chanceler, et Tony a peu à peu repris contact avec certains de ses « coéquipiers » comme il les nomme. Il s’est donc remis à braquer, sans penser aux conséquences qu’il connaît bien.
Ce troisième retour en prison lui fut plus difficile à vivre que les précédents. Tony ne cesse de pleurer dans le bureau, accablé par ce qui lui arrive ; une angoisse d’abandon le submerge, cette terrible peur que sa femme le quitte et ne vienne pas lui rendre visite au parloir. Il dit lui écrire jusqu’à dix lettres par jour, afin de combler ce vide insupportable. Progressivement, au cours du suivi, survient un sentiment de colère à son propre égard, réalisant ce qu’il avait commencé à construire à l’extérieur, et qu’il dit avoir détruit en quelques instants et pour de multiples années de détention. C’est une fois « contenu » physiquement et psychiquement que Tony a pu se rendre compte non seulement des conséquences de son acte (le trauma des victimes, la destruction de sa propre vie, le mal qu’il fait vivre à sa femme, son enfermement et l’attente d’un jugement sévère) mais aussi de son incapacité à penser et à raisonner à ce moment-là.
La fonction de pare-excitation, si fragile chez lui, semble avoir fait défaut et a laissé place au fantasme et au monde pulsionnel, devenus ainsi réalité via le passage à l’acte. Le cadre soignant au sein même du cadre immuable du lieu carcéral ont ainsi permis à Tony d’accéder à la pensée puis à un début de travail d’élaboration. L’objet de la thérapie étant finalement pour le détenu de passer d’un registre de fonctionnement de processus primaire à un fonctionnement de processus secondaire.
Monsieur P.
Monsieur P. est un homme d’une cinquantaine d’années. Il fut écroué pour conduite en état d’ivresse avec récidive et violences conjugales à répétition envers sa femme. Aîné d’une fratrie de trois enfants, il dit avoir une sœur avec qui il entretient peu de contact ainsi qu’un frère, décédé récemment d’un cancer. Ses parents sont tous deux également décédés. Il dépeint une enfance difficile : son père buvait beaucoup et violentait sa mère lorsqu’il était alcoolisé. Il décrit celle-ci comme dépressive, souvent hospitalisée et donc absente de la maison. Il fut marqué par l’éducation stricte de son père, qui n’hésitait pas à lever la main sur chacun d’eux.
Monsieur P. a dû commencer à travailler à l’usine dès l’âge de 14 ans pour subvenir aux besoins de la famille, le rythme et les horaires de travail étant très pénibles, il dit ne pas avoir vécu d’enfance, d’où le désir de fonder une famille avec sa femme, avec qui il eut 3 enfants. « Je n’ai pas voulu que mes enfants vivent la même chose que moi alors j’ai travaillé dur pour leur payer des études, j’ai tout fait pour qu’ils ne manquent de rien ». Lorsqu’il évoque ses difficultés conjugales, il explique que sa femme s’est séparée de lui plusieurs fois, mais serait à chaque fois revenue car pour Mr P., l’absence de cette dernière lui était insupportable. Il la qualifie de « dépressive », étant d’ailleurs hospitalisée au moment de son entrée en prison.
En début de suivi, Mr P. n’exprime aucun affect, ni en rapport avec le délit qui l’a amené ici, ni autour des violences qu’il a pu faire subir à sa femme. Son discours désaffectivé peut également laisser place à un processus de pensée opératoire, laissant s’exprimer des choses factuelles. Progressivement, Mr P. a commencé à s’exprimer autour de sa dépendance à l’alcool. Suivi par une infirmière spécialisée dans le domaine, Mr P. a réussi à s’ouvrir et sortir de ce discours défensif. Il dit être conscient des conséquences de cet état, sans toutefois laisser entrevoir une once de remord à l’égard des victimes (les deux passages à l’acte ayant été commis en état d’ébriété). Bien au contraire, il semble fonctionner sur un mode plaintif, mettant ainsi en avant une tendance à la victimisation ; « j’ai toujours su conduire ma voiture même en ayant un peu bu, je sais que je peux maîtriser ça. C’est toujours aux petits qu’on reproche des choses, il y a des vedettes qui roulent vite et qui ne sont pas nettes au volant, celles-là, on ne vient pas les embêter. » Puis, concernant les coups portés sur sa femme : « il s’agit d’une bousculade ancienne. Elle a porté plainte avec un poignet cassé et elle a dit aux gendarmes que c’était moi qui lui avait cassé. C’est pas vrai du tout, elle prenait toujours plein de médicaments et du coup elle ne pouvait pas tenir debout… comme si elle était ivre. Du coup, elle est tombée toute seule et s’est cassé le poignet. » Maintenant, je suis là en prison, sans avoir rien fait de grave… J’ai tout perdu ». Mr P. verse sa première larme à ce moment, parvenant ainsi à exprimer des émotions, bien qu’encore incapable de se décentrer et de sortir du déni de ses actes. Peu à peu il décrira ses ressentis à l’égard de sa femme, toujours en pleurs : « je lui pardonne tout. Je voudrais qu’elle revienne. Je ne me vois pas finir ma vie sans elle. A 55 ans, vous me voyez refaire ma vie ? ». « Si elle n’était plus là, je mangerais seul, je serais tout seul dans cette maison. Je prendrais un chien si elle ne revenait pas, j’irais m’inscrire dans une agence matrimoniale ». Dès lors, sa femme, si dévalorisée au départ semble considérée comme « vitale », celle-ci jouant un rôle d’étayage indispensable à Mr P. La solitude et la séparation s’avèrent donc extrêmement angoissantes pour lui, cette situation risquant de le confronter à un sentiment de vide insupportable, impliquant la disparition de ce substitut d’image maternelle défaillante.
Au fil du suivi, les défenses de type rigide de Mr P. s’atténuent pour laisser place à une problématique narcissique reliée à une forte angoisse de perte d’objet. « L’état limite se situe avant tout comme une « maladie » du narcissisme. La relation d’objet est demeurée centrée sur une dépendance anaclitique à l’autre. Le danger immédiat contre lequel se défend l’état limite, c’est essentiellement la dépression (Bergeret, 2000, p. 226) ». Cette relation d’objet apparaît clairement dans la description de sa relation conjugale, exprimée comme invivable mais néanmoins étayante.
La conduite addictive, quant à elle, consiste elle aussi en une relation de dépendance à l’objet qui vient jouer le rôle d’objet interne sécurisant et vise à recréer des expériences précoces non intégrées. L’alcool viendrait par conséquent apporter une complétude au manque à être, notamment sur le mode oral. Plus tard, Mr P. a pu parvenir à expliquer cette violence par le fait d’avoir lui-même été victime de son père et avoir assisté aux scènes de disputes conjugales. Se rendant très régulièrement aux entretiens thérapeutiques, il a pu élaborer autour de son parcours de vie, y créer des liens avec sa situation actuelle, mais surtout commencer à prendre l’autre en considération, et mettre des mots autour de la souffrance vécue par sa femme.
En conclusion
Si la dépression est le symptôme contre lequel se défend la personnalité état limite, il est intéressant d’en comprendre la psychodynamique. Selon Bergeret, « l’enjeu réel d’une dépression est celui d’un deuil intérieur, d’une perte d’objet narcissique constitutif du Soi, c’est-à-dire du sentiment de valeur. La souffrance éprouvée est liée essentiellement à la dévalorisation de l’image narcissique de soi-même, quel que soit le facteur conjoncturel du moment. Ce qui explique la relation d’objet dite anaclitique qui représente une sorte de tentative positive de combler en permanence le manque intérieur éprouvé » (Bergeret, 2000, p. 31).
Les vignettes de Tony et Mr P. illustrent cette hypothèse. La défaillance du Moi-peau étant telle qu’une seconde peau se doit de les envelopper afin de lutter contre le vide et les pulsions d’anéantissement. Le sentiment de dévalorisation de soi est tel que le passage à l’acte semble leur donner un statut de personne omnipotente, invincible. Or, la Loi vient leur rappeler inévitablement qu’il n’en est rien. Au contraire, la sanction établie les a ramenés à cette réalité, qui leur est alors insupportable.
S’il existe un clivage important entre la psyché et le soma à l’extérieur (le corps agit sans être contrôlé par la pensée), l’Ucsa ressemble à un lieu où la jonction entre les deux devient enfin possible.
Bibliographie
D. Anzieu (1998), Le Moi-peau, Dunod, Paris.
C. Balier (1998), Psychanalyse des comportements violents », PUF, Paris.
J. Bergeret (2000), Psychologie pathologique, Masson, Paris.
D. Bourgeois (2010), Comprendre et soigner les états limites, collection psychothérapies, Dunod, Paris.
A. Ciavaldini (1999), Psychopathologie des agresseurs sexuels, Masson, Paris.
C. Chabert (1983), Le Rorschach en clinique adulte, Dunod, Paris.
F. Millaud (1999), Le passage à l’acte, Masson, Paris.
D.W. Winnicott (1970), Processus de maturation chez l’enfant, Payot, Paris.